|
| |
|
Description des illustrations |
Illustration |
|
|
Les trois images montrent des organismes aquatiques microscopiques
essentiels aux écosystèmes marins. Les deux premières représentent des
copépodes, petits crustacés segmentés avec des antennes
et des appendices visibles, au corps translucide teinté de vert et
d’orange, révélant leurs structures internes. Ils sont suspendus dans un
liquide bleu, probablement de l’eau, et leur abondance est un indicateur
de la qualité environnementale. La troisième image montre un
krill, autre crustacé marin, avec un corps translucide, des
organes internes visibles, des marques orangées, des antennes et des
yeux composés proéminents. Le krill joue un rôle
fondamental dans la chaîne alimentaire océanique, servant de nourriture
à de nombreux animaux marins plus grands. |


 |
Les plancton animal
Le plancton animal, ou zooplancton, regroupe les
organismes aquatiques incapables de nager contre les courants et qui dérivent
dans les eaux marines ou douces. Le zooplancton est constitué
d’animaux microscopiques ou macroscopiques vivant en suspension dans la colonne
d’eau. Il inclut des crustacés comme les copépodes, des larves
de poissons, des méduses, des siphonophores et
d’autres invertébrés. Ces organismes peuvent être unicellulaires ou
pluricellulaires. Ils se nourrissent principalement de phytoplancton,
mais certains sont carnivores et consomment d’autres zooplancton.
On distingue deux grandes catégories : les holoplanctoniques,
qui passent toute leur vie dans le plancton, et les méroplanctoniques,
qui n’y séjournent qu’à un stade larvaire. Le zooplancton joue
un rôle fondamental dans les réseaux trophiques aquatiques, servant de
nourriture à de nombreux animaux filtreurs comme les baleines à fanons
ou les coquillages. Il participe aussi au brassage vertical des
couches d’eau par ses migrations quotidiennes, influencées par la lumière et les
saisons. Ces déplacements peuvent atteindre un kilomètre de profondeur et
contribuent à la redistribution des nutriments, de l’oxygène et du dioxyde de
carbone. Bien que souvent invisibles à l’œil nu, les espèces de
zooplancton sont extrêmement nombreuses et variées, certaines étant
bioluminescentes ou colorées. Leur présence est essentielle Ã
l’équilibre écologique des milieux aquatiques. |
La première image représente un réseau trophique marin où les relations
alimentaires entre les organismes sont illustrées. Les dauphins
et les requins chassent des poissons comme le
thon et le cabillaud, eux-mêmes prédateurs d’anchois,
de céphalopodes et de maquereaux. Ces
derniers consomment du zooplancton tel que les
copépodes et le krill, qui se nourrissent de
phytoplancton et de microplancton. À
la base du réseau figurent les producteurs primaires comme les
diatomées, les dinoflagellés et une forme
représentée comme une boule de suif.
La deuxième image montre l’écosystème océanique sous forme de pyramide
écologique. Elle classe les organismes selon leur rôle trophique, des
producteurs primaires comme le phytoplancton jusqu’aux
prédateurs supérieurs tels que l’orque, le
requin et l’ours polaire. Les niveaux
intermédiaires incluent les phoques, les
manchots, les calmars, les petits
poissons et les méduses. Le
zooplancton est identifié comme consommateur primaire. La
pyramide illustre la diminution de la biomasse et de l’énergie
disponible à mesure qu’on monte dans les niveaux trophiques.
La troisième image représente le cycle du carbone en milieu marin. Le
phytoplancton absorbe le COâ‚‚
atmosphérique grâce à la lumière du soleil. Le zooplancton
consomme le phytoplancton, puis les poissons
et autres organismes entrent dans la chaîne alimentaire. Le carbone est
redistribué par la respiration, la décomposition et la chute de matière
organique appelée neige marine vers les fonds
océaniques. Le stockage profond du carbone est représenté en violet, et
le cycle inclut aussi les sédiments, les
combustibles fossiles et leur combustion. |


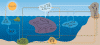 |
Le
plancton végétal
Le plancton végétal, ou phytoplancton, désigne
l’ensemble des micro-organismes photosynthétiques flottant dans les eaux
marines et douces. Il comprend principalement des algues microscopiques
comme les diatomées, les dinoflagellés,
les cyanobactéries et les coccolithophores.
Ces organismes utilisent la lumière solaire, le dioxyde de carbone et
les sels minéraux pour produire de l’oxygène et de la matière organique,
jouant ainsi un rôle fondamental dans la chaîne alimentaire aquatique.
Le phytoplancton est à la base des réseaux trophiques
marins, nourrissant le zooplancton, les larves de
poissons et d’autres animaux filtreurs. Il contribue également à la
régulation du climat en absorbant une part importante du CO₂
atmosphérique. Sa répartition dépend de la lumière, des nutriments, de
la température et des courants. Les efflorescences
phytoplanctoniques, parfois visibles depuis l’espace, peuvent
être bénéfiques ou toxiques selon les espèces en cause. Malgré leur
taille microscopique, ces organismes produisent plus de la moitié de
l’oxygène terrestre, surpassant les forêts en termes de production
primaire globale.
|
|
L’image montre un récif corallien sous-marin vibrant,
peuplé d’une grande diversité de vie marine. Des coraux
colorés de formes variées, comme des coraux ramifiés,
massifs et mous, s’étendent au premier
plan dans des teintes de rose, violet, jaune et blanc. De nombreux
petits poissons orange nagent autour du récif, créant
une scène dynamique et animée. À l’arrière-plan, une tortue
marine glisse gracieusement dans l’eau claire et bleue,
accompagnée de quelques autres poissons dont un poisson-papillon
aux motifs distinctifs. La visibilité est excellente, mettant en valeur
la richesse et la beauté de cet écosystème fragile. |
 |
L'homme
et la mer
Depuis les origines, l’homme entretient avec la mer une relation
ambivalente faite de fascination, de crainte et de conquête. D’abord
rivé aux rivages, il l’observe comme une étendue mystérieuse peuplée de
créatures inconnues et de forces incontrôlables. Peu à peu, il apprend Ã
la naviguer, Ã en tirer des ressources, Ã en faire une voie de commerce
et d’exploration. Les premiers pêcheurs côtoient les marins, les
pirates, les explorateurs. La mer devient théâtre de récits
mythologiques, de batailles épiques, de naufrages tragiques. Elle
façonne des civilisations entières, des ports florissants, des empires
maritimes. Mais elle reste imprévisible, capable de déchaîner sa colère
et de rappeler à l’homme sa vulnérabilité. Aujourd’hui encore, malgré
les technologies, les satellites et les navires sophistiqués, la mer
conserve son mystère et son pouvoir d’attraction. Elle est à la fois
ressource vitale, espace de liberté, enjeu écologique et frontière
mouvante entre l’homme et l’inconnu. |
|
Voici une illustration associée à ta description de la
bioluminescence : elle représente une méduse,
un poisson abyssal, un calmar et une
luciole, chacun émettant une lumière bleue-verte dans
leur environnement sombre. |
 |
La
bioluminescence
La bioluminescence est la production de lumière
par un organisme vivant. Elle résulte d'une réaction chimique entre une
molécule appelée luciférine et une enzyme appelée
luciférase, en présence d'oxygène. Ce phénomène est
utilisé par certains animaux pour attirer des proies, se camoufler,
communiquer ou se défendre. On la retrouve chez des organismes marins
comme les méduses, les poissons abyssaux,
les calmars, mais aussi chez des insectes comme les
lucioles. La lumière produite est généralement froide,
sans émission de chaleur, et peut varier en couleur selon l'espèce. |
|
L’image représente une coupe transversale du plancher océanique au
niveau d’une dorsale médio-océanique, illustrant la
formation des cheminées hydrothermales. Elle montre la
présence de magma sous la croûte terrestre, le trajet
de l’eau de mer qui s’infiltre par des fissures, se réchauffe au contact
du magma, puis remonte pour former des évents
hydrothermaux. Deux types d’évents sont visibles : les fumeurs
noirs qui émettent des panaches riches en sulfures
et en fer, et les fumeurs blancs qui
diffusent des minéraux plus clairs comme le baryum, le
calcium et le silicium. Autour de ces
structures, l’image représente des écosystèmes uniques avec des
vers tubicoles et d’autres organismes adaptés à ces conditions
extrêmes. |
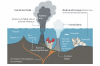 |
Les
sources hydrothermales
Les sources hydrothermales sont des émissions d’eau
chaude situées au fond des océans, généralement le long des
dorsales médio-océaniques où deux plaques tectoniques
s’écartent. L’eau de mer froide s’infiltre dans les fissures du plancher
océanique, descend jusqu’à rencontrer des zones chauffées par le
magma, puis remonte sous forme de jets riches en minéraux. Ces
fluides peuvent atteindre des températures supérieures à 350 °C et
forment des structures appelées cheminées hydrothermales.
On distingue les fumeurs noirs, qui rejettent des
fluides très chauds et riches en sulfures métalliques, et les
fumeurs blancs, qui émettent des fluides plus tièdes contenant
du sulfate de calcium. Ces environnements extrêmes abritent une
biodiversité unique, notamment des bactéries chimiosynthétiques
qui servent de base à des écosystèmes complexes, avec des vers
tubicoles géants, des palourdes et des
crevettes adaptés à l’absence de lumière et à la forte
pression. |
La première image est une vue anatomique détaillée d’une éponge,
avec sa structure interne : osculum,
spongocoele, choanocytes, mésohyle,
amœbocytes, cellules poreuses, et le
flux d’eau. Elle montre aussi un zoom sur une cellule choanocyte,
essentielle à la filtration.
La seconde image illustre cinq espèces d’éponges marines
: Cliona celata (éponge rouge perforante),
Chondrilla nucula (éponge encroûtante), Haliclona
compressa (éponge ramifiée), Aplysina fistularis
(éponge tubulaire), et Xestospongia muta (éponge
panier). Elle met en évidence leur diversité morphologique :
encroûtante, tubulaire, ramifiée, massive. |

 |
Les
éponges
Les éponges sont des animaux aquatiques
appartenant au phylum des Porifera. Elles vivent
principalement dans les mers, fixées sur des substrats, et se
caractérisent par une organisation corporelle très simple sans tissus
véritables ni organes. Leur corps est constitué d’un réseau de canaux et
de chambres tapissés de cellules spécialisées appelées
choanocytes, qui créent un courant d’eau permettant la capture
de particules alimentaires et l’oxygénation. L’eau entre par des pores
appelés ostia, circule dans la cavité interne appelée
spongocoele, puis ressort par une ouverture principale
nommée oscule. Les éponges possèdent
un squelette interne formé de spicules calcaires ou
siliceux et/ou de fibres de spongine. Elles se
reproduisent de manière sexuée par émission de gamètes ou de façon
asexuée par bourgeonnement ou fragmentation. Leur rôle écologique est
fondamental dans les écosystèmes marins, notamment comme filtreurs et
comme habitat pour d’autres espèces. Certaines produisent des substances
bioactives d’intérêt pharmacologique.
|
|