|
| |
|
Descripition des illustraitons |
Illustration |
|
|
Carte stylisée représentant les principales villes et lieux du monde
biblique et antique, centrée sur le bassin méditerranéen et le
Proche-Orient. Les éléments géographiques incluent la mer Méditerranée,
le fleuve Jourdain, le Sinaï et le mont Nébo. Les cités illustrées par
des bâtiments anciens ou temples sont Babel, Babylone, Damas, Colletha,
Tarse, Malte, Rome, Corinthe, Éphèse, Nazareth, Samarie, Shilo, Geboyra
et Dedan. Le mont Nébo et Babel apparaissent deux fois, suggérant une
importance symbolique ou narrative. L’ensemble évoque une cartographie
pédagogique ou religieuse, mêlant repères historiques et iconographie
sacrée. |

|
Les lieux de la Bible
Jérusalem ville centrale dans l’Ancien et le Nouveau Testament
lieu du Temple de Salomon de la crucifixion et de la résurrection de
Jésus Bethléem lieu de naissance de Jésus
cité dans les récits de David Nazareth ville
de l’enfance de Jésus mentionnée dans les Évangiles
Capharnaüm ville où Jésus enseigna et accomplit
plusieurs miracles Jéricho première ville conquise par les
Hébreux sous Josué Hébron ville associée Ã
Abraham et aux patriarches Babel lieu de la
tour symbolisant la dispersion des peuples Babylone cité de
l’exil des Juifs mentionnée dans Daniel et Jérémie
Damas ville de la conversion de Paul sur le
chemin de Syrie Éphèse ville des voyages
missionnaires de Paul et des Épîtres Corinthe
cité grecque où Paul fonda une communauté chrétienne
Rome capitale impériale mentionnée dans les Actes et les Épîtres
Mont Sinaï lieu de la révélation des Tables de la Loi Ã
Moïse Mont Nébo sommet où Moïse
contempla la Terre Promise Gethsémani jardin où Jésus
pria avant son arrestation Golgotha lieu de la crucifixion de
Jésus Mer Rouge traversée miraculeuse par les
Hébreux fuyant l’Égypte Mer de Galilée théâtre
de nombreux miracles de Jésus Jourdain fleuve
du baptême de Jésus par Jean-Baptiste
Samarie région évoquée dans les paraboles et les récits de
Jésus Siloé bassin de guérison dans l’Évangile selon
Jean Béthel lieu de la vision de l’échelle de
Jacob Shiloh premier sanctuaire hébreu avant
Jérusalem Tarse ville natale de Paul
Malte île du naufrage de Paul dans les Actes
des Apôtres |
|
Illustration politique centrée sur une carte de la Palestine historique,
encadrée à gauche par le drapeau israélien, le mot ISRAËL et le profil
d’un homme identifié comme CITOYEN ISRAÉLIEN, et à droite par le drapeau
palestinien, le mot PALESTINE et le profil d’un homme désigné comme
PALESTINIEN PALESTINIEN. En haut figure le slogan DEUX PEUPLES, UN
TERRITOIRE, soulignant la coexistence conflictuelle sur une même terre.
En bas, l’inscription PALESTINE HISTORIQUE renforce la dimension
mémorielle et territoriale du visuel. L’ensemble évoque la dualité
nationale et identitaire autour d’un espace disputé. |
 |
Deux
peuples, un territoire
Deux identités nationales — juive et
palestinienne — revendiquent une même terre, la Palestine historique.
Ce conflit trouve ses racines dans la fin
du XIXe siècle, avec la montée du sionisme, mouvement national juif
prônant la création d’un État pour les Juifs, alors dispersés et souvent
persécutés en Europe. La Palestine ottomane, puis mandataire
britannique, devient le lieu choisi pour ce projet, considéré comme la
terre ancestrale du peuple juif. Mais cette terre est déjà habitée
majoritairement par des Arabes palestiniens, qui développent eux aussi
une conscience nationale. La déclaration Balfour de 1917, par laquelle
le Royaume-Uni soutient l’établissement d’un « foyer national juif » en
Palestine, marque un tournant. Les tensions s’intensifient avec
l’immigration juive croissante, les achats de terres, et les
affrontements communautaires. En 1947, l’ONU propose un plan de partage
en deux États, juif et arabe, avec un statut international pour
Jérusalem. Les Juifs acceptent, les Arabes refusent. La guerre de 1948
aboutit à la création d’Israël, à l’exode de centaines
de milliers de Palestiniens (la Nakba), et à l’occupation de
territoires au-delà du plan initial. Depuis, le conflit s’est
cristallisé autour de plusieurs points : le droit au retour des réfugiés
palestiniens, le statut de Jérusalem, les colonies israéliennes en
Cisjordanie, et la reconnaissance mutuelle. Deux visions s’opposent :
celle d’un partage territorial (solution à deux États) et celle d’un
État binational, comme le propose l’historien Shlomo Sand
dans Deux peuples pour un État ?, plaidant pour une entité
politique commune, égalitaire et non ethnique. Ce dilemme entre
séparation et coexistence sur un même territoire reste au cœur des
débats politiques, historiques et moraux contemporains |
|
Illustration stylisée représentant une scène historique ou biblique où
un groupe de personnes, mêlant vieillards et jeunes, marche en file vers
la gauche, semblant guidé ou interpellé par une figure en armure antique
postée sur une structure surélevée, le bras tendu dans un geste
d’adresse. L’arrière-plan montre des bâtiments et des montagnes évoquant
un décor moyen-oriental. En haut de l’image, le slogan RETOURNER EN
PALESTINE ! donne à la scène une portée politique ou mémorielle,
suggérant un appel au retour ou à la réappropriation territoriale. |
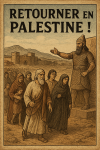 |
Retourner en Palestine
!
En 722 av.
J.-C., le royaume d’Israël (royaume du Nord),
dont la capitale était Samarie, est conquis par le roi
assyrien Sargon II. Cette conquête marque une rupture
majeure : une partie de la population est déportée vers l’Assyrie, selon
la politique impériale de dispersion des peuples. Ces « dix tribus
perdues » d’Israël sont considérées par la tradition comme les premières
victimes d’un exil collectif, amorçant une forme de diaspora. Ce n’est
pas encore la diaspora au sens gréco-romain du terme, ni celle qui
suivra la destruction du Temple de Jérusalem en 70 ap.
J.-C., mais c’est un jalon fondamental dans l’histoire de la dispersion
du peuple hébreu hors de la Terre promise. L’expression « Retourner en
Palestine ! » peut donc être interprétée comme une revendication
mémorielle remontant à cette première fracture territoriale. |
Illustration vintage représentant un homme barbu en costume
formel s’exprimant depuis un pupitre devant une foule, le bras
droit levé dans un geste d’orateur. Sur le pupitre repose un
livre intitulé Der Judenstaat, référence directe au projet
sioniste de Theodor Herzl. À l’arrière-plan, la foule est dense
et le Dôme du Rocher à Jérusalem est visible, ancrant la scène
dans un contexte historique et territorial précis. En haut de
l’image, le slogan UN FOYER POUR LE PEUPLE JUIF souligne l’appel
à la création d’un État juif, mêlant dimension politique,
mémorielle et territoriale.
|
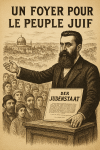 |
"Un
foyer pour le peuple juif"
En 1896, l’idée d’un « foyer pour le peuple juif » prend une forme
politique concrète avec la publication de Der Judenstaat (L’État
des Juifs) par Theodor Herzl, journaliste viennois et
fondateur du sionisme moderne.
Dans cet
ouvrage, Herzl affirme que l’émancipation juridique des Juifs en Europe
n’a pas suffi à les protéger de l’antisémitisme. Il propose donc la
création d’un État juif souverain, fondé sur le droit international,
pour garantir leur sécurité et leur dignité. Il ne désigne pas
immédiatement la Palestine comme lieu exclusif, évoquant aussi l’Argentine
comme alternative, mais la Terre d’Israël s’imposera
rapidement comme destination privilégiée. Herzl y développe une
stratégie diplomatique, économique et sociale : création d’une
Société juive pour organiser l’émigration, d’un Fonds
national pour financer les infrastructures, et d’un cadre
juridique pour négocier avec les puissances coloniales. Il appelle à un
congrès international pour fédérer les Juifs autour de ce projet, qui
verra le jour en 1897 à Bâle, avec la fondation de l’Organisation
sioniste mondiale.
L’expression « un foyer pour le peuple
juif » devient dès lors un objectif politique, repris dans la
Déclaration Balfour de 1917, puis dans les résolutions
internationales qui mèneront à la création de l’État d’Israël
en 1948. Elle incarne une réponse à l’exil, à la persécution, et à la
quête d’autonomie nationale. |
|
Illustration historique en tons sépia représentant l’administration
britannique en Palestine entre 1920 et 1948. Au premier plan, un
officier colonial britannique coiffé d’un casque colonial est assis à un
bureau, rédigeant des documents. Derrière lui, un groupe de personnes en
tenue traditionnelle moyen-orientale se tient debout, l’un d’eux levant
la main comme pour interpeller ou demander audience. À l’arrière-plan,
le Dôme du Rocher est visible ainsi qu’un drapeau britannique flottant
sur un mât, symbolisant la présence et le contrôle britannique durant la
période du mandat. L’ensemble évoque une scène de gouvernance coloniale
dans un contexte de tensions politiques et identitaires. |
 |
L'administration britannique
L’administration britannique en Palestine (1920–1948) désigne la période
du mandat confié par la Société des Nations au Royaume-Uni après la
chute de l’Empire ottoman. Elle constitue un cadre colonial dans lequel
se joue la montée du sionisme, la résistance arabe, et les prémices du
conflit israélo-palestinien.
Le mandat britannique
repose sur la Déclaration Balfour de 1917, intégrée en
1922 dans les termes du mandat. Il engage le Royaume-Uni à favoriser
l’établissement d’un « foyer national juif » tout en garantissant les
droits civils et religieux des populations non juives. Cette double
promesse crée une tension structurelle. L’administration est dirigée
depuis Jérusalem par un haut-commissaire britannique.
Elle organise l’immigration juive, supervise les infrastructures, et
tente de maintenir l’ordre entre communautés. Les années 1920 et 1930
voient une montée des affrontements : émeutes de 1929,
révolte arabe de 1936–1939, et durcissement des
politiques migratoires. En 1939, le Livre blanc limite
fortement l’immigration juive, provoquant la colère du mouvement
sioniste, surtout après la Shoah. Après la Seconde Guerre mondiale, la
situation devient ingérable : attentats de l’Irgun,
pression internationale, et impasse politique. Le Royaume-Uni renonce au
mandat en 1947, transférant la question à l’ONU, qui
propose un plan de partage. |
|
Peinture historique représentant un homme debout à un pupitre, lisant un
document devant une assemblée formelle composée d’hommes en costume.
Derrière lui, un grand drapeau israélien avec l’étoile de David souligne
le caractère solennel et national de l’événement. L’architecture du
lieu, avec ses arches et ses murs en pierre, renforce l’atmosphère
officielle. La scène évoque la déclaration de l’indépendance de l’État
d’Israël, probablement prononcée par David Ben-Gourion le 14 mai 1948,
moment fondateur marqué par la lecture du texte fondateur devant les
membres du futur gouvernement. |
 |
La fondation d'Israël
La fondation de l’État d’Israël a lieu le 14 mai
1948, lorsque David Ben Gourion proclame l’indépendance dans le musée de
Tel-Aviv, quelques heures avant la fin officielle du mandat britannique
sur la Palestine.
Cet acte marque l’aboutissement du projet sioniste lancé par
Theodor Herzl en 1896 avec L’État des Juifs, puis
structuré lors du congrès de Bâle en 1897. Il s’appuie
sur la Déclaration Balfour de 1917, dans laquelle le
Royaume-Uni soutient l’établissement d’un « foyer national juif » en
Palestine, et sur le vote du plan de partage de l’ONU
du 29 novembre 1947, qui prévoit deux États, l’un juif, l’autre arabe.Le
texte de la déclaration d’indépendance affirme le droit historique et
naturel du peuple juif à disposer d’un État en Terre d’Israël. Il est
rédigé par un comité dirigé par Ben Gourion, puis
approuvé par le Conseil national juif. La cérémonie se
déroule dans la galerie principale du musée de Tel-Aviv, devenue depuis
le Independence Hall.
Dès le lendemain, les armées de plusieurs pays arabes attaquent le
nouvel État, déclenchant la première guerre israélo-arabe. Israël
résiste et étend son territoire au-delà des frontières prévues par
l’ONU. Cette guerre provoque l’exode de plus de 700 000 Palestiniens,
événement connu sous le nom de Nakba (« catastrophe »).
La fondation d’Israël est célébrée chaque année lors de Yom
Ha'atzmaout, le jour de l’indépendance, selon le calendrier
hébraïque. Elle marque une rupture géopolitique majeure au Moyen-Orient
et reste au cœur des tensions régionales et des débats sur le droit au
retour, les frontières, et la reconnaissance mutuelle. |
|
Illustration stylisée à portée politique montrant un bras musclé
s’étendant depuis la gauche en tenant un drapeau israélien, traversant
un paysage aux tons rouges et beiges figurant un territoire avec routes,
bâtiments et implantations. L’allongement du bras évoque une expansion
territoriale, renforcée par le texte en haut de l’image UNE EXTENSION
CONTINUE. L’ensemble suggère une critique ou une observation sur
l’emprise croissante d’un pouvoir sur un espace disputé, mêlant
symbolisme physique et cartographie implicite. |
 |
Une
extension continuel
L’expression « une extension continuelle » désigne un processus
d’expansion territoriale, politique ou idéologique sans interruption ni
stabilisation, souvent associé à des dynamiques coloniales, impériales
ou stratégiques.
Dans le contexte du conflit israélo-palestinien, elle est fréquemment
utilisée pour qualifier la politique de colonisation menée par l’État d’Israël
depuis 1967, notamment en Cisjordanie, Ã
Jérusalem-Est, et parfois dans les hauteurs du Golan.
Cette expansion se traduit par :
– la construction de colonies civiles sur des territoires occupés –
l’aménagement d’infrastructures réservées aux colons (routes, réseaux,
zones industrielles) – l’annexion progressive de zones stratégiques ou
symboliques – le déplacement ou l’encerclement de populations
palestiniennes Le terme « continuelle » insiste sur l’absence de pause
ou de retour aux frontières reconnues par le droit international. Il
s’oppose à l’idée d’un gel des colonies ou d’un retrait territorial. Il
est souvent mobilisé dans les discours critiques, les résolutions de l’ONU,
ou les analyses juridiques sur la violation du droit international
humanitaire. Mais cette
expression peut aussi s’appliquer à d’autres contextes : expansion
impériale russe, conquête américaine vers l’ouest, ou même diffusion
idéologique (religieuse, économique, numérique) dans une logique de
saturation territoriale. |
|
Carte politique en français représentant les territoires occupés par
Israël après 1967, avec les zones concernées en orange : Cisjordanie,
Jérusalem-Est, Gaza, plateau du Golan et péninsule du Sinaï. Le fond
montre Israël et ses voisins régionaux, notamment l’Égypte, la Jordanie,
la Syrie et le Liban. En haut, le texte LA LOI DU PLUS FORT souligne une
lecture critique de l’expansion territoriale israélienne après la guerre
des Six Jours. En bas, une légende précise TERRITOIRES OCCUPÉS PAR
ISRAËL, renforçant l’interprétation géopolitique et juridique de la
carte. L’ensemble évoque une occupation prolongée et une politique de
colonisation. |
 |
La loi
du plus fort
Après
1967, l’État d’Israël étend son contrôle sur plusieurs territoires
au-delà de ses frontières initiales, notamment la Cisjordanie,
Jérusalem-Est, Gaza, le Golan et le Sinaï, amorçant une occupation
prolongée et une politique de colonisation.Voici
les principales étapes et dynamiques de cette expansion territoriale : –
Guerre des Six Jours (juin 1967) Israël remporte une
victoire militaire contre l’Égypte, la Syrie et la Jordanie. Il occupe
la Cisjordanie, la bande de Gaza,
Jérusalem-Est, le plateau du Golan
(Syrie) et le Sinaï (Égypte)
– Résolution 242 de l’ONU (novembre 1967) elle
affirme l’« inadmissibilité de l’acquisition de territoires par la
guerre » et demande le retrait israélien des territoires occupés. Israël
ne s’y conforme pas pleinement –
Annexions unilatérales Israël annexe
Jérusalem-Est en 1980 et le Golan en 1981,
décisions non reconnues par la communauté internationale
– Colonisation en Cisjordanie dès les années
1970, Israël implante des colonies civiles en territoire occupé. Ce
processus s’intensifie après 2000, avec des infrastructures réservées
aux colons et une fragmentation du territoire palestinien
– Accords d’Oslo (1993) Israël reconnaît l’OLP
et accepte la création d’une Autorité palestinienne
dans certaines zones (A et B), mais conserve le contrôle militaire et
civil sur les zones C, où résident la majorité des colons
– Retrait de Gaza (2005) Israël évacue ses
colonies de Gaza mais maintient un blocus terrestre, maritime et aérien,
ainsi qu’un contrôle indirect sur les frontières et les ressources –
Expansion continue en 2025, Israël contrôle toujours la
Cisjordanie, Jérusalem-Est et le Golan, avec plus de 700 000 colons
israéliens vivant en territoire occupé. Les frontières ne sont pas
reconnues par une partie des États arabes ni par l’ONU.Cette expansion
territoriale est souvent qualifiée d’occupation prolongée ou de
colonisation, selon les termes du droit international humanitaire. Elle
est au cœur du blocage diplomatique et des revendications
palestiniennes. |
Infographie en français intitulée UNE ÉCONOMIE EFFICACE
présentant une carte d’Israël surmontée du drapeau national,
entourée d’icônes et de textes décrivant les secteurs clés de
l’économie israélienne. Elle met en avant la réduction de la
dépendance énergétique grâce aux gisements de gaz naturel, le
leadership mondial en intelligence artificielle, le
développement et l’exportation de technologies de défense, une
croissance économique stable avec un PIB en hausse, un secteur
high-tech dynamique attirant les investissements étrangers, une
expertise reconnue en cybersécurité, et des infrastructures
avancées en télécommunications et informatique. L’ensemble
souligne la performance technologique et économique du pays.
|
 |
Une
économie efficace
Israël est un pays technologiquement avancé, avec une économie dynamique
centrée sur l’innovation, malgré une forte dépendance énergétique. Ses
secteurs de pointe incluent l’aéronautique, l’électronique civile et
militaire, les télécommunications, l’informatique, la cybersécurité et
l’intelligence artificielle.
Voici les points clés de l’économie israélienne en 2025 : –
Dépendance énergétique Israël importe plus de 90 % de ses
besoins énergétiques, notamment en pétrole et gaz naturel liquéfié.
Malgré des découvertes offshore (gisement de Leviathan),
le pays reste dépendant des marchés extérieurs pour sa consommation
énergétique – Secteur high-tech le secteur
technologique représente 18 % du PIB israélien en 2025,
avec plus de 9 500 startups actives. Les domaines les
plus dynamiques sont la cybersécurité, l’intelligence
artificielle, les technologies médicales, la
fintech et les logiciels d’entreprise
– Cybersécurité Israël est le deuxième
exportateur mondial de solutions de cybersécurité après les
États-Unis. En 2025, les exportations atteignent 12 milliards de
dollars, soit une hausse de 18 % par rapport à l’année
précédente – Intelligence artificielle plus de
1 800 startups spécialisées dans l’IA développent des
applications dans la santé, la finance, la défense et l’analyse
prédictive. Le pays attire des investissements massifs, notamment dans
les technologies de défense et les algorithmes avancés –
Technologies de défense l’aéronautique militaire, les drones,
les systèmes radar et les logiciels de commandement sont des secteurs
stratégiques. Les unités de l’armée comme 8200 et
Talpiot forment les ingénieurs qui alimentent
l’innovation civile et militaire – Télécommunications et
informatique Israël développe des infrastructures numériques
avancées, des solutions cloud, des systèmes embarqués et des
technologies de communication sécurisée. Ces secteurs sont soutenus par
des investissements étrangers et des partenariats internationaux –
Croissance économique selon l’OCDE, l’économie
israélienne progresse de 3,3 % en 2025, portée par la
consommation privée et les exportations technologiques. L’inflation
reste modérée à 3,2 %, malgré un marché du travail
tendu |
|
Illustration moderne représentant un système d’irrigation innovant dans
un paysage désertique avec des orangers alimentés par goutte-à -goutte,
chaque arbre recevant l’eau directement à sa base via des tuyaux percés.
Un satellite dans le ciel suggère un contrôle ou une surveillance Ã
distance, tandis qu’un capteur dans le sol près des racines indique une
mesure précise de l’humidité. Une icône de graphique en hausse évoque
l’amélioration de la productivité agricole. Le soleil et les montagnes
en arrière-plan rappellent les conditions arides du terrain. Le titre
INNOVATIVE IRRIGATION souligne l’efficacité technologique du dispositif. |
 |
Une
irrigation innovante
L’aridité du climat est un obstacle au développement agricole, mais le
nord du pays bénéficie de montagnes et de précipitations qui permettent
de produire des agrumes exportés en Europe.sraël
a développé des techniques d’irrigation de pointe pour surmonter la
rareté de l’eau, notamment dans les zones semi-arides du sud. Le système
de goutte-à -goutte, inventé par Netafim, permet une
distribution précise de l’eau à la racine des plantes, réduisant les
pertes par évaporation. Dans le nord, les hauteurs de Galilée
et du Golan reçoivent des précipitations plus
abondantes, favorisant la culture d’agrumes comme les oranges, les
pamplemousses et les citrons. Ces fruits sont cultivés dans des vergers
irrigués par des systèmes intelligents, puis exportés vers les marchés
européens. L’irrigation innovante repose aussi sur la réutilisation des
eaux usées traitées, l’analyse satellite des besoins hydriques, et
l’intégration de capteurs dans les sols et les plantes. Ce modèle
agricole combine haute technologie, adaptation climatique et performance
commerciale. |
|
Image représentant un homme en costume noir, chemise blanche, barbe,
lunettes et kippa noire, debout aux côtés d’une femme en robe bleue et
hijab beige, tous deux en extérieur. À l’arrière-plan, on distingue le
Dôme du Rocher, un bâtiment arborant le drapeau canadien et un drapeau
israélien sur la gauche, suggérant une scène mêlant Jérusalem et
symboles nationaux. L’ensemble évoque une rencontre interculturelle ou
interreligieuse, mettant en avant la coexistence ou le dialogue entre
identités juive et musulmane dans un cadre marqué par des références
géopolitiques. |
 |
Des
israéliens juifs et arabes
Israël compte une population composée majoritairement de Juifs, mais
aussi d’Arabes israéliens, qui représentent environ 20 % des citoyens.
Ces deux groupes partagent le territoire national, mais vivent souvent
dans des réalités sociales, culturelles et politiques distinctes.
Israéliens juifs
Ils forment environ 75 % de la population. Ils sont issus de vagues
d’immigration successives : Europe centrale et orientale (ashkénazes),
pays arabes et musulmans (séfarades et mizrahim), Éthiopie, ex-URSS,
États-Unis. Ils sont majoritairement hébraïsants, souvent laïcs ou
traditionnels, mais aussi religieux ou ultra-orthodoxes. Ils vivent dans
toutes les régions du pays, notamment dans les grandes villes comme
Tel-Aviv, Haïfa, Jérusalem,
et dans les colonies en Cisjordanie.
Arabes israéliens Ils
représentent environ 20 % de la population d’Israël. Ce sont les
descendants des Palestiniens restés sur place après 1948. Ils sont
citoyens israéliens, parlent arabe et hébreu, et vivent principalement
dans le nord (Galilée), dans le triangle (centre), à Haïfa,
Jaffa, Nazareth, et dans certaines
villes mixtes. Ils ont accès aux institutions publiques mais dénoncent
des discriminations dans l’emploi, le logement, l’éducation et la
représentation politique.
Coexistence et tensions Il existe des villes mixtes, des
coopérations économiques, des initiatives éducatives et culturelles
communes. Mais les tensions sont vives, notamment lors des conflits avec
Gaza ou des affrontements à Jérusalem. Les Arabes israéliens sont
parfois pris entre loyauté nationale et solidarité avec les Palestiniens
des territoires occupés. |
|
llustration divisée en trois panneaux verticaux représentant la
diversité culturelle du peuple juif. Le panneau gauche intitulé
ASHKENAZIS montre un homme barbu avec un chapeau noir et une tenue
traditionnelle tenant un livre, avec une synagogue en arrière-plan et un
autre homme en train de lire. Le panneau central intitulé SEFARADES
présente une femme en foulard blanc et vêtements traditionnels,
accompagnée en bas d’un homme jouant d’un instrument à cordes devant une
architecture typique. Le panneau droit intitulé SABRAS montre un homme
en chemise verte devant un paysage de collines et de cactus, symbolisant
les Juifs nés en Israël. L’ensemble met en lumière les différences
d’origine, de coutumes et d’environnement au sein du judaïsme
contemporain. |
 |
Ashkénazes, séfarades et sabras
Les termes « ashkénazes », « séfarades » et « sabras » désignent trois
grandes composantes identitaires de la population juive en Israël,
chacune avec ses origines, ses langues, ses traditions et ses
trajectoires historiques.
Ashkénazes – Originaires d’Europe
centrale et orientale (Allemagne, Pologne, Russie, Ukraine, Lituanie…) –
Langue historique : yiddish (mélange d’allemand, hébreu et langues
slaves) – Arrivent en Palestine dès la fin du XIXe siècle, puis en masse
après la Shoah – Majoritaires dans les élites politiques, universitaires
et économiques jusqu’aux années 1980 – Portent une culture juive
rationaliste, souvent laïque ou socialiste, influencée par les Lumières
européennes
Séfarades et Mizrahim – Séfarades : descendants des Juifs
expulsés d’Espagne en 1492, installés en Afrique du Nord, Balkans,
Empire ottoman – Mizrahim : Juifs originaires du Moyen-Orient (Irak,
Iran, Yémen, Syrie, Égypte…) – Langues historiques : judéo-arabe,
ladino, hébreu liturgique – Arrivent en Israël surtout après 1948,
souvent dans des conditions précaires – Longtemps marginalisés, ils
revendiquent leur culture orientale, musicale, religieuse et familiale –
Ont progressivement accédé à des postes politiques et culturels,
notamment via le parti Shas Sabras – Terme hébreu
désignant les Juifs nés en Israël (littéralement « figue de barbarie » :
piquant à l’extérieur, doux à l’intérieur) – Représentent une identité
israélienne nouvelle, détachée des diasporas – Hébraïsants, souvent
sécularisés, porteurs d’un ethos national, militaire et agricole –
Symbole du renouveau juif sur la terre d’Israël, valorisé dans les
récits sionistes Ces
identités coexistent, parfois en tension, parfois en fusion. Elles
structurent les rapports sociaux, les mémoires familiales, les styles
politiques et les expressions culturelles en Israël. |
|
Illustration représentant une scène de tension politique avec au premier
plan une personne en sweat vert, jean bleu et keffieh noir et blanc, le
visage partiellement couvert, brandissant une pierre dans un geste de
lancer. À l’arrière-plan, un mur tagué affiche le mot PALESTINE en
lettres noires, un drapeau palestinien, le mot FREEDOM et des dessins de
colombes accompagnés de texte arabe. Derrière cette figure, un soldat en
tenue militaire marche tandis qu’un groupe de manifestants, certains en
habits traditionnels, tiennent des pancartes. L’ensemble évoque une
situation de résistance, de conflit et d’expression politique dans un
contexte marqué par l’occupation et la revendication identitaire. |
 |
La
première Intifada
La première
Intifada est un soulèvement populaire palestinien déclenché le 9
décembre 1987 dans les territoires occupés par Israël depuis 1967,
principalement en Cisjordanie, à Gaza et à Jérusalem-Est. Elle débute
après la mort de quatre Palestiniens dans un accident de la route
impliquant un véhicule israélien, perçu comme une vengeance, et s’étend
rapidement à l’ensemble des territoires. Ce mouvement, largement
spontané, mobilise des jeunes, des femmes, des syndicats et des comités
locaux. Il se caractérise par des grèves, des boycotts, des refus de
payer l’impôt, des jets de pierres et des affrontements avec l’armée
israélienne. La répression est sévère : couvre-feux, arrestations, usage
de balles réelles. Le bilan humain est lourd, avec plus de 1 900
Palestiniens tués et des milliers de blessés. L’Intifada marque une
rupture : elle internationalise la cause palestinienne, pousse Israël Ã
reconnaître l’OLP comme interlocuteur, et débouche sur les accords
d’Oslo en 1993. Elle révèle la centralité de la société civile
palestinienne dans la lutte contre l’occupation et inaugure une nouvelle
phase du conflit israélo-palestinien. |
|
Illustration stylisée représentant trois figures politiques dans une
scène emblématique. Au premier plan, deux hommes se serrent la main :
l’un en costume sombre et lunettes, l’autre en tenue militaire avec
keffieh, incarnant respectivement Yitzhak Rabin et Yasser Arafat. À
l’arrière-plan, un troisième homme en costume avec cravate rouge,
cheveux gris et sourire bienveillant, se tient debout devant une
silhouette du bâtiment de la Maison-Blanche, identifiant Bill Clinton.
L’ensemble évoque la signature des Accords d’Oslo en 1993, moment
diplomatique majeur dans le processus de paix israélo-palestinien. |
 |
Un court
espoir
En 1993,
un court espoir de paix émerge avec la signature des Accords
d’Oslo entre Yitzhak Rabin, Premier ministre
israélien, et Yasser Arafat, président de l’OLP,
sous l’égide de Bill Clinton à Washington.
Ces accords prévoient une reconnaissance mutuelle, la création d’une
Autorité palestinienne autonome dans certaines zones de
Cisjordanie et de Gaza, et un
calendrier de négociations sur les questions sensibles comme Jérusalem,
les réfugiés et les colonies. La poignée de main entre Rabin
et Arafat sur la pelouse de la Maison-Blanche
devient un symbole mondial, mais les espoirs sont vite fragilisés par
les attentats du Hamas, les oppositions internes, et
l’assassinat de Rabin en
1995 |
Illustration dramatique portant le titre LA SECONDE INTIFADA,
montrant plusieurs individus dans un décor ravagé par les
affrontements, avec fumée et ruines en arrière-plan. Certains
portent des keffiehs, l’un lève le poing, d’autres semblent fuir
ou participer à une action. Des soldats armés sont présents,
suggérant une confrontation directe. L’ensemble évoque la
période de soulèvement palestinien du début des années 2000,
marquée par la résistance, la violence et les tensions
politiques.
|
 |
La
seconde Intifada
La seconde Intifada, aussi appelée Intifada Al-Aqsa, est un soulèvement
palestinien déclenché le 28 septembre 2000, à la suite de la visite
controversée d’Ariel Sharon sur l’esplanade des Mosquées Ã
Jérusalem-Est. Elle dure jusqu’en 2005 et marque une phase de violence
intense entre Palestiniens et Israéliens.
Contrairement à la première Intifada (1987–1993), largement non armée,
la seconde se caractérise par une militarisation croissante du conflit.
Des attentats-suicides frappent les villes israéliennes, tandis que
l’armée israélienne mène des opérations massives dans les territoires
palestiniens, notamment lors de l’opération Rempart en 2002. Le bilan
humain est lourd : plus de 3 000 Palestiniens et environ 1 000
Israéliens tués. Ce soulèvement survient dans un climat de désillusion
après l’échec des négociations de Camp David II
(juillet 2000) entre Ehud Barak et Yasser
Arafat, sous médiation de Bill Clinton. Il
révèle l’effondrement du processus d’Oslo et la montée
en puissance du Hamas et du Jihad islamique,
au détriment de l’OLP.
La seconde Intifada entraîne une
réoccupation militaire de nombreuses zones autonomes palestiniennes, la
construction du mur de séparation en Cisjordanie, et
une radicalisation des deux sociétés. Elle s’achève progressivement avec
la mort d’Arafat (2004), l’élection de Mahmoud Abbas (2005), et le
retrait israélien unilatéral de Gaza. |
Illustration stylisée représentant un affrontement militaire
entre deux soldats dans un décor de guerre marqué par des
bâtiments détruits, des tanks et des explosions. À gauche, un
combattant en tenue de camouflage et bandeau tient un
lance-roquettes, tandis qu’à droite un soldat casqué arborant
une étoile de David bleue vise avec un fusil. Des missiles
traversent le ciel et un éclair en zigzag sépare les deux
figures, accentuant la violence du conflit. L’ensemble évoque
une confrontation intense dans un contexte de tension
géopolitique et de destruction.
|
 |
Une situation bloquée
En 2006, le Hamas, mouvement islamiste
palestinien considéré comme organisation terroriste par l’Union
européenne, les États-Unis et Israël, remporte les élections
législatives palestiniennes. Ce succès électoral entraîne une rupture
avec le Fatah, parti dominant de l’OLP,
et débouche sur une guerre civile palestinienne qui conduit à la prise
de contrôle de la bande de Gaza par le Hamas en juin
2007. Dès lors, les affrontements entre le Hamas et Israël
s’intensifient. Le Hamas lance régulièrement des roquettes
depuis Gaza vers le territoire israélien, visant des villes comme
Sderot, Ashkelon ou Beer-Sheva.
Israël réplique par des opérations militaires ciblées,
des frappes aériennes, et des incursions terrestres, causant la mort de
nombreux Palestiniens, combattants et civils.
Ces échanges violents s’inscrivent dans une dynamique asymétrique : le
Hamas utilise des tactiques de guérilla et des tirs depuis des zones
densément peuplées, tandis qu’Israël mobilise une puissance militaire
supérieure. Les civils palestiniens sont souvent pris au piège,
notamment en raison du blocus imposé sur Gaza depuis 2007, qui limite
les mouvements, les ressources et les infrastructures.
Ce cycle de violence, marqué par des pics
comme l’opération Plomb durci (2008–2009),
Bordure protectrice (2014), ou Gardien des murs
(2021), illustre une situation bloquée où les ripostes militaires ne
débouchent sur aucun règlement politique durable. |
|
Illustration représentant une scène chaotique et violente associée au 7
octobre 2023, montrant plusieurs civils en fuite dans un environnement
ravagé par les flammes et les bombardements. Un homme en chemise rouge
mène le groupe, suivi d’un jeune en gris, d’une fille en robe jaune et
d’une autre personne en haut violet, tous courant dans la panique. À
l’arrière-plan, des habitations sont en feu, le ciel est obscurci par la
fumée et traversé par des projectiles, tandis qu’un soldat armé avance,
renforçant la tension. L’ensemble évoque une situation de guerre ou
d’attaque soudaine, mettant en lumière la peur, la destruction et la
vulnérabilité des civils dans un contexte de conflit intense. |
 |
Le 7
octobre 2023
Le 7 octobre 2023 marque le déclenchement d’une attaque sans précédent
du Hamas contre Israël, causant la mort de plus de 1 100 civils
israéliens et entraînant une guerre de grande ampleur dans la bande de
Gaza.
Ce jour-là , à l’aube, le Hamas lance l’opération
« Déluge d’Al-Aqsa », combinant une pluie de
plus de 5 000 roquettes tirées depuis Gaza et une
infiltration terrestre, aérienne et maritime de centaines de
combattants dans le sud d’Israël. Des attaques coordonnées visent des
kibboutzim, des bases militaires et un festival de musique Ã
Re’im, où des civils sont massacrés ou pris en otage. Plus de
1 189 personnes sont tuées en Israël, dont 815
civils, et 251 otages sont capturés et emmenés
à Gaza. L’armée israélienne,
prise de court, réagit par des frappes massives sur la
bande de Gaza, marquant le début d’une guerre prolongée. Le gouvernement
de Benyamin Netanyahou décrète l’état d’urgence,
mobilise les réservistes, et lance une opération terrestre
dans Gaza. Le conflit s’étend ensuite à la Cisjordanie,
au Liban Sud (Hezbollah) et au Yémen (Houthis),
avec des implications régionales et internationales majeures.
L’attaque du 7 octobre 2023 est
considérée comme le jour le plus meurtrier de l’histoire
d’Israël, et comme un tournant stratégique
dans le conflit israélo-palestinien. Elle a provoqué une onde de choc
mondiale, relancé les débats sur la sécurité, la colonisation, le blocus
de Gaza, et les perspectives de paix. |
|