|
| |
|
Description des illustrations |
Illustration |
|
|
L'image représente la crucifixion de jésus au centre entouré de six
peintres majeurs du xvème siècle chacun identifié par son nom en lettres
capitales fra angelico est placé à gauche avec une
expression recueillie et une coiffe monastique bartolomé bermejo
est représenté avec des traits hispaniques et un regard intense
jan eyck arbore un bonnet typique des flandres et un visage
concentré rogier van der weyden est figuré avec une
posture méditative et des vêtements sobres jean fouquet
porte une coiffe française et un visage fin marqué par la précision
l’ensemble est traité en tons sépia avec une composition symétrique
centrée sur le christ en croix portant la couronne d’épines et un pagne
les artistes incarnent chacun une école régionale de la peinture
religieuse du xvème siècle et sont réunis ici comme témoins de la scène
sacrée |
 |
Un
art avant tout religieux
La peinture du XVème siècle est dominée par la dimension
religieuse. Les commandes proviennent principalement des institutions
ecclésiastiques et des mécènes liés à la foi. Les artistes mettent leur
talent au service de la représentation des épisodes bibliques, des
saints et de la Vierge. Les fresques, retables et enluminures visent Ã
instruire et émouvoir les fidèles. En Italie, Fra Angelico
illustre la spiritualité par des compositions lumineuses et apaisées. En
Flandre, Jan van Eyck et Rogier van der Weyden
perfectionnent l’art du détail et de la profondeur pour magnifier les
scènes sacrées. En Espagne, Bartolomé Bermejo traduit
la ferveur religieuse dans des œuvres marquées par le réalisme. En
France, Jean Fouquet unit tradition gothique et
innovations renaissantes dans ses miniatures. Cet art est avant tout un
instrument de dévotion et de pédagogie, où la beauté sert la foi et la
contemplation. |
|
Scène d’atelier artistique de la Renaissance avec figures humaines en
pleine création. Au centre un peintre en robe rouge réalise le portrait
d’une femme vêtue de bleu assise devant lui. À gauche un dessinateur
esquisse sur un carnet. À droite un sculpteur façonne une statue
masculine nue. D’autres personnages observent ou discutent.
L’arrière-plan montre une architecture classique avec colonnes arches et
vue sur un édifice à coupole rappelant le Duomo de Florence. L’ensemble
illustre l’effervescence artistique et intellectuelle de la Renaissance
avec mise en valeur de l’humanisme et de la collaboration entre
disciplines. |
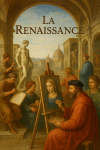 |
La
Renaissance
La Renaissance est une période de renouveau artistique et
intellectuel qui s’étend du XIVe au XVIe siècle. Elle naît en Italie
dans des cités comme Florence, Rome et Venise, où le mécénat des Médicis
et des papes favorise l’émergence d’artistes majeurs.
Ce mouvement
s’appuie sur la redécouverte des textes antiques, le développement de
l’humanisme et les progrès techniques. L’art de la Renaissance se
distingue par la perspective linéaire, le réalisme anatomique, la
lumière naturelle, la monumentalité des compositions et la valorisation
de l’individu. Le peintre devient intellectuel et théoricien. Les sujets
religieux restent dominants mais s’enrichissent de mythologie
gréco-romaine, de scènes profanes, de portraits et de paysages. Les
œuvres ne sont plus réservées aux églises mais décorent aussi les palais
et les maisons bourgeoises. Giotto initie le réalisme et la profondeur.
Masaccio introduit la perspective. Léonard de Vinci incarne
l’artiste-scientifique. Michel-Ange sublime le corps humain dans la
Chapelle Sixtine. Raphaël incarne l’harmonie et la grâce. Titien,
Véronèse et Le Tintoret développent la couleur et le mouvement à Venise.
Dürer et Holbein diffusent l’art renaissant en Europe du Nord. La
peinture à l’huile remplace la tempera. La gravure se développe.
L’architecture s’inspire des ordres antiques. La sculpture retrouve les
proportions classiques. L’imprimerie favorise la diffusion des idées. La
Renaissance marque la fin du Moyen Âge et le début des Temps modernes.
Elle prépare les révolutions scientifiques, philosophiques et politiques
à venir. L’artiste devient créateur autonome, porteur de sens et de
beauté. |
|
Scène intérieure à forte charge historique et allégorique avec
architecture en arc et statues classiques. Au premier plan un artiste
assis peint sur une toile tenant palette et pinceau. Autour de lui
plusieurs figures emblématiques dont un homme en armure avec cape rouge
une femme assise devant un livre et un personnage en tenue religieuse
probablement un évêque. À l’arrière-plan d’autres observateurs et une
statue de soldat romain dans une niche. L’ensemble évoque une commande
artistique ou un moment de convergence entre art religion et pouvoir
dans un cadre solennel et intellectuel. |
 |
Le XVIIème Siècle :
Le XVIIe siècle est marqué par l’affirmation du baroque
et du classicisme dans un contexte de conflits religieux, de
centralisation monarchique et d’essor des académies.
L’art
devient un instrument de pouvoir, de foi et de prestige. En Italie, le
baroque triomphe avec Caravage, maître du clair-obscur, qui impose un
réalisme dramatique et une tension spirituelle. Bernin et Borromini
transposent cette dynamique dans l’architecture et la sculpture. En
Espagne, Velázquez peint la cour avec une subtilité psychologique
inédite, tandis que Zurbarán et Murillo illustrent la ferveur
catholique. Aux Pays-Bas, le protestantisme favorise une peinture
profane et intimiste. Rembrandt explore la lumière intérieure, Vermeer
sublime les scènes domestiques, Frans Hals capte l’instant. En France,
le classicisme s’impose avec Poussin, Le Brun et Le Lorrain. L’art
devient rationnel, structuré, porteur de valeurs morales. L’Académie
royale de peinture et de sculpture, fondée en 1648, codifie les règles
et hiérarchise les genres. Le roi Louis XIV utilise l’art pour glorifier
son règne. Versailles devient le symbole du pouvoir absolu. La peinture
religieuse reste dominante mais s’ouvre à l’histoire, au paysage, au
portrait et à la nature morte. Le marché de l’art se développe, les
collectionneurs se multiplient. Le XVIIe siècle est aussi celui des
grandes commandes publiques, des décors monumentaux, des retables et des
plafonds peints. L’artiste est à la fois serviteur du pouvoir et
créateur autonome. L’art devient un langage universel, capable
d’émouvoir, d’instruire et de convaincre. |
|
La chapelle Scrovegni ou chapelle des Éremites,
située à Padoue, présente un espace rectangulaire voûté
en berceau, intégralement recouvert de fresques réalisées vers 1305 par
Giotto di Bondone. Le plafond bleu profond est parsemé
d’étoiles dorées et de médaillons représentant des figures religieuses.
Les murs latéraux sont organisés en registres narratifs illustrant la
vie de la Vierge Marie et de Jésus-Christ,
avec une progression visuelle et théologique marquant une rupture
stylistique avec l’art médiéval. À l’extrémité, un autel modeste est
surmonté d’une fenêtre à vitrail, renforçant la perspective et la
solennité de l’ensemble. Ce décor monumental incarne une étape
fondatrice dans l’évolution de la peinture occidentale vers la
Renaissance, par l’introduction de la profondeur, de l’émotion
et de la narration séquentielle.
Cette Crucifixion de
Giotto di Bondone
(1266–1337), peinte à tempera sur bois vers 1290–1295, représente le
Christ cloué sur la croix, vêtu d’un simple pagne blanc, couronné
d’épines, sous l’inscription latine INRI
signifiant « Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum.
L’œuvre se distingue par son fond bleu intense et son encadrement doré,
typique de la transition entre art gothique et pré-Renaissance.
Le corps du Christ est traité avec une attention nouvelle à l’anatomie
et à l’expression de la souffrance humaine, rompant avec les conventions
byzantines. Giotto introduit une tridimensionnalité dans le
traitement du corps et une émotion contenue dans le visage, annonçant
les innovations de la Renaissance. Cette œuvre, conservée à la
Basilique Santa Maria Novella de Florence, marque l’un des
premiers exemples de la volonté de Giotto de représenter le
divin dans une humanité tangible, influençant durablement la peinture
occidentale
Cette fresque de
Giotto di Bondone
(1266–1337), peinte entre 1303 et 1306 dans la
chapelle Scrovegni à Padoue,
se compose de trois registres illustrant des épisodes majeurs de la vie
du Christ : le baptême, la résurrection et la lamentation. Dans
la scène supérieure, Jean-Baptiste verse l’eau sur la tête du
Christ immergé dans le Jourdain, entouré d’anges aux gestes tendres et
de rochers stylisés qui structurent la composition. Au centre du
registre médian, le Christ ressuscité sort du tombeau dans une posture
triomphante, entouré de soldats endormis et d’anges en vol, tandis que
les lignes de force et les raccourcis accentuent la profondeur et le
mouvement. En bas, la lamentation montre le corps du Christ étendu,
pleuré par la Vierge, Marie-Madeleine et les apôtres, dans une
composition horizontale marquée par l’émotion contenue et les regards
convergents. Giotto révolutionne l’art sacré en introduisant la
tridimensionnalité, la narration expressive et une lumière claire qui
modèle les volumes, rompant avec les conventions byzantines pour
annoncer la Renaissance italienne. |




|
Giotto Di Bondone (1266-1337)
Giotto di Bondone est considéré comme le père de la peinture
occidentale moderne. Né en 1266 près de Florence, il rompt avec l’art
byzantin en introduisant le réalisme, la profondeur et l’émotion dans la
représentation picturale. Il est formé par Cimabue mais dépasse son
maître en humanisant les figures religieuses. Ses fresques de la
chapelle Scrovegni à Padoue marquent une révolution visuelle. Il y
développe la narration, la perspective intuitive et l’expression des
sentiments. Giotto peint des corps volumétriques, des visages
individualisés, des gestes crédibles. Il donne à la peinture une
dimension dramatique et incarnée. Il travaille aussi à Assise, Florence,
Naples et Rome. Ses Å“uvres influencent toute la Renaissance. Dante le
cite dans la Divine Comédie. Giotto est aussi architecte : il conçoit le
campanile du Duomo de Florence. À sa mort en 1337, il laisse une œuvre
fondatrice. Il transforme l’image religieuse en scène humaine,
accessible et émotive. Il ouvre la voie à Masaccio, Fra Angelico, Piero
della Francesca et Léonard de Vinci. Giotto incarne le passage du Moyen
Âge à l’art moderne. Son génie réside dans la capacité à unir foi,
narration et observation du réel. |
Le Portrait des époux Arnolfini (1434) Peinture à l’huile sur
bois conservée à la National Gallery de Londres. Elle représente un
couple bourgeois dans une chambre flamande, entouré d’objets porteurs de
significations religieuses et sociales. Le miroir convexe au fond
reflète deux témoins, suggérant un acte solennel. Le chandelier, le
chien, les fruits et les chaussures retirées renforcent la lecture
symbolique du mariage ou d’un pacte sacré. La lumière latérale, le rendu
des tissus et la signature « Johannes de Eyck fuit hic » témoignent de
l’innovation technique et de la volonté de l’artiste d’affirmer sa
présence. |


|
Jan Van
Eyck (v 1390-1441)
Peintre flamand né vers 1390 à Maaseik et mort à Bruges en 1441, Jan van
Eyck est une figure majeure de la peinture primitive flamande et du
gothique tardif.
Actif à la cour de Jean de Bavière puis au service de Philippe
le Bon, il est reconnu pour avoir perfectionné la technique de la
peinture à l’huile, atteignant un degré de naturalisme et de précision
inégalé. Il est l’un des premiers artistes à signer ses œuvres. Son
style se caractérise par une minutie extrême dans le rendu des textures,
des visages et des objets, souvent porteurs de symboles religieux
dissimulés. Il est l’auteur de portraits célèbres comme L’Homme au
turban rouge (1433) et de scènes religieuses telles que La Vierge du
chancelier Rolin et La Vierge au chanoine Van der Paele. Il achève en
1432 le retable de L’Agneau mystique à Gand, commencé par son frère
Hubert. Il participe à des missions diplomatiques pour le duc de
Bourgogne, notamment en Espagne et au Portugal. Son Å“uvre marque une
rupture avec l’art médiéval par son réalisme et son usage innovant de la
lumière, influençant durablement la peinture européenne |
La Nef des fous de Jérôme Bosch est une allégorie satirique de la
gourmandise et de la déraison humaine, peinte vers 1500 et conservée au
musée du Louvre.
Ce panneau montre une embarcation instable peuplée de
personnages grotesques et hétéroclites parmi lesquels un moine
franciscain une nonne un fou et plusieurs convives en pleine beuverie
tous s’agitent autour d’un gâteau suspendu à une ficelle et de cerises
convoitées symboles de luxure et d’impudicité un luth posé au centre
renforce cette lecture morale tandis qu’un homme vomit à la proue et
qu’un autre rame avec une cuillère démesurée l’arbre planté au centre du
bateau remplace le mât et sert de perchoir à des figures absurdes la
scène est dépourvue de gouvernail et de voile suggérant une dérive
morale et spirituelle
Le Chariot de foin montre une humanité entière attirée
par un immense tas de foin symbole des biens matériels et de la vanité
terrestre tous les groupes sociaux y compris les religieux et les
puissants s’y précipitent dans une frénésie grotesque ignorant le Christ
qui les observe depuis les cieux la scène centrale est encadrée par la
création d’Adam et Ève à gauche et l’Enfer à droite formant un triptyque
moral sur la chute de l’humanité Bosch critique ici la cupidité
universelle et l’aveuglement spirituel dans une composition foisonnante
et chaotique
|


 |
Jérôme
Bosch (v.1450-1516)
Peintre né vers 1450 à Bois-le-Duc et mort dans la même ville en 1516,
Jérôme Bosch est une figure singulière de la peinture flamande, célèbre
pour son univers fantastique et moralement chargé.
Issu d’une famille de peintres, il adopte le nom abrégé de sa
ville natale comme pseudonyme. Membre de la Confrérie de Notre-Dame, il
bénéficie de commandes prestigieuses et d’une reconnaissance rapide
auprès des élites européennes. Son œuvre se distingue par une
iconographie hallucinée mêlant visions religieuses, satire sociale,
folklore, alchimie et astrologie. Il peint des mondes peuplés de
créatures hybrides, de monstres grotesques et de symboles ambigus,
souvent organisés en triptyques. Sa technique alla prima et son usage de
fonds sombres renforcent l’intensité dramatique de ses compositions.
Parmi ses œuvres majeures figurent Le Jardin des délices, La Nef des
fous, Le Chariot de foin, Le Jugement dernier et La Tentation de saint
Antoine. Son art, à la croisée du gothique tardif et de la Renaissance,
exprime une critique acerbe des passions humaines et de la corruption
morale, tout en ouvrant un espace pictural libre et énigmatique. Il
influence durablement les surréalistes du XXe siècle et reste une énigme
interprétative majeure de l’histoire de l’art.
|
Les Mains en prière dessin à la plume et au lavis bleu
réalisé vers 1508 représente deux mains jointes dans un geste de prière
les doigts fins et les plis du vêtement sont rendus avec une précision
anatomique remarquable ce dessin est à la fois une étude technique et
une image de dévotion il incarne l’humilité la foi et la concentration
spirituelle il est devenu une icône de la piété chrétienne et témoigne
du sens du détail de Dürer
Saint Jérôme dans son étude gravure réalisée en 1514 montre le
savant chrétien assis dans une pièce austère entouré de symboles de
méditation et de savoir un crâne posé sur la table rappelle la vanité
terrestre tandis que les livres la plume et la lumière évoquent la quête
de vérité et la traduction des textes sacrés le lion traditionnel
compagnon de Jérôme est souvent présent dans d’autres versions cette
Å“uvre illustre la solitude studieuse et la contemplation religieuse dans
un style rigoureux et expressif |


 |
Albrecht
Dürer (1471-1528)
Albrecht Dürer est un artiste allemand né à Nuremberg
en 1471 et mort dans la même ville en 1528. Il est considéré comme l’un
des plus grands peintres et graveurs de la Renaissance nordique.
Fils d’un orfèvre originaire de Hongrie, il apprend
très tôt le dessin et la gravure dans l’atelier paternel puis chez le
peintre Michael Wolgemut à Nuremberg.
Il voyage en Europe notamment à Bâle,
Strasbourg, Venise et les
Pays-Bas, où il découvre l’art italien et les principes de la
perspective et des proportions idéales. Influencé par Mantegna,
Bellini et Léonard de Vinci, il
intègre les motifs classiques dans l’art germanique et développe une
œuvre mêlant rigueur mathématique et sens du détail.
Il excelle dans la gravure sur bois et sur cuivre avec des Å“uvres
majeures comme Le Chevalier, la Mort et le Diable,
Saint Jérôme dans sa cellule et Melencolia I.
Ses aquarelles font de lui l’un des premiers paysagistes européens.
Il rédige aussi des traités sur la géométrie, la perspective et les
proportions du corps humain. Il est soutenu par l’empereur
Maximilien Ier et signe ses œuvres d’un monogramme célèbre
A surmontant un D. Son Å“uvre allie
science et spiritualité et marque profondément l’histoire de l’art
occidental. |
La première scène représente la Flagellation du Christ
dans un cadre architectural classique inspiré de la Renaissance
italienne. Au centre, Jésus-Christ est attaché à une
colonne, vêtu d’un simple pagne blanc, le corps incliné dans une posture
de souffrance silencieuse. À sa droite et à sa gauche, deux bourreaux en
mouvement lèvent des fouets ou des bâtons, incarnant la brutalité de
l’acte. Derrière eux, un troisième homme en bleu, au visage impassible,
observe la scène sans intervenir. L’arrière-plan dévoile une
architecture à colonnes et arcs rappelant les constructions d’Urbino,
avec une perspective rigoureuse et un sol en damier qui guide le regard
vers le fond. À droite, trois personnages vêtus à la mode du
Quattrocento discutent dans une cour extérieure, détachés de la
scène centrale, incarnant l’indifférence du monde face à la souffrance.
L’œuvre de Piero della Francesca, peinte entre 1455 et
1460, se distingue par sa lumière douce, sa géométrie parfaite et sa
symbolique complexe mêlant spiritualité, politique et humanisme.
La seconde scène représente le portement de croix par
Jésus-Christ, vêtu de rouge et portant une grande croix en bois
au centre de la composition. Autour de lui se tiennent plusieurs figures
dont des soldats en armure, des moines et des femmes en robes, parmi
lesquelles une femme agenouillée tenant un voile, probablement
Sainte Véronique, et une autre assise au sol levant les yeux
vers lui. L’arrière-plan dévoile une cité médiévale fortifiée avec tours
et remparts, intégrée dans un paysage pastoral de collines et d’arbres
sous un ciel bleu. L’ensemble se distingue par la précision des
vêtements historiques, la richesse architecturale et l’expression grave
des visages, soulignant la solennité du moment et l’intensité
spirituelle de la Passion.
La troisième scène illustre un épisode de la Légende de la Vraie
Croix, centrée sur un arbre majestueux au feuillage dense,
situé au cœur d’une cour entourée d’édifices inspirés de l’architecture
antique et renaissante. Autour de l’arbre, plusieurs personnages vêtus
de tuniques et manteaux d’époque biblique ou médiévale échangent ou
observent, répartis symétriquement de part et d’autre du tronc.
L’ensemble architectural évoque les constructions d’Arezzo,
avec une rigueur géométrique et une perspective maîtrisée. L’œuvre,
peinte entre 1452 et 1466 par Piero della Francesca,
s’inscrit dans un cycle narratif complexe mêlant histoire sacrée,
symbolisme chrétien et idéal humaniste, où chaque figure incarne une
étape de la quête spirituelle autour de la croix du Christ. |



 |
Piero Della
Francesca (v 1416-92)
Piero della Francesca est né vers 1416 à Sansepolcro
en Toscane et mort en 1492 dans la même ville.
Piero di Benedetto de Franceschi dit Piero della
Francesca naît dans une famille aisée son père est marchand
d’étoffes et sa mère issue de la noblesse il reçoit une éducation
soignée incluant algèbre géométrie et comptabilité ce qui nourrit son
double profil de peintre et de mathématicien il apprend d’abord auprès
d’Antonio di Anghiari puis devient apprenti vers 1435
chez Domenico Veneziano à Florence en
1439 il collabore avec lui aux fresques de Sant’Egidio
aujourd’hui détruites en 1442 il revient à Sansepolcro
où il est élu au conseil communal en 1445 il reçoit la commande du
Polyptyque de la Miséricorde pour l’église locale sa
renommée croissante l’amène à travailler dans les cours d’Urbino
Ferrare Bologne et Ancône
en 1451 il est appelé à Rimini par Sigismondo
Malatesta pour décorer la chapelle des reliques du
Temple Malatesta
À partir de 1452 il réalise à Arezzo son œuvre
majeure les fresques de la basilique San Francesco sur
la Légende de la Vraie Croix ce cycle monumental
illustre sa maîtrise de la perspective et de la lumière il poursuit ses
travaux dans diverses villes notamment Rome où il peint
pour Pie II au Vatican et
Urbino où il devient proche du duc Federico da
Montefeltro il compose aussi des traités mathématiques dont
De prospectiva pingendi qui expose les principes de la
perspective appliquée à la peinture
Son style associe rigueur géométrique monumentalité des personnages et
lumière claire influencé par Masaccio Fra
Angelico Domenico Veneziano et Rogier
van der Weyden il développe une peinture immobile solennelle et
profondément humaine Giorgio Vasari et Luca
Pacioli le reconnaissent comme maître de la perspective aux
côtés de Melozzo da Forlì son influence marque l’école
vénitienne ainsi que des architectes comme Bramante et
Raphaël
Piero della Francesca incarne la figure du peintre
mathématicien de la Renaissance italienne sa recherche
de perfection formelle et lumineuse fait de lui un des grands maîtres du
Quattrocento son héritage artistique et théorique
demeure essentiel dans l’histoire de l’art |
Première scène religieuse représentant la Descente de Croix
avec le corps inerte de Jésus-Christ soutenu par
plusieurs figures vêtues de robes aux couleurs variées le torse du
Christ est ceint d’un drap blanc sa tête inclinée porte une
couronne d’épines son visage exprime la souffrance et la paix
les personnages autour de lui manifestent le deuil et la compassion
probablement Marie sa mère en robe bleue et voile blanc
Marie-Madeleine en rouge et d’autres disciples ou
fidèles le fond montre la croix dressée avec une
inscription au sommet les gestes des personnages sont solennels les
regards tournés vers le Christ ou baissés les plis des vêtements sont
détaillés les carnations réalistes la composition est centrée sur le
corps du Christ avec une disposition pyramidale typique de la peinture
du Quattrocento l’ensemble évoque la douleur sacrée et
la piété dans un style classique et équilibré inspiré de la tradition
italienne du XVe siècle
Deuxième scène religieuse représentant l’Annonciation
avec l’Ange Gabriel à gauche ailes déployées et
auréole dorée tendant la main vers la Vierge Marie
assise à droite tête inclinée posture humble auréole fine
au-dessus du front une colombe blanche descend
du ciel symbolisant le Saint-Esprit le fond
architectural présente des colonnes des arcs et un dallage en
perspective un vase de lys blancs posé près de
Marie évoque la pureté le geste de l’ange est solennel le regard
de Marie est recueilli la lumière est douce les couleurs pastel
dominent la scène le style rappelle la peinture du
Quattrocento avec une composition équilibrée et une
symbolique chrétienne forte l’ensemble exprime la paix la grâce
et le mystère de l’incarnation dans une atmosphère méditative et
sacrée
Troisième scène religieuse représentant le Jugement Dernier
avec au centre supérieur Jésus-Christ assis sur un
trône auréolé entouré d’anges et de saints les bras ouverts dans une
posture de jugement en dessous un ange resplendissant sépare les âmes
bénies des âmes damnées à gauche des figures montent vers le ciel
guidées par des anges aux visages sereins à droite des créatures
démoniaques entraînent les damnés vers l’enfer leurs visages expriment
la peur la douleur et la détresse la composition est symétrique et dense
les contrastes entre lumière et obscurité renforcent la tension morale
et spirituelle le style est narratif et détaillé typique de la peinture
chrétienne du Quattrocento chaque personnage est
individualisé les couleurs sont vives les gestes expressifs l’ensemble
illustre la puissance divine la séparation des âmes et l’autorité
céleste dans une vision dramatique et solennelle du salut et de la
damnation |




|
Fra
Angelico (V. 1400-55)
Fra Angelico né Guido di Pietro vers 1400 Ã
Vicchio dans le Mugello près de
Florence mort en 1455 Ã Rome est un
peintre italien du Quattrocento dominicain connu pour
la profondeur spirituelle et la clarté lumineuse de ses œuvres
Guido di Pietro est mentionné pour la première fois en 1417
comme peintre puis il entre au couvent San Domenico de Fiesole
où il prend le nom de Fra Giovanni et devient prêtre en
1427 Ses contemporains le surnomment Fra Angelico en
raison de la religiosité et de la douceur de son art Il est lié au
prieur Antonino Pierozzi futur archevêque de
Florence Dès les années 1420 il réalise des retables et
manuscrits enluminés À partir de 1438 il travaille au couvent
San Marco de Florence restauré par Michelozzo
sous l’impulsion de Cosme de Médicis et y peint un
cycle de fresques destiné à la méditation des moines
Fra Angelico est appelé en 1445 à Rome par le
pape Eugène IV pour décorer la chapelle du Sacrement au
Vatican Il poursuit ensuite ses travaux sous
Nicolas V notamment dans la chapelle Nicoline
Son style associe les principes de la Renaissance comme
la perspective et la représentation réaliste des figures humaines à la
tradition médiévale de la lumière mystique et de la fonction didactique
de l’image Ses œuvres majeures comprennent l’Annonciation de San
Marco et de Cortone ainsi que de nombreux
retables et fresques
Il est décrit par Giorgio Vasari comme un artiste rare
et parfait qui ne prenait jamais ses pinceaux sans prier Après sa mort
il est vénéré comme Beato Angelico et béatifié en 1982
par Jean Paul II sous le nom de Bienheureux
Jean de Fiesole Sa tombe se trouve dans la basilique
Santa Maria sopra Minerva à Rome Fra
Angelico reste une figure essentielle de la première
Renaissance italienne et un modèle d’union entre art et
spiritualité |
Le Miracle de l'esclave (1548) de
Le Tintoret représente
l’intervention spectaculaire de saint Marc,
patron de Venise,
surgissant tête la première du ciel pour sauver un esclave nu
condamné à un supplice public pour avoir vénéré ses reliques
sans l’autorisation de son maître. L’esclave, étendu au
sol, est entouré de bourreaux qui tentent de lui crever les
yeux, briser les jambes et la bouche, mais tous les instruments
se brisent miraculeusement. Le tableau illustre un épisode de la
Légende dorée de Jacques de Voragine, mais
enrichi par Le Tintoret d’éléments dramatiques et
théâtraux inspirés notamment d’un bas-relief de Jacopo
Sansovino. La scène se déroule dans un décor architectural
oriental, baigné d’une lumière provenant de trois sources :
l’avant, l’arrière et l’auréole de Marc. Les
personnages expriment stupeur, agitation et émotion, notamment
le maître assis à droite et les bourreaux désemparés. Le
Tintoret utilise une perspective inversée et une palette de
couleurs vives typique de l’école vénitienne, avec des anatomies
influencées par Michel-Ange. Il se serait lui-même
représenté dans l’homme barbu vêtu de noir à gauche du Turc
au turban rouge. L’œuvre, commandée par la Scuola Grande di
San Marco, est conservée aux Galeries de l’Académie
de Venise
Apollon et Marsyas illustre le mythe antique où
le satyre Marsyas, ayant osé défier le dieu Apollon dans un
concours musical, est puni par un écorchement cruel.
Dans la version du Pérugin (vers 1483), conservée au
Musée du Louvre, Apollon est représenté debout
en contrapposto, les cheveux longs, appuyé sur un bâton, avec sa
lyre suspendue à un tronc et ses attributs posés au sol, tandis
que Marsyas, assis sur un rocher, joue de la flûte, les
cheveux courts, dans une posture dominée. Le paysage en
arrière-plan, baigné de lumière dorée, évoque une ville, un
pont, des collines et un fleuve, avec des oiseaux en vol
symbolisant les cycles naturels. Dans les versions du XVIe
siècle, notamment chez Titien ou De Ribera,
l’accent est mis sur l’écorchement, interprété comme châtiment
divin dans le contexte de la Contre-Réforme, ou comme
libération de l’âme selon la pensée néo-platonicienne.
Le corps de Marsyas, souvent attaché à un arbre, est
représenté dans une tension anatomique extrême, contrastant avec
la beauté froide d’Apollon. Ce thème permet aux
peintres d’explorer la dualité entre beauté et laideur,
spiritualité et souffrance, tout en exhibant leur maîtrise du nu
et de la lumière
Le Corps de saint Marc
ramené à Venise (vers 1564) de Le Tintoret
représente le transfert dramatique des reliques de saint Marc
depuis Alexandrie vers Venise, dans une atmosphère de panique et
de mystère. La scène se déroule dans une architecture
monumentale inspirée de la piazza San Marco, avec des
colonnades et une coupole en arrière-plan, mais baignée d’une
lumière surnaturelle et d’un ciel tourmenté. Le corps du saint
est porté par des Vénitiens dans une ambiance de chaos, tandis
que des figures effrayées fuient ou se prosternent, évoquant la
terreur provoquée par une tempête miraculeuse. Le Tintoret
joue sur les contrastes de lumière et les diagonales pour
accentuer le mouvement et la tension. Les personnages sont
allongés, étirés, parfois fantomatiques, dans une composition
typiquement maniériste. Le tableau, commandé pour la
Scuola Grande di San Marco, illustre la volonté de
glorifier saint Marc comme protecteur de la République,
tout en affirmant la puissance spirituelle et politique de
Venise.
La
quatrième image montre un portrait central représentation en buste de
Le Tintoret avec front large sourcils épais
regard intense nez proéminent et barbe fournie dessinée avec
hachures et lignes fines sur fond sépia
Figure gauche profil de Fra Angelico
en robe dominicaine avec expression recueillie et traits doux
Figure droite visage de Jean Fouquet
en robe sobre avec regard concentré et calotte
Figures inférieures profils de Rogier van der
Weyden et Jan van Eyck avec coiffes
flamandes et expressions graves
Composition centrée sur Le Tintoret entouré de
quatre maîtres de la peinture religieuse du XVe siècle style
graphique inspiré de la Renaissance avec noms
inscrits en capitales sous chaque figure
|

_small1.jpg)

 |
Le Tintoret
(1518-94)
Le Tintoret né Jacopo Robusti en 1518 ou 1519
à Venise mort le 31 mai 1594 dans la même ville est un
peintre majeur de la Renaissance italienne associé au
courant du maniérisme
Fils du teinturier Battista Robusti il reçoit
le surnom de Tintoretto signifiant petit teinturier en
raison de l’activité paternelle Son enfance baigne dans l’univers des
pigments et des couleurs Il aurait été brièvement élève de
Titien mais leur relation conflictuelle l’amène à développer un
style personnel
Il ouvre son atelier à Venise en 1538 et commence par
décorer des meubles et des lambris avant de se consacrer à la peinture
religieuse et historique Son style se caractérise par des compositions
dramatiques une utilisation audacieuse de la lumière et des figures
musclées en mouvement
Il est influencé par le dessin de Michel-Ange et la
couleur de Titien comme en témoigne la devise qu’il
aurait inscrite dans son atelier Il réalise de nombreuses œuvres pour
les églises et les confréries vénitiennes notamment pour la
Scuola Grande di San Rocco où il peint un vaste cycle de
fresques
Parmi ses Å“uvres majeures figurent Le Paradis au
Palais des Doges Suzanne et les vieillards
et Saint Georges et le dragon Il est surnommé
Il Furioso pour son énergie picturale et sa rapidité
d’exécution
Il meurt à Venise en 1594 et est enterré dans l’église
de la Madonna dell’Orto qu’il avait décorée Le
Tintoret est considéré comme un précurseur de l’art baroque et
un maître de la peinture vénitienne du XVIe siècle |
La Tour de Babel,
peinte par Pieter Bruegel l’Ancien en 1563, représente
une gigantesque construction en spirale inspirée de l’architecture
romaine, notamment du Colisée, avec des arches
superposées et des galeries en encorbellement. Le bâtiment domine un
paysage animé où des ouvriers, des charpentiers et des maçons
s’affairent à différentes tâches, illustrant l’effervescence du
chantier. À gauche, le roi Nimrod, vêtu richement,
inspecte les travaux entouré de conseillers, incarnant l’orgueil humain
à l’origine du mythe biblique. Le ciel nuageux et les teintes terreuses
renforcent l’atmosphère dramatique du tableau, tandis que la ville en
contrebas, inspirée de Anvers, fourmille de vie. La
composition met en scène la confusion des langues et la chute de
l’ambition humaine, thème central du récit de la Genèse,
avec une précision architecturale et une richesse narrative typiques du
style de Bruegel
La Rentrée des troupeaux, attribuée Ã
Pieter Bruegel l’Ancien, dépeint une scène pastorale où des
vachers et des paysans ramènent lentement leurs bêtes vers le village Ã
travers un paysage vallonné. Des bovins massifs aux
pelages variés avancent en file, encadrés par des personnages vêtus de
tuniques rustiques, certains munis de bâtons ou de hottes. Le ciel
tourmenté, aux nuées sombres et menaçantes, contraste avec la sérénité
du cortège, annonçant l’arrivée de l’automne. À l’arrière-plan, une
rivière serpente entre les collines, bordée de falaises et de bois
touffus, évoquant les paysages de Flandre. La
composition, riche en détails et en textures, illustre le lien entre
l’homme, l’animal et la nature dans une atmosphère à la fois paisible et
dramatique, typique du style narratif de Bruegel.
La Moisson est un
tableau peint en 1565 par Pieter Bruegel l’Ancien, conservé au
Metropolitan Museum of Art à New York, et appartenant à une série de six
œuvres consacrées aux saisons.
La scène représente le plein été, correspondant au mois d’août
et probablement aussi à septembre, période des fruits mûrs dans les
calendriers flamands. L’œuvre déploie un vaste paysage champêtre où les
paysans fauchent les blés sous un soleil écrasant. Au premier plan,
certains travailleurs se reposent à l’ombre, d’autres mangent ou
dorment, tandis que des servantes transportent des gerbes vers un
chariot. Une cruche est posée au frais dans les blés, deux cailles
s’envolent effrayées par les faucheurs, et un étang accueille des
baigneurs. Plus loin, un verger chargé de fruits borde un pacage de
village où des joueurs s’ébattent. L’ensemble traduit la richesse de la
saison, la dureté du labeur et la vitalité de la vie rurale. La
composition associe une observation minutieuse des gestes quotidiens Ã
une vision panoramique de la campagne flamande, inscrivant l’activité
humaine dans le cycle naturel. |
_-_Google_Art_Project_-_edited_small.jpg)
_small.jpg) 
 |
Pieter
Bruegel l'Ancien (V. 1525-69)
Pieter Bruegel l'Ancien naît vers 1525 probablement près de
Breda dans les anciens Pays-Bas espagnols bien que le
lieu exact reste incertain il est actif à Anvers dès
1551 où il devient maître de la guilde de Saint-Luc il voyage en
Italie entre 1552 et 1553 jusqu’à Rome
réalisant des dessins de paysages alpins et siciliens qui influenceront
son œuvre à son retour il travaille pour l’éditeur Hieronymus
Cock et se lie avec le marchand Hans Franckert
avec qui il fréquente les fêtes villageoises déguisé en paysan pour
observer les mœurs rustiques il épouse en 1563 la fille de
Pieter Coecke van Aelst son ancien maître et s’installe Ã
Bruxelles où il meurt le 9 septembre 1569 il est le
père de Pieter Bruegel le Jeune et de Jan
Bruegel l’Ancien tous deux peintres son œuvre se distingue par
une vision satirique et philosophique du monde inspirée de Bosch
mais plus humaniste il peint des scènes de la vie paysanne comme Les
Chasseurs dans la neige ou Le Repas de noces mais aussi
des allégories morales comme La Parabole des aveugles ou La
Tour de Babel son style mêle observation minutieuse du réel et
symbolisme profond influencé par Érasme Lucrèce
et Héraclite il est considéré comme l’un des maîtres de
la Renaissance flamande
|
|
La Vierge et l’Enfant dans un paysage du soir est une huile sur
toile peinte entre 1562 et 1565 par Titien,
conservée à l’ Alte Pinakothek
de Munich. Cette œuvre tardive du maître vénitien représente
la Vierge Marie assise dans un paysage crépusculaire,
tenant sur ses genoux l’enfant Jésus nu qui lève les
bras vers son visage. Le ciel embrasé par le soleil couchant diffuse une
lumière chaude sur les deux figures, accentuant leur intimité et leur
douceur. Le contraste entre les tons dorés du crépuscule et les ombres
du paysage en arrière-plan crée une atmosphère à la fois sereine et
dramatique. Les vêtements de Marie, rouge et bleu, sont
rendus avec des touches larges et vibrantes, typiques du style tardif de
Titien, qui privilégie la matière picturale et les
effets de lumière. Le paysage, avec son arbre silhouetté et ses collines
lointaines, encadre la scène sans la distraire, renforçant le sentiment
de recueillement. Cette composition illustre la capacité de
Titien à sublimer un thème religieux classique par une approche
émotionnelle et picturale profondément humaine
La Femme au miroir, est une huile sur toile peinte vers 1515
par Titien, conservée au
musée du Louvre à Paris.
Cette œuvre emblématique de la jeunesse de Titien
représente une jeune femme vue en buste, dans une posture dynamique de
trois quarts, en train d’arranger ses cheveux devant un miroir tenu par
un homme. Le personnage féminin, aux longs cheveux blonds-roux, dévoile
ses épaules et son bras dans une mise en scène sensuelle et intimiste.
Le miroir convexe, d’origine flamande, reflète l’espace intérieur et
accentue la profondeur de la composition. Le jeu de clair-obscur, les
courbes du visage, du miroir et de la chevelure, ainsi que les couleurs
bleu, vert et rose, confèrent à l’ensemble une douceur et une harmonie
caractéristiques de l’école vénitienne. L’identité des personnages reste
inconnue, bien que des hypothèses aient évoqué Alphonse Ier
d’Este, Laura Dianti, ou Frédéric II
Gonzague et Isabella Boschetti, toutes
aujourd’hui abandonnées. L’œuvre oscille entre portrait, scène de genre
et allégorie, certains y voyant une vanité illustrant les atteintes du
temps sur la beauté humaine
La Vénus d’Urbin est une huile sur toile peinte en 1538 par
Titien, conservée à la Galerie
des Offices de Florence.
Commandée par Guidobaldo II della Rovere, duc
d’Urbin, cette œuvre représente une jeune femme nue allongée sur un lit,
dans une pose frontale et détendue, tenant un bouquet de fleurs dans la
main droite et regardant le spectateur avec assurance. À l’arrière-plan,
deux servantes fouillent dans un coffre, tandis qu’une fenêtre laisse
entrer la lumière du jour. Le corps de la femme est baigné d’une lumière
douce qui accentue les courbes et la carnation, tandis que les drapés
rouges et blancs renforcent la sensualité de la scène. Le tableau mêle
idéalisation mythologique et portrait réaliste, certains y voyant une
allégorie du mariage, de la fidélité et de la fécondité, renforcée par
la présence du chien couché au pied du lit. L’œuvre marque une étape
décisive dans la représentation du nu féminin, influençant durablement
la peinture occidentale, notamment Édouard Manet avec
Olympia. |



_–_Gemäldegalerie,_Berlin_small.jpg) |
Titien
(1488-1576)
Titien né entre 1488 et 1490 à Pieve di Cadore
dans la république de Venise est issu d’une famille
aisée son père Gregorio Vecellio exerce des fonctions
publiques dès l’âge de dix ans Titien est envoyé Ã
Venise où il commence sa formation chez le mosaïste
Sebastiano Zuccato puis entre dans l’atelier de
Gentile Bellini et surtout de Giovanni Bellini
il se lie d’amitié avec Giorgione avec qui il collabore
notamment aux fresques du Fondaco dei Tedeschi en 1508
après la mort de Giorgione en 1510 Titien
devient son héritier artistique et termine plusieurs de ses œuvres en
1511 il peint des fresques à Padoue et en 1516 succède
à Giovanni Bellini comme peintre officiel de la
république de Venise son atelier attire de nombreux
artistes dont Le Tintoret et Le Greco
il épouse Cecilia Soldano en 1525 avec qui il a trois
enfants dont Pomponio et Orazio il
fréquente les cours de Ferrare Mantoue
et Urbin et devient le portraitiste des princes en 1530
il peint Charles Quint à Bologne puis
à Augsbourg en 1548 où il est nommé comte et chevalier
il travaille aussi pour Paul III Farnèse et entretient
une amitié avec L’Arétin et Sansovino
en 1545 il séjourne à Rome accueilli par
Michel-Ange son Å“uvre couvre les genres religieux mythologiques
et profanes avec une maîtrise exceptionnelle du coloris il meurt Ã
Venise le 27 août 1576 victime de la peste et est
enterré à Santa Maria dei Frari sa peinture influence
durablement Rubens Velázquez et les
maîtres du XVIIe siècle |
Le Portrait du pape Jules II peint par
Raphaël entre 1511 et 1512 est une huile sur bois
à mi-corps représentant le pontife assis sur un fauteuil richement orné
vêtu d’un surplis blanc et d’une mozzetta pourpre avec un camauro rouge
sur la tête tenant un mouchoir dans sa main droite dans une posture
méditative et mélancolique l’arrière-plan vert sombre accentue
la solennité du personnage et la profondeur psychologique de l’œuvre qui
tranche avec les portraits pontificaux traditionnels plus cérémoniels
selon Giorgio Vasari le réalisme du tableau provoquait chez les
spectateurs une émotion intense comme s’ils voyaient le pape vivant
lui-même cette représentation marque une rupture dans l’iconographie
papale influençant durablement les portraits d’autorité le tableau fut
initialement exposé dans l’église Santa Maria del Popolo Ã
Rome avant d’être déplacé et intégré à la collection Borghèse
puis acquis par la National Gallery de Londres où il
est aujourd’hui conservé
Jules II ordonnant les travaux du Vatican et de saint Pierre à Bramante
Michel-Ange et Raphaël est une composition historique allégorique qui
célèbre l’élan artistique et architectural impulsé par le pape dans le
cadre de la Renaissance romaine le tableau montre le pontife
assis sur un trône au centre de la scène entouré des trois maîtres qu’il
a convoqués pour transformer Rome en capitale spirituelle et artistique
de la chrétienté Donato Bramante architecte du projet
initial de la basilique Saint-Pierre est représenté
avec des plans et instruments Michel-Ange Buonarroti
sculpteur et peintre de la Chapelle Sixtine est figuré
avec une posture énergique et concentrée tandis que Raphaël
Sanzio jeune peintre des Chambres du Vatican
incarne la grâce et l’harmonie le décor monumental avec colonnes et
voûtes évoque les ambitions du nouveau Vatican voulu par Jules
II della Rovere dont le regard sévère et la gestuelle
déterminée traduisent la volonté politique et spirituelle de réformer
l’Église par l’art la scène synthétise l’union du pouvoir religieux et
du génie artistique dans une vision humaniste et triomphante de la
papauté.
Sainte Catherine d’Alexandrie peinte par
Raphaël vers 1507 est une huile sur bois de
peuplier mesurant 71 × 55 cm conservée à la
National Gallery de Londres
la sainte est représentée debout dans un paysage lacustre le regard
tourné vers le ciel dans une posture en contrapposto inspirée du
Pérugin et de Léonard de Vinci elle est vêtue d’une robe
bleue et d’un manteau rouge avec une ceinture dorée sa main droite posée
sur sa poitrine exprime l’extase mystique tandis que sa main gauche
repose sur la roue dentée symbole de son martyre les lignes courbes des
bras et des vêtements créent un rythme sinueux et gracieux la lumière
céleste éclaire son visage et accentue la spiritualité de la scène cette
œuvre marque une phase transitoire entre le séjour florentin et le début
de la période romaine de Raphaël elle témoigne de son intérêt
pour la passion religieuse et la beauté idéale un dessin préparatoire
avec piqûres de transfert est conservé au Musée du Louvre
confirmant l’attribution à Raphaël cette peinture a inspiré des
artistes et même des musiciens comme le groupe The Smashing Pumpkins
qui l’a utilisée pour la couverture de leur album Mellon Collie and
the Infinite Sadness.
|



 |
Raphaël
Sanzio (1483-1520)
Raphaël Sanzio né le 6 avril 1483 Ã
Urbino dans les Marches italiennes est le fils
du peintre Giovanni Santi il se forme très jeune dans
l’atelier du Pérugin à Pérouse où il
développe un style clair harmonieux et équilibré dès 1504 il s’installe
à Florence influencé par Léonard de Vinci
Michel-Ange et Botticelli il y peint
de nombreuses madones et portraits marqués par la grâce et la douceur en
1508 il est appelé à Rome par le pape Jules II
pour décorer les Chambres du Vatican notamment la
célèbre fresque de L’École d’Athènes qui incarne l’idéal
humaniste de la Renaissance il devient ensuite
architecte en chef de la basilique Saint-Pierre sous le
pontificat de Léon X et réalise aussi des tapisseries
pour la Chapelle Sixtine son atelier très structuré
produit de nombreuses œuvres à partir de ses dessins il entretient une
relation avec Margherita Luti représentée dans La
Fornarina il meurt prématurément à Rome le 6 avril
1520 à l’âge de 37 ans laissant inachevée La Transfiguration
son influence est immense sur les académies des beaux-arts et sur des
artistes comme Giulio Romano Nicolas Poussin
et Ingres il est enterré au Panthéon de Rome
considéré comme l’un des maîtres absolus de la Haute Renaissance
pour sa capacité à incarner l’idéal néoplatonicien de la grandeur
humaine |
L’Esclave mourant sculpté par Michel-Ange
Buonarroti entre 1513 et 1515 est une statue en
marbre haute de 2,28 mètres conservée au Musée du
Louvre à Paris
elle représente un jeune homme nu dans une posture sinueuse la tête
inclinée les yeux clos le bras gauche levé dans un geste d’abandon et le
droit replié sur le torse le corps semble à la fois s’éveiller et
s’éteindre exprimant une tension entre vie et mort cette œuvre devait
initialement orner le soubassement du tombeau du pape Jules II
dans la basilique Saint-Pierre de Rome mais fut
écartée du projet final en 1542 selon Giorgio Vasari et
Ascanio Condivi elle symboliserait soit les provinces soumises Ã
l’autorité pontificale soit les arts affligés par la mort du pape le
style incarne le mouvement non finito où certaines parties
restent volontairement inachevées pour suggérer l’émergence de la forme
depuis la matière en 1546 Michel-Ange offre la statue à son ami
Roberto Strozzi qui l’offre ensuite au roi François Ier
elle passe par les collections de Henri II puis du connétable
Anne de Montmorency avant d’être saisie à la Révolution et
transférée au Louvre en 1794 cette Å“uvre est souvent associée Ã
L’Esclave rebelle également conservée au Louvre et
incarne la puissance expressive du corps humain dans la sculpture de la
Haute Renaissance.
Moïse est représenté assis tenant les tables de la Loi son visage
est grave et concentré ses sourcils froncés accentuent l’intensité de
son regard sa barbe longue et ondulée descend jusqu’à sa poitrine ses
cheveux sont courts et bouclés deux petites cornes émergent de son front
selon une interprétation médiévale du texte hébreu ses bras puissants
sont tendus l’un retenant les tables l’autre posé sur sa cuisse sa robe
ample sculptée avec précision révèle les plis et la tension du tissu ses
jambes sont croisées dans une posture dynamique son torse musclé et ses
veines saillantes témoignent de la maîtrise anatomique de
Michel-Ange Buonarroti la statue en marbre blanc se trouve dans
l’église San Pietro in Vincoli à Rome
elle incarne la force spirituelle et la colère contenue du prophète
biblique selon la tradition chrétienne Moïse est le
législateur et guide du peuple hébreu libéré d’Égypte l’œuvre est
considérée comme l’un des chefs-d’œuvre de la sculpture de la
Renaissance italienne
La Pietà sculptée par Michel-Ange Buonarroti
entre 1498 et 1499 représente la Vierge Marie tenant le
corps sans vie de Jésus-Christ après la crucifixion
l’œuvre en marbre blanc est située dans la basilique
Saint-Pierre au Vatican le visage de
Marie est jeune serein et empreint de douleur contenue ses yeux
baissés expriment une acceptation silencieuse son voile et sa robe sont
finement sculptés avec des plis profonds et réalistes le corps de
Jésus repose sur ses genoux son bras droit pend
mollement sa tête inclinée vers l’arrière révèle les traits apaisés de
la mort ses muscles et veines sont rendus avec une précision anatomique
remarquable la composition en pyramide donne stabilité et équilibre Ã
l’ensemble la douceur des formes contraste avec la tragédie du sujet
l’œuvre incarne l’idéal de beauté et de compassion de la
Renaissance italienne tout en exprimant une profonde
spiritualité chrétienne. |



 |
Michel-Ange
Buonarroti (1475-1564)
Michel-Ange Buonarroti né le 6 mars 1475 à Caprese
en Toscane est élevé à Florence où il
entre très jeune dans l’atelier de Domenico Ghirlandaio
puis est accueilli au jardin des Médicis par Lorenzo de Médicis
qui lui ouvre les portes de l’humanisme florentin influencé par
Marsile Ficin et Savonarole il sculpte dès
1496 à Rome la célèbre Pietà pour
Saint-Pierre puis revient à Florence où il
réalise le monumental David en marbre en 1504 en 1508 il est
appelé par le pape Jules II pour peindre la voûte de la
Chapelle Sixtine qu’il achève en 1512 avec plus de
trois cents figures bibliques dans une composition cosmique et
tourmentée en 1536 il revient pour peindre le Jugement dernier
sur le mur d’autel dans un style plus dramatique marqué par la crise
religieuse et personnelle il est aussi architecte du tombeau de
Jules II du projet de Saint-Pierre de Rome et
du palais des Médicis à Florence son
œuvre sculptée peinte et architecturale incarne la puissance expressive
du corps humain et la tension spirituelle de la Renaissance
il meurt à Rome le 18 février 1564 et est enterré Ã
Santa Croce à Florence considéré comme
l’un des plus grands génies de l’art occidental. |
Le Crucifiement de saint Pierre peint par
Michelangelo Merisi dit Le Caravage vers 1600 représente le
martyre de l’apôtre selon les Actes apocryphes il est cloué sur une
croix inversée la tête en bas car il se juge indigne de mourir comme
Jésus-Christ la scène se déroule dans un décor sombre
et dépouillé trois bourreaux soulèvent la croix dans un effort visible
leurs corps sont tendus et musclés contrastant avec la vieillesse de
Pierre dont le visage exprime douleur et résignation
son regard est tourné vers l’autel hors champ indiquant la voie du salut
selon la théologie de la Contre-Réforme la lumière
dramatique éclaire les corps et les visages accentuant le réalisme et la
tension la composition en spirale donne une impression de mouvement
ascendant autour de la croix l’œuvre est conservée dans l’église
Santa Maria del Popolo à Rome dans la chapelle
Cerasi elle fait pendant à la Conversion de
saint Paul et s’inscrit dans le style baroque italien par son
intensité émotionnelle et son naturalisme
Le Petit Bacchus malade peint par Michelangelo Merisi
dit Le Caravage vers 1593 représente un jeune homme assis
partiellement vêtu d’un drapé blanc son corps légèrement tourné vers la
gauche son regard fixe et mélancolique dirigé vers le spectateur ses
cheveux noirs bouclés sont ornés d’une couronne de feuilles de vigne son
teint est pâle ses lèvres légèrement entrouvertes suggèrent une
faiblesse physique sur le rebord devant lui sont posés deux pêches et
une grappe de raisins noirs symboles de la déchéance et de la sensualité
la lumière rasante met en valeur les volumes du corps et les textures
des fruits le fond sombre accentue la présence du personnage et renforce
l’atmosphère de malaise l’œuvre est interprétée comme une allégorie de
la maladie ou de la décadence dans un style naturaliste propre au début
du baroque italien elle témoigne de la maîtrise précoce
de Le Caravage dans le rendu du réel et l’expression
des émotions humaines.
Le Garçon avec un panier de fruits peint par
Michelangelo Merisi dit Le Caravage vers 1593 représente un
jeune homme aux cheveux noirs bouclés vêtu d’un drapé clair tombant sur
l’épaule son visage est tourné vers le spectateur avec une expression
douce et légèrement mélancolique il tient dans ses bras un grand panier
débordant de fruits mûrs dont des raisins des pommes des pêches des
figues et une grenade les textures sont rendues avec un réalisme
saisissant chaque fruit est détaillé avec ses imperfections et ses
reflets la lumière éclaire le visage et le panier en contraste avec le
fond sombre typique du clair-obscur caravagesque le corps du garçon est
légèrement incliné vers la gauche ses bras tendus soutiennent le poids
du panier sa peau est lisse et lumineuse évoquant la jeunesse et la
sensualité l’œuvre est interprétée comme une étude de nature morte et de
portrait elle témoigne de la maîtrise précoce de Le Caravage
dans le rendu du réel et la captation de la lumière elle est conservée Ã
la Galerie Borghèse à Rome et
constitue un jalon important du baroque italien. |

 
 |
Caravage
(v.1571-1610)
Caravage né le 29 septembre 1571 à Milan
sous le nom de Michelangelo Merisi da Caravaggio est
formé auprès de Simone Peterzano à partir de 1584 puis
s’installe à Rome vers 1592 où il débute comme
assistant du peintre Giuseppe Cesari dit le Cavalier d’Arpin
il se fait remarquer par des œuvres de jeunesse comme Garçon avec un
panier de fruits ou Les Musiciens et attire l’attention du
cardinal Francesco Maria del Monte qui devient son
mécène grâce à lui il reçoit des commandes prestigieuses pour les
églises romaines notamment La Vocation de saint Matthieu et
La Conversion de saint Paul ses tableaux révolutionnent la peinture
par l’usage dramatique du clair-obscur et le réalisme parfois brutal de
ses figures il connaît une célébrité fulgurante au début des années 1600
mais son tempérament violent le conduit à de nombreux démêlés
judiciaires en 1606 il tue en duel Ranuccio Tomassoni
et doit fuir Rome il mène ensuite une vie errante entre Naples
Malte et la Sicile poursuivant son
œuvre avec des chefs-d’œuvre comme La Décollation de saint
Jean-Baptiste ou La Résurrection de Lazare en 1608 il est
fait chevalier de l’ordre de Saint-Jean de Jérusalem
mais en est rapidement exclu à cause de ses excès en 1610 il tente de
revenir à Rome pour obtenir la grâce pontificale mais meurt le 18
juillet à Porto Ercole à l’âge de 38 ans probablement
des suites de la malaria son style novateur influence durablement
l’école caravagesque et des peintres tels que Rubens
Rembrandt Georges de La Tour et
Artemisia Gentileschi il est considéré comme l’un des
grands maîtres du baroque dont l’art marie intensité
dramatique et vérité humaine |
|
La Sainte Famille à l’escalier peinte par
Nicolas Poussin vers 1648 représente la Vierge Marie
vêtue de rouge et de bleu tenant l’enfant Jésus au
centre de la composition à gauche une femme en jaune assise tend les
bras vers un autre enfant identifié comme Jean-Baptiste
qui s’approche de Jésus dans un geste affectueux Ã
droite un homme en brun assis dans l’ombre est interprété comme
Joseph le fond architectural est composé de colonnes et d’un
ciel nuageux visible à travers une ouverture la lumière éclaire les
figures principales en soulignant les drapés et les expressions le style
classique de Poussin se manifeste par la rigueur de la
composition la clarté des gestes et la symbolique religieuse l’œuvre
incarne l’harmonie familiale et la préfiguration du destin christique
dans une atmosphère méditative propre à la peinture du Grand
Siècle français elle est conservée au Musée du Louvre
à Paris. Le Jugement de Salomon
représente le roi Salomon assis sur un trône surélevé
vêtu d’un manteau rouge levant une main pour ordonner au soldat de
trancher l’enfant au centre de la scène un soldat tient un bébé dans une
main et une épée dans l’autre prêt à exécuter l’ordre deux femmes se
tiennent à ses côtés l’une agenouillée implore la clémence l’autre reste
debout indifférente le sol est dallé les colonnes encadrent la scène
dans une architecture solennelle la lumière éclaire les visages et les
gestes révélant la tension dramatique le regard du roi est grave et
pénétrant les expressions des femmes traduisent la douleur et la
duplicité l’œuvre illustre la sagesse du roi qui reconnaît la vraie mère
par son sacrifice elle incarne la justice divine et la capacité de
discernement dans la tradition biblique elle est souvent représentée
dans l’art classique pour sa portée morale et politique.
L’Institution de l’Eucharistie représente Jésus-Christ
entouré de ses disciples lors de la Cène dans un
intérieur architectural sobre éclairé par une lumière douce
Jésus au centre vêtu de rouge et de bleu tend les bras vers le
pain et la coupe posés sur la table son regard est grave et tourné vers
le ciel les apôtres répartis autour de la table expriment la surprise la
méditation ou la dévotion certains se penchent vers lui d’autres se
retirent dans le silence la table est couverte d’un linge blanc avec
quelques mets simples le fond est composé de colonnes et d’un ciel
nocturne visible par une ouverture la composition est centrée sur le
geste de consécration du pain et du vin symbole du corps et du sang du
Christ l’œuvre illustre le moment fondateur du sacrement de
l’eucharistie dans la tradition chrétienne elle incarne la solennité du
mystère et la communion spirituelle entre le maître et ses disciples
elle est souvent représentée dans l’art religieux du baroque
italien et du classicisme français pour sa
portée théologique et liturgique. |

_small.jpg)

 |
Nicolas
Poussin (1594-1665)
Nicolas Poussin né en juin 1594 au hameau de Villers près des
Andelys en Normandie est le fils de
Jean Poussin et de Marie de Laisement
il montre très tôt un talent pour le dessin encouragé par le peintre
Quentin Varin il se forme ensuite à Rouen
auprès de Noël Jouvenet puis à Paris
dans l’atelier de Georges Lallemand où il découvre les
gravures d’après Raphaël et les décors de l’école de
Fontainebleau vers 1622 il reçoit ses premières
commandes religieuses et rencontre le poète italien Gian
Battista Marino qui l’introduit dans les cercles artistiques
romains en 1624 il part pour Rome où il s’installe
définitivement il obtient la protection du cardinal Barberini
et de Cassiano dal Pozzo et réalise des œuvres majeures
comme Le Martyre de saint Erasme il développe un style
classique nourri de références antiques et bibliques et privilégie les
tableaux de chevalet destinés à des amateurs éclairés en 1630 il épouse
Anne-Marie Dughet sœur du peintre Gaspard
Dughet en 1640 il est appelé à Paris par
Louis XIII et devient premier peintre du roi mais il
préfère retourner à Rome en 1642 où il poursuit sa
carrière jusqu’à sa mort le 19 novembre 1665 il est enterré dans la
basilique San Lorenzo in Lucina son œuvre composée de
plus de deux cents tableaux et de nombreux dessins illustre le
classicisme français et exerce une influence durable sur des artistes
comme Jacques-Louis David et Ingres
considéré comme un peintre philosophe il incarne l’idéal de mesure et de
raison dans l’art du XVIIe siècle |
|
|
Georges de la Tour (1593-1652) |
|
|
Peter Paul Rubens (1577-1640) |
|
|
Diego Velasquez (1599-1660) |
La Jeune Fille à la perle peinte par Johannes
Vermeer vers 1665 représente une jeune femme tournée de trois
quarts vers la gauche son visage éclairé se détache sur un fond sombre
ses yeux grands et brillants fixent le spectateur ses lèvres légèrement
entrouvertes suggèrent une parole suspendue elle porte un turban bleu et
jaune noué autour de la tête dont une partie tombe sur son épaule sa
peau est lisse et lumineuse son vêtement brun est simple sans ornement
la perle accrochée à son oreille gauche est volumineuse et reflète la
lumière avec subtilité la composition est épurée centrée sur le visage
et le bijou la lumière douce modèle les formes avec délicatesse l’œuvre
est souvent qualifiée de Mona Lisa du Nord pour son
mystère et son intensité elle incarne l’art du baroque
hollandais par son usage du clair-obscur et sa recherche de
l’intimité elle est conservée au Mauritshuis Ã
La Haye et demeure l’un des portraits les plus célèbres de
l’histoire de la peinture.
La Laitière peinte par Johannes Vermeer vers
1658 représente une femme debout versant du lait dans un récipient posé
sur une table elle porte une coiffe blanche un corsage jaune un tablier
bleu et une jupe rouge son visage concentré exprime la sérénité et la
dignité du travail quotidien la lumière naturelle venant d’une fenêtre Ã
gauche éclaire la scène avec douceur révélant les textures du pain du
tissu et de la céramique la table recouverte d’un linge bleu accueille
un panier de pain une cruche et divers ustensiles de cuisine le mur du
fond est nu avec quelques clous et une corbeille suspendue la
composition est simple mais équilibrée centrée sur le geste du versement
le réalisme minutieux et le jeu subtil de lumière font de cette œuvre un
chef-d’œuvre du baroque hollandais elle célèbre la
beauté du geste humble et la noblesse de la vie domestique elle est
conservée au Rijksmuseum à Amsterdam.
La liseuse à la fenêtre peinte par Johannes Vermeer
vers 1657 représente une jeune femme debout près d’une fenêtre ouverte
lisant une lettre son visage est éclairé par la lumière naturelle qui
entre par la gauche révélant son expression concentrée et intime elle
porte un corsage jaune à manches courtes avec un col blanc ses cheveux
sont relevés en chignon derrière elle un rideau vert est tiré sur le
côté dévoilant un tableau mural représentant Cupidon
symbole de l’amour le mur est nu et légèrement ombré la table recouverte
d’un tissu richement décoré accueille un plat une carafe et quelques
objets domestiques la composition est équilibrée entre la lumière le
silence et la tension émotionnelle l’œuvre incarne la maîtrise du
clair-obscur et la subtilité psychologique du baroque hollandais
elle est conservée à la Gemäldegalerie Alte Meister de
Dresde et illustre la capacité de Vermeer
à capturer l’intimité et la profondeur des scènes quotidiennes. |


_small.jpg)
 |
Jan
Vermeer (1632, 75)
Jan Vermeer né le 31 octobre 1632 à Delft est
le fils de Reijnier Janszoon Vermeer aubergiste et
marchand d’art et de Digna Baltus il grandit dans un
milieu artisanal et commerçant qui lui donne accès au monde artistique
il se forme probablement auprès de Leonaert Bramer ou
de Carel Fabritius et en 1653 il est admis à la guilde
de Saint-Luc de Delft la même année il épouse
Catharina Bolnes issue d’une famille catholique aisée et
s’installe dans la maison de sa belle-mère Maria Thins
le couple aura quinze enfants dont plusieurs meurent en bas âge
Vermeer peint environ trente-quatre œuvres connues aujourd’hui
parmi lesquelles La Laitière La Jeune fille à la perle
La Vue de Delft et L’Astronome il se spécialise dans
les scènes de genre intimistes représentant des intérieurs domestiques
baignés d’une lumière subtile et d’une atmosphère silencieuse son style
influencé par l’école caravagesque d’Utrecht et par
Pieter de Hooch se distingue par une maîtrise
exceptionnelle de la perspective et du coloris il bénéficie du soutien
de mécènes comme Pieter Claesz van Ruijven mais sa
notoriété reste limitée à Delft et aux Provinces-Unies
de son vivant en 1672 la guerre de Hollande provoque une crise
économique qui affecte gravement le marché de l’art et plonge
Vermeer dans des difficultés financières il meurt le 15
décembre 1675 à Delft à l’âge de 43 ans et est enterré
dans l’Oude Kerk oublié après sa mort il est
redécouvert au XIXe siècle grâce au critique Théophile
Thoré-Burger et est aujourd’hui considéré avec
Rembrandt et Frans Hals |
|