|
| |
|
Description des illustrations |
Illustration |
|
|
L’ellipsoïde de révolution : légèrement aplati aux
pôles et renflé à l’équateur, conséquence directe de la rotation
terrestre.
Le géoïde : surface irrégulière qui tient compte
des variations du champ gravitationnel et du relief terrestre, utilisée
en géodésie pour les mesures de précision.
|

|
La forme de la terre
La forme de la Terre est celle d’un ellipsoïde légèrement aplati
aux pôles et renflé à l’équateur. Cette forme résulte de la rotation de la
planète sur elle-même qui provoque une force centrifuge plus importante à
l’équateur qu’aux pôles. On parle plus précisément de géoïde pour désigner la
forme réelle de la Terre qui tient compte des irrégularités du champ
gravitationnel et des reliefs. Le géoïde correspond à la surface moyenne des
océans prolongée sous les continents et perpendiculaire en tout point à la
direction de la pesanteur. Cette forme complexe est utilisée en géodésie pour
les mesures précises de position et d’altitude. Ainsi bien que la Terre paraisse
sphérique à grande échelle sa forme réelle est légèrement irrégulière et adaptée
aux contraintes physiques de sa structure et de sa rotation. |
|
1. Vue générale du
système géocentrique Une représentation du cosmos antique avec la Terre
immobile au centre et les sphères célestes tournant autour.
2. Portrait de Claude Ptolémée Une évocation artistique du savant antique
avec des instruments comme l’astrolabe et la sphère armillaire.
3. Utilisation médiévale du modèle Scène montrant un astronome médiéval
utilisant le modèle de Ptolémée pour prédire les positions des astres à l’aide
de manuscrits et outils anciens.
|


 |
Le
modèle de Ptolémée
Le modèle de Ptolémée place la Terre immobile au centre de l’Univers
avec les astres tournant autour d’elle selon des cercles parfaits. Ce système
géocentrique élaboré au IIe siècle par Claude Ptolémée repose sur l’idée que la
Terre est le centre du cosmos et que tous les corps célestes y sont liés par des
mouvements circulaires. Pour expliquer les trajectoires complexes des planètes
il introduit les notions de déférents et d’épicycles. Les déférents sont de
grands cercles autour de la Terre et les épicycles sont de petits cercles que
les planètes parcourent en même temps que leur centre se déplace sur le
déférent. Ce modèle permettait de prédire les positions des astres avec une
précision raisonnable pour l’époque. Il a dominé la pensée astronomique pendant
plus de mille ans influençant la science et la philosophie médiévales. Ce
système a été remis en question à la Renaissance avec l’apparition du modèle
héliocentrique de Copernic qui place le Soleil au centre du système solaire. Le
modèle de Ptolémée reste un exemple historique de tentative d’explication du
mouvement des astres par des moyens géométriques et sans connaissance des lois
physiques sous-jacentes |
|
Le premier croquis montre
une galaxie remplie d’étoiles pour illustrer leur abondance dans l’univers.
Le deuxième représente le cycle de vie des étoiles, depuis la nébuleuse
jusqu’aux stades finaux comme la naine blanche, l’étoile à neutrons ou le trou
noir.
Le troisième illustre l’interaction gravitationnelle entre galaxies,
évoquant leur danse cosmique.
Le quatrième montre un faisceau lumineux traversant l’espace, symbolisant le
voyage de la lumière à travers l’univers.
Le cinquième présente des étoiles en combustion, en explosion et en
renaissance, soulignant les processus dynamiques de l’évolution stellaire.
Le sixième évoque le théâtre cosmique avec des planètes et des lunes lointaines
et cachées.
Le septième montre une scène spatiale sombre et silencieuse, mettant en avant le
calme de l’univers.
Le huitième croquis célèbre la beauté poétique du cosmos avec une scène
colorée et éclatante. |

|
Des
myriades et des myriades d'étoiles
Des myriades et
des myriades d’étoiles dans l’univers une profusion scintillante qui défie le
vide chaque point lumineux une histoire une naissance une mort une danse
gravitationnelle dans l’immensité sidérale elles peuplent les galaxies en
spirales en amas en filaments tissés dans le tissu cosmique leur lumière voyage
des milliards d’années pour atteindre nos yeux témoins minuscules d’un spectacle
ancien et infini elles brûlent elles explosent elles s’effondrent elles
renaissent forgeant les éléments de la vie dans leur cœur incandescent et
pourtant malgré leur nombre incalculable l’univers reste vaste sombre silencieux
un théâtre où la lumière lutte contre l’oubli et où chaque étoile rappelle que
même dans l’immensité il y a des foyers de chaleur et de beauté. |
|
La première image
représente l’histoire de l’univers sous forme de cône temporel partant du Big
Bang et s’élargissant vers le présent et le futur, avec des étapes clés comme
l’inflation, le fond diffus cosmologique, les âges sombres, la formation des
galaxies et l’expansion accélérée. La deuxième image montre une structure
galactique centrée sur une source lumineuse bleue, entourée de corps célestes en
orbite dans un motif spiralé, le tout sur un fond spatial quadrillé évoquant la
courbure de l’espace-temps. La troisième image illustre l’expansion de l’univers
depuis le Big Bang, avec un cône coloré allant du rouge au bleu, traversé par
des galaxies et des étoiles, et surmonté d’un quadrillage symbolisant la
structure dynamique de l’espace-temps.
|


 |
L'Univers est surtout vide
L’éloignement des objets qui composent l’univers est une conséquence de
l’expansion cosmique. Depuis le Big Bang, l’espace lui-même se dilate, ce qui
entraîne un accroissement des distances entre les galaxies. Ce phénomène n’est
pas dû à un mouvement dans l’espace mais à l’étirement de l’espace lui-même.
Plus une galaxie est éloignée de nous, plus sa lumière est décalée vers le
rouge, ce qui indique qu’elle s’éloigne à grande vitesse. Cette observation a
été formulée par Edwin Hubble au XXe siècle et constitue l’un des fondements de
la cosmologie moderne. L’expansion de l’univers est décrite par la métrique de
Friedmann-Lemaître-Robertson-Walker et modélisée par les équations de la
relativité générale. Elle implique que l’univers n’a pas de centre d’expansion
et que chaque point de l’espace voit les autres s’éloigner. Ce phénomène se
poursuit aujourd’hui et semble même s’accélérer sous l’effet d’une énergie noire
encore mal comprise. |
|
La première image
représente une galaxie spirale vue de face, probablement Andromède. Elle montre
un noyau lumineux entouré de bras spiraux riches en étoiles, gaz et poussière,
avec un fond étoilé parsemé d’objets célestes.
La seconde image illustre l’échelle de l’univers en une série de
structures cosmiques croissantes : système solaire, nuage interstellaire local,
bulle locale, bras d’Orion, Voie lactée, groupe local, superamas de la Vierge et
univers observable. Chaque niveau est clairement identifié, offrant une vue
hiérarchique de notre position dans le cosmos.
|


|
La voie
lactée
La Voie lactée est la
galaxie dans laquelle se trouve notre système solaire. Elle apparaît comme une
bande blanchâtre dans le ciel nocturne, formée par la lumière de milliards
d’étoiles trop éloignées pour être distinguées individuellement. Cette galaxie
est une spirale barrée, contenant environ 100 à 400 milliards d’étoiles, ainsi
que du gaz, de la poussière et de la matière noire. Elle mesure environ 100 000
années-lumière de diamètre. Le Soleil se situe à environ 27 000 années-lumière
du centre galactique, dans un bras appelé le bras d’Orion. La Voie lactée tourne
sur elle-même, et cette rotation influence la dynamique des étoiles et des
nébuleuses. Elle fait partie d’un groupe local de galaxies, comprenant notamment
Andromède et le Triangle. L’étude de la Voie lactée permet de mieux comprendre
la formation des galaxies, l’évolution stellaire et la structure de l’univers.
|
|
La première image présente
une comparaison visuelle des trois types d’amas stellaires : les associations
stellaires sont représentées par des étoiles dispersées et peu liées, les amas
ouverts montrent un regroupement modéré d’étoiles bleues comme les Pléiades, et
les amas globulaires apparaissent comme une sphère dense d’étoiles anciennes,
illustrant leur forte concentration et leur ancienneté.
La deuxième image adopte un style schématique avec un fond beige et des étoiles
stylisées en noir, où les associations stellaires sont peu compactes et jeunes,
les amas ouverts sont plus concentrés et issus d’un même nuage moléculaire, et
les amas globulaires sont très denses et anciens, situés hors du plan
galactique.
La troisième image reprend cette typologie avec une esthétique manuscrite et une
texture parcheminée, en soulignant que les associations sont transitoires, les
amas ouverts sont visibles dans le disque galactique et les amas globulaires
sont sphériques et localisés dans le halo galactique, offrant une synthèse
claire des caractéristiques structurelles et dynamiques de chaque type d’amas. |



|
Les amas
d'étoiles
Un amas d’étoiles
est un regroupement d’étoiles liées gravitationnellement, formées ensemble dans
un même nuage moléculaire. Il existe deux grands types d’amas. Les amas ouverts
sont composés de quelques dizaines à quelques milliers d’étoiles jeunes, souvent
bleues, situées dans le disque des galaxies. Ils sont peu denses et se
dispersent avec le temps. Les Pléiades et les Hyades sont des exemples visibles
à l’œil nu. Les amas globulaires, eux, sont très denses, sphériques, et
contiennent des centaines de milliers à des millions d’étoiles très anciennes.
Ils orbitent autour du centre des galaxies, en dehors du disque. Omega Centauri
et M13 sont parmi les plus connus. Les amas stellaires sont des laboratoires
naturels pour étudier l’évolution stellaire car leurs étoiles ont le même âge et
la même composition chimique. Leur cohésion est assurée par la gravitation, mais
ils peuvent se dissoudre sous l’effet des interactions internes et des
perturbations galactiques.
|
|
Voici une illustration
inspirée de ton paragraphe : un vaste paysage cosmique où des milliards de
galaxies de formes variées — spirales, elliptiques, irrégulières — s’entrelacent
dans une toile de filaments lumineux. On y voit des nébuleuses colorées, des
étoiles en formation, des trous noirs discrets, des planètes isolées, et des
nuages de gaz et de poussières. Chaque galaxie semble être un monde autonome,
une archive du temps, baignée dans une lumière qui a traversé des milliards
d’années.
|
 |
Des
Milliards de galaxies
Des milliards de
galaxies peuplent l’univers, chacune contenant des milliards d’étoiles, des
nébuleuses, des trous noirs, des planètes, des gaz et des poussières. Elles se
regroupent en amas, en filaments, en structures colossales qui dessinent une
toile cosmique. Certaines sont spirales, d’autres elliptiques ou irrégulières.
Leur lumière met des millions voire des milliards d’années à nous parvenir.
Elles naissent, évoluent, fusionnent, meurent. Leur diversité reflète l’histoire
de l’univers, ses lois physiques, ses mystères encore insondables. Chaque
galaxie est un monde en soi, une archive du temps, un laboratoire naturel.
L’observation de ces galaxies nous permet de comprendre la matière noire,
l’énergie sombre, l’expansion cosmique. Elles sont les témoins silencieux d’un
passé lointain, les balises d’un avenir inconnu.
|
|
L’image montre quatre types
de galaxies réparties en quadrants. En haut à gauche, une galaxie spirale avec
un noyau lumineux doré et des bras bleus enroulés, parsemés de zones rosées de
formation stellaire. En haut à droite, une galaxie elliptique de forme ovale,
uniforme et jaunâtre, avec un noyau brillant qui s’estompe vers l’extérieur. En
bas à gauche, une galaxie irrégulière au centre dense, entourée de structures
chaotiques et de teintes bleues et rouges indiquant des régions de naissance
d’étoiles. En bas à droite, une galaxie spirale barrée avec une barre centrale
brillante et des bras moins définis, contenant des zones de formation stellaire.
Le fond est sombre, parsemé d’étoiles de différentes tailles et luminosités.
|
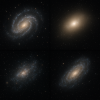 |
A quoi
ressemblent les galaxies ?
Les galaxies sont
des ensembles gigantesques d’étoiles, de gaz, de poussière et de matière noire,
liés par la gravité et organisés selon différentes formes. Certaines galaxies
ont une forme spirale, avec un noyau central lumineux et des bras enroulés
autour, comme la Voie lactée ou Andromède. D’autres sont elliptiques, plus ou
moins sphériques ou allongées, avec une structure uniforme et peu de gaz. Les
galaxies irrégulières n’ont pas de forme définie et présentent des zones
chaotiques de formation d’étoiles. Leur taille varie de quelques milliers à
plusieurs centaines de milliards d’étoiles. Elles peuvent contenir des trous
noirs supermassifs en leur centre et sont souvent regroupées en amas ou
superamas. Leur apparence dépend de leur âge, de leur composition, de leur
environnement et de leurs interactions avec d’autres galaxies.
|
|
L’image est divisée en deux
parties. À gauche, plusieurs galaxies sont représentées avec des flèches
pointant dans différentes directions, illustrant leur éloignement progressif dû
à l’expansion de l’univers. Les flèches sont plus longues pour les galaxies plus
éloignées, ce qui montre que plus une galaxie est distante, plus elle s’éloigne
rapidement. À droite, un schéma concentrique montre l’univers en expansion
depuis un point central lumineux nommé Big Bang. Les cercles successifs
représentent les étapes de cette expansion jusqu’à aujourd’hui, avec un dégradé
de couleurs allant du orange chaud au bleu sombre. Ce visuel illustre la
dilatation de l’espace et la chronologie cosmique depuis l’origine.
|
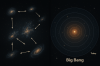 |
Les
galaxies s'éloignent
Les
galaxies s’éloignent les unes des autres en raison de l’expansion de l’univers.
Ce phénomène ne correspond pas à un déplacement dans l’espace mais à une
dilatation de l’espace lui-même. Plus une galaxie est éloignée, plus sa lumière
est décalée vers le rouge, ce qui indique qu’elle s’éloigne rapidement. Ce
décalage spectral cosmologique a été observé par Edwin Hubble en 1929 et
confirmé par la relativité générale. L’expansion est homogène et isotrope, ce
qui signifie qu’elle se produit de manière uniforme dans toutes les directions.
Ce mouvement n’affecte pas la taille des galaxies elles-mêmes car leur gravité
interne les maintient cohérentes. Ce phénomène implique qu’au passé l’univers
était plus dense et plus chaud, ce qui soutient le modèle du Big Bang.
|
|
L’image est composée de
deux parties. À gauche, le Big Bang est représenté par un point lumineux orange
intense entouré de particules et de noyaux atomiques qui s’éloignent dans toutes
les directions, illustrant l’expansion initiale de l’univers et la formation des
premiers éléments. À droite, une carte ovale du fond diffus cosmologique montre
des variations de température et de densité en bleu, vert, jaune et orange,
correspondant aux traces du rayonnement fossile issu du Big Bang. Des symboles
d’atomes et de liaisons sont associés à cette carte pour indiquer la présence
d’hydrogène neutre à cette époque. L’ensemble est posé sur un fond spatial
sombre parsemé d’étoiles.
|
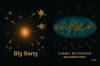 |
Qu'est-ce que le big-bang ?
Le Big Bang est le modèle cosmologique qui décrit l’origine et l’évolution de
l’univers à partir d’un état initial extrêmement dense et chaud. Il ne s’agit
pas d’une explosion dans l’espace mais d’une expansion rapide de l’espace
lui-même. Il y a environ 13,8 milliards d’années, toute la matière et l’énergie
de l’univers étaient concentrées en un point minuscule. En une fraction de
seconde, cet univers primordial s’est dilaté, donnant naissance aux particules
élémentaires, puis aux noyaux atomiques. Environ 380 000 ans plus tard, les
premiers atomes se sont formés et la lumière a pu circuler librement, produisant
le rayonnement fossile que l’on observe encore aujourd’hui. Ce modèle est
soutenu par plusieurs observations comme le décalage vers le rouge des galaxies,
la distribution des éléments légers et le fond diffus cosmologique. Le Big Bang
marque le début de l’espace, du temps et de la matière telle que nous la
connaissons.
|
|