|
| |
Classification (env 52.500 esp)
Métazoaires-Triploblastiques-Invertébrés-Protostomiens-Ecdysozoaires-Arthropodes-Chélicérates-Arachnides-Acariens
(2 fiches)
()
|
Ordres |
Espèces |
Espèces
representatives |
Description |
|
Mesostigmata
|
env
11.500 esp |
Varroa destructor — Varroa destructeur
(moins de 2 mm, moins de 1 g)
Dermanyssus gallinae — Pou rouge des volailles
(moins de 1 mm, moins de 1 g)
Macrocheles robustulus — Macrochèle robuste.
(moins de 1 mm, moins de 1 g)
Stratiolaelaps scimitus
— acarine fouisseur à proies molles
(moins de 1 mm, moins de 1 g)

 |
Identification et description Les Mesostigmata sont un
ordre d’acariens appartenant aux Parasitiformes, sous-classe des
Arachnides. Ils mesurent généralement entre 0,2 et 2 mm. Leur corps est
souvent ovale ou subcarré, avec des pattes robustes et des chélicères
bien développés. Ils possèdent une paire de stigmates (orifices
respiratoires) située latéralement entre les coxae des pattes II et III,
ce qui les distingue des autres acariens. Leur cuticule peut être lisse
ou fortement sculptée selon les familles.
Répartition géographique Les Mesostigmata sont cosmopolites. On
les trouve dans les sols forestiers, les litières, les composts, les
habitats aquatiques, les nids d’oiseaux, les terriers de mammifères, et
même sur des hôtes vertébrés. Certaines espèces sont endémiques à des
microhabitats spécifiques, tandis que d’autres ont une large
distribution intercontinentale.
Particularités écologiques La majorité des Mesostigmata sont
prédateurs de microarthropodes, de nématodes ou d’œufs d’insectes.
D’autres sont fongivores, nécrophages ou parasites. Certaines espèces
comme Dermanyssus gallinae sont hématophages et peuvent
infester les volailles. Les familles comme Phytoseiidae sont utilisées
en lutte biologique contre les acariens ravageurs. Leur diversité est
immense : plus de 11 000 espèces décrites, réparties en près de 900
genres et 109 familles.
Dangerosité La plupart des Mesostigmata sont inoffensifs pour
l’humain. Toutefois, quelques espèces parasitaires comme
Ornithonyssus bacoti ou Dermanyssus gallinae peuvent
provoquer des dermatites ou des réactions allergiques. Ces cas restent
rares et liés à des environnements spécifiques (élevages, volières,
habitats contaminés). Les espèces du sol sont bénéfiques pour
l’équilibre écologique et la régulation des populations de ravageurs.
Parasitisme Le parasitisme est minoritaire dans cet
ordre. On distingue trois formes principales. Le parasitisme hématophage
concerne des espèces vivant temporairement ou en permanence sur des
hôtes vertébrés, se nourrissant de sang et parfois vecteurs de maladies.
Le parasitisme nidicole concerne des espèces vivant dans les nids
d’oiseaux ou de mammifères, se nourrissant de débris organiques ou de
sang lors de contacts occasionnels. Le parasitisme opportuniste concerne
des espèces colonisant des hôtes affaiblis ou des environnements
anthropisés sans cycle parasitaire strict. La majorité des Mesostigmata
sont libres et prédateurs, jouant un rôle essentiel dans la régulation
des microfaunes du sol. Leur parasitisme est donc l’exception, non la
règle. |
|
Ixodida
|
env 900
esp |
Ixodes ricinus — tique du mouton
(moins de 3 mm, moins de 1 g)
Dermacentor reticulatus — tique ornée
(moins de 5 mm, moins de 1 g)
Rhipicephalus sanguineus — tique brune du
chien
(moins de 3 mm, moins de 1 g)
Haemaphysalis punctata — tique ponctuée
(moins de 3 mm, moins de 1 g)

 |
Description Les Ixodida sont des acariens ectoparasites
connus sous le nom de tiques. Leur corps est ovale, aplati
dorsoventralement, avec un capitulum antérieur bien visible et un scutum
dorsal rigide chez les tiques dures (Ixodidae). Les femelles affamées
mesurent entre 3 et 5 mm, mais peuvent atteindre plus de 10 mm une fois
gorgées de sang. Les mâles sont plus petits et ne se gorgeant pas, leur
taille reste constante. Leur appareil buccal est adapté à la perforation
de la peau et à l’aspiration du sang.
Distribution Les Ixodida sont cosmopolites. On les trouve sur
tous les continents, dans les zones tempérées, tropicales et
subtropicales. Les genres Ixodes, Dermacentor,
Rhipicephalus, Amblyomma et Haemaphysalis sont
les plus répandus. Leur présence est liée à celle de leurs hôtes
(mammifères, oiseaux, reptiles) et à des conditions climatiques
favorables à leur cycle de vie.
Particularités Les Ixodida ont un cycle complexe en trois
stades actifs : larve, nymphe, adulte. Chaque stade nécessite un repas
sanguin sur un hôte. Leur durée de vie peut atteindre plusieurs années.
Ils sont capables de détecter leurs hôtes grâce à l’organe de Haller
situé sur les pattes antérieures. Certaines espèces sont très
spécialisées, d’autres généralistes. Leur salive contient des molécules
anticoagulantes, immunomodulatrices et anesthésiantes, facilitant leur
parasitisme prolongé.
Parasitisme Les Ixodida sont des ectoparasites obligatoires.
Ils parasitent une grande variété de vertébrés, y compris l’humain. Ils
peuvent transmettre de nombreux agents pathogènes : bactéries (Borrelia,
Rickettsia), virus (encéphalites à tiques), protozoaires (Babesia). Le
parasitisme peut être direct (lésions, anémie) ou indirect (transmission
de maladies vectorielles). Certaines espèces sont nidicoles, d’autres
exophiles, et leur comportement varie selon les régions et les hôtes.
Dangerosité Les Ixodida sont parmi les arthropodes les plus
dangereux pour la santé publique après les moustiques. Ils sont vecteurs
de maladies graves comme la borréliose de Lyme, la fièvre boutonneuse,
l’encéphalite à tiques, la babésiose ou l’ehrlichiose. Leur piqûre peut
aussi provoquer des réactions allergiques, des paralysies temporaires
(par toxine salivaire) et des infections secondaires. Leur dangerosité
dépend de l’espèce, de la durée d’attachement et du pathogène transmis. |
|
Opilioacarida |
env 30 esp |
Opilioacarus segmentatus — opilioacare segmenté
(moins de 3 mm, moins de 1 g)
Neocarus proteus — néocare polymorphe
(moins de 3 mm, moins de 1 g)
Caribeacarus ojastii — caribéacare d’Ojastii
(moins de 3 mm, moins de 1 g)
Phalangiacarus coineaui — phalangiacare de
Coineau(moins de 3 mm, moins de 1 g)

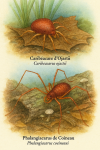
|
Description Les Opilioacarida sont un ordre rare et
primitif d’acariens appartenant aux Parasitiformes. Ils mesurent
généralement entre 1 et 3 mm. Leur corps est segmenté, avec une cuticule
robuste et souvent colorée (roses, bleus, bruns). Ils possèdent six yeux
latéraux, une caractéristique unique parmi les acariens. Leurs pattes
sont longues et annelées, parfois rayées, et leur abdomen conserve une
segmentation visible, rappelant les Opiliones. Contrairement à la
plupart des acariens, ils continuent à muer à l’âge adulte et peuvent
régénérer des membres perdus.
Distribution Les Opilioacarida sont largement répartis dans les
régions chaudes et tropicales du globe : Amérique centrale, Amérique du
Sud, Afrique, Asie du Sud-Est, Méditerranée, Moyen-Orient. Ils vivent
principalement sous les pierres, dans la litière forestière, les sols
sablonneux et les grottes. Leur répartition est fragmentée, avec de
nombreuses espèces endémiques à des microhabitats.
Particularités Ils sont considérés comme des fossiles vivants,
conservant des traits ancestraux absents chez les autres acariens. Leur
régime alimentaire est varié : ils consomment des spores fongiques, du
pollen, des débris organiques et parfois de petits arthropodes.
Certaines espèces montrent un comportement parental, protégeant les œufs
et les jeunes stades. Leur locomotion est rapide et leur comportement
discret. Ils appartiennent à une seule famille, les Opilioacaridae, avec
une douzaine de genres connus.
Parasitisme Aucun cas de parasitisme n’a été observé chez les
Opilioacarida. Ce sont des acariens libres, saprophages ou prédateurs
occasionnels. Ils ne colonisent ni les vertébrés ni les invertébrés
comme hôtes. Leur cycle de vie est indépendant, sans phase parasitaire.
Dangerosité Les Opilioacarida sont totalement inoffensifs pour
l’humain et les animaux domestiques. Ils ne piquent pas, ne mordent pas,
ne transmettent aucun agent pathogène connu. Leur rôle écologique est
neutre à bénéfique, participant à la décomposition et à la régulation
microfaunique. |
|
Trombidiformes
|
env
25.000 esp |
Tetranychus urticae → Acarien rouge
(moins de 1 mm, moins de 1 g)
Demodex folliculorum → Acarien folliculaire
humain
(moins de 1 mm, moins de 1 g)
Eriophyes tiliae → Acarien des tilleuls
(moins de 1 mm, moins de 1 g)
Allothrombium fuliginosum → Acarien velu rouge
(moins de 2 mm, moins de 1 g)

 |
Description Les Trombidiformes forment un ordre
extrêmement diversifié d’acariens, regroupant plus de 20.000 espèces
connues. Leur taille varie de 0,1 à 2 mm, mais certains adultes comme
les Trombidiidae peuvent atteindre 4 à 5 mm. Leur morphologie est très
variable : certains sont allongés, d’autres globuleux, avec des couleurs
allant du rouge vif au transparent. Ils possèdent souvent des soies
sensorielles, des pattes longues et des formes buccales adaptées à des
régimes très spécialisés. Le groupe inclut des acariens terrestres,
aquatiques, végétaux, prédateurs, parasites et phytophages.
Distribution Les Trombidiformes sont cosmopolites. On les
trouve dans tous les biomes : forêts, déserts, zones humides, milieux
agricoles, habitats aquatiques, et même dans les glaces polaires.
Certaines familles comme les Tetranychidae (acariens tétranyques) sont
ubiquistes sur les plantes, tandis que les Trombidiidae (acariens de
velours) sont visibles sur les sols ensoleillés. Leur diversité est
maximale dans les zones tropicales et tempérées.
Particularités Leur diversité écologique est remarquable. Les
larves de certaines familles comme les Trombidiidae sont parasites
d’insectes (pucerons, coléoptères), tandis que les adultes sont
prédateurs. Les Tetranychidae sont phytophages et ravageurs majeurs en
agriculture. Les Eriophyidae sont microscopiques et provoquent des
galles sur les plantes. Les Cheyletidae sont prédateurs ou commensaux
dans les poussières domestiques. Les Prostigmata incluent des formes
aquatiques, des acariens des algues, et des espèces vivant dans les
interstices de la roche. Leur cycle de vie est souvent complexe, avec
des stades larvaires très distincts des adultes.
Parasitisme Le parasitisme est fréquent mais limité à certains
stades. Les larves de Trombidiidae, Erythraeidae et Trombiculoidea
(rougets, chiggers) sont ectoparasites d’insectes ou de vertébrés. Elles
se fixent temporairement pour se nourrir de lymphe ou de sang. Les
adultes sont libres et souvent prédateurs. Les Tetranychidae et
Eriophyidae sont phytoparasites, provoquant des déformations, des
décolorations ou des pertes de rendement. Les Pyemotidae et Tarsonemidae
incluent des formes parasitant des insectes ou des champignons.
Dangerosité Certaines espèces sont nuisibles pour l’humain ou
les cultures. Les Trombiculoidea (rougets) peuvent provoquer des
dermatites sévères chez l’humain. Les Tetranychidae causent des pertes
agricoles importantes. Les Cheyletiella peuvent infester les animaux
domestiques et provoquer des irritations cutanées. Toutefois, la
majorité des Trombidiformes sont inoffensifs ou bénéfiques, jouant un
rôle dans la régulation biologique ou la décomposition. Leur dangerosité
dépend fortement de la famille, du stade et du contexte écologique. |
|
Sarcoptiformes
|
env
15.000 esp |
Sarcoptes scabiei — Acarien de la gale
(moins de 1 mm, moins de 1 g)
Tyrophagus putrescentiae — Acarien des denrées
stockées
(moins de 1 mm, moins de 1 g)
Acarus siro — Acarien de la farine
(moins de 1 mm, moins de 1 g)
Glycyphagus domesticus — Acarien des maisons
(moins de 1 mm, moins de 1 g)

 |
Taille Les Sarcoptiformes présentent une grande
variabilité de taille selon les groupes. Les oribatides mesurent
généralement entre 0,2 et 1,5 mm tandis que les astigmates comme
Sarcoptes scabiei peuvent atteindre environ 0,3 à 0,5 mm. Leur petite
taille les rend difficiles à observer sans microscope.
Distribution Ce groupe est cosmopolite. On les retrouve dans
tous les types de milieux terrestres : sols forestiers, prairies,
toundras, habitats urbains, et même dans les régions polaires. Les
espèces parasites comme Sarcoptes scabiei sont présentes sur tous les
continents et peuvent infester une grande variété de mammifères, y
compris l’humain.
Description Les Sarcoptiformes sont des acariens appartenant à
la classe des Arachnida. Ils regroupent deux grands ensembles : les
Oribatida (souvent libres et saprophages) et les Astigmata (souvent
parasites). Leur corps est segmenté, muni de quatre paires de pattes, et
recouvert d’une cuticule parfois fortement sclérifiée chez les
oribatides. Leur appareil buccal est adapté à la mastication de débris
organiques ou à la perforation de la peau selon leur mode de vie.
Particularités Les oribatides jouent un rôle écologique
fondamental dans la décomposition de la matière organique et la
formation des sols. Ils sont souvent utilisés comme bioindicateurs. Les
astigmates, en revanche, incluent des espèces hautement spécialisées
dans le parasitisme, avec des adaptations morphologiques comme des
griffes ou des ventouses pour s’accrocher à leur hôte. Certains
Sarcoptiformes peuvent survivre dans des environnements extrêmes grâce à
leur cuticule résistante et leur métabolisme lent.
Parasitisme Le parasitisme est surtout représenté chez les
Astigmata, notamment Sarcoptes scabiei, responsable de la gale. Ce
parasite creuse des galeries dans l’épiderme de son hôte pour y pondre
ses œufs, provoquant des démangeaisons intenses et des lésions cutanées.
Il existe plusieurs variétés de Sarcoptes scabiei, chacune adaptée à une
espèce hôte spécifique (humain, chien, renard, etc.).
Dangerosité Les oribatides sont inoffensifs pour l’homme. En
revanche, les astigmates parasites comme Sarcoptes scabiei sont
pathogènes. La gale humaine est une maladie dermatologique contagieuse,
transmissible par contact direct prolongé. Elle peut entraîner des
surinfections bactériennes si elle n’est pas traitée. D’autres espèces
comme les acariens de la poussière (Dermatophagoides) peuvent provoquer
des allergies respiratoires sévères |
|
Holothyrida |
env 30 esp |
Holothyrus coccinella → Holothyre coccinelle
(moins de 6 mm, moins de 1 g)
Allothyrus australicus → Allothyre australien
(moins de 5 mm, moins de 1 g)
Sternothyrus braueri → Sternothyre de Brauer
(moins de 6 mm, moins de 1 g)
Diplothyrus lehtineni → Diplothyre de Lehtinen
(moins de 5 mm, moins de 1 g)

_small1.png) |
Taille Les Holothyrida sont des acariens de grande
taille comparés à la majorité des autres acariens. Les adultes mesurent
généralement entre 2 et 7 mm, avec un corps fortement sclérifié et en
forme de dôme, leur donnant une apparence proche de celle d’un petit
coléoptère.
Distribution Ils sont rares et principalement présents dans les
zones tropicales humides. On les trouve dans la litière forestière, les
mousses et sous les pierres, notamment en Nouvelle-Guinée, en Australie,
en Amérique du Sud et dans certaines îles du Pacifique. Leur répartition
altitudinale s’étend du niveau de la mer jusqu’à environ 2000 mètres.
Description Les Holothyrida sont des acariens appartenant au
super-ordre des Parasitiformes. Leur corps est recouvert d’un bouclier
dorsal rigide, avec des ocelles latéraux parfois présents. Ils possèdent
des chélicères à trois segments, des palpes à cinq segments et des
glandes dorsolatérales chez les nymphes. Les adultes sont souvent
rouges, bruns ou noirs, et adoptent un comportement de thanatose
lorsqu’ils sont dérangés.
Particularités Ce sont des acariens scavengers, se nourrissant
de cadavres d’insectes ou d’autres invertébrés. Ils ne sont pas
prédateurs et leur activité est lente. Les nymphes peuvent sécréter un
liquide défensif via des glandes dorsales. Certaines espèces comme
Holothyrus coccinella produisent une sécrétion distasteful qui peut être
toxique pour les oiseaux qui les ingèrent.
Parasitisme Aucun cas de parasitisme n’a été démontré chez les
Holothyrida. Contrairement à leurs proches parents les Ixodida (tiques),
ils ne parasitent pas d’hôtes vivants. Leur mode de vie est strictement
libre et saprophage.
Dangerosité Ils ne présentent aucun danger pour l’homme ni pour
les animaux domestiques. Leur rareté et leur mode de vie discret les
rendent inoffensifs. Toutefois, certaines espèces peuvent être toxiques
si ingérées, comme Holothyrus coccinella, dont la sécrétion serait
mortelle pour les volailles. |
|