|
| |
Ciconiiformes (nicheurs) en
France
|
Espèces en France |
Espèces
representatives |
Description |
Pélécanidés
(2 espèces) |
Pelecanus onocrotalus — Pélican blanc
Pelecanus crispus - Pélican frisé
 |
Les Pélécanidés sont de grands oiseaux aquatiques piscivores,
reconnaissables à leur bec massif et leur poche gulaire, présents
ponctuellement en France et observables en Aquitaine dans certains parcs
zoologiques.
Taille et description Les pélicans mesurent entre 1,60 et 1,80
m de long avec une envergure pouvant atteindre 3,5 m. Leur poids varie
de 10 à 13 kg selon les espèces. Ils possèdent un bec long et puissant
muni d’une poche extensible appelée sac gulaire, capable de contenir
plus de 10 litres d’eau. Cette poche sert à la pêche, au transport de
matériaux pour le nid et à la régulation thermique. Leurs ailes larges
leur permettent de voler sur de longues distances en planant. Le plumage
est généralement blanc, sauf chez le pélican brun et le pélican à
lunettes. Les pattes sont courtes, robustes et entièrement palmées,
adaptées à la nage. Leur vol est puissant et leur capacité à planer sur
les courants ascendants leur permet de voler pendant des heures sans
effort.
Présence en France et en Aquitaine Les Pélécanidés ne sont pas
des nicheurs réguliers en France mais peuvent être observés en migration
ou en captivité. Le pélican frisé (Pelecanus crispus) est parfois aperçu
dans le sud-est de la France, notamment en Camargue. En Aquitaine, leur
présence est surtout liée à des structures zoologiques comme le Zoo du
Bassin d’Arcachon où le pélican frisé est maintenu. Leur habitat naturel
inclut les zones humides, les lacs et les marais, mais leur présence
sauvage reste exceptionnelle dans la région.
Particularités Les pélicans vivent en colonies et pratiquent
souvent la pêche en groupe. Leur maturité sexuelle survient entre 3 et 5
ans. Ils pondent 1 à 6 œufs, incubés par les deux parents pendant
environ un mois. Les poussins sont nourris par régurgitation. Leur cri
est un grognement rauque, surtout en période de reproduction. Ils
peuvent voler sans escale pendant 24 heures grâce à leur aptitude à
exploiter les courants ascendants. Leur espérance de vie est de 25 ans
en nature et jusqu’à 50 ans en captivité. Le pélican frisé est considéré
comme le plus grand oiseau d’eau douce d’Europe |
Ardéidés
(env 10 espèces) |
Ardea cinerea — Héron cendré
Ardea purpurea — Héron pourpré
Bubulcus ibis — Héron garde-bœufs
Egretta garzetta — Aigrette garzette

 |
Les Ardéidés sont des échassiers de taille moyenne à grande,
bien représentés en France et en Aquitaine, avec des adaptations
remarquables aux milieux humides.
Taille et description Les Ardéidés regroupent les hérons,
aigrettes, butors, crabiers et bihoreaux. Leur taille varie de 27 cm
pour le blongios nain à 140 cm pour le héron goliath. Ils possèdent un
long cou replié en S au repos et en vol, un bec en forme de poignard
adapté à la capture de proies aquatiques, et de longues pattes leur
permettant de marcher dans l’eau peu profonde. Le plumage est souvent
discret, dans des tons de gris, brun ou roux, parfois blanc chez les
aigrettes. Le vol est caractérisé par le cou replié et les pattes
tendues vers l’arrière. Leur posture d’attente immobile et leur démarche
lente facilitent la chasse à l’affût.
Présence en France et en Aquitaine Les Ardéidés sont largement
présents en France, notamment dans les zones humides, les marais, les
étangs, les rivières et les littoraux. En Aquitaine, on les observe dans
le bassin d’Arcachon, les marais de Bruges, les étangs du Médoc, les
zones humides de la vallée de la Garonne et du Lot-et-Garonne. Le héron
cendré, l’aigrette garzette et le bihoreau gris sont parmi les espèces
les plus communes. Certaines espèces comme le butor étoilé sont plus
discrètes et localisées. Des suivis ornithologiques permettent de
surveiller leur abondance et leur reproduction.
Particularités Les Ardéidés sont principalement piscivores mais
peuvent consommer amphibiens, insectes et petits mammifères. Leur
technique de chasse repose sur la patience et la précision. Ils nichent
souvent en colonies dans les roselières ou les arbres, parfois en mixité
avec d’autres espèces. Leurs cris sont rauques ou stridents, utilisés
pour la communication en période de reproduction. Le dimorphisme sexuel
est peu marqué. Leurs déplacements migratoires varient selon les
espèces, certaines étant sédentaires, d’autres migratrices. Ils jouent
un rôle écologique important dans les zones humides et sont indicateurs
de la qualité des milieux aquatiques. |
Threskionithidés
(2 espèces) |
Plegadis falcinellus — Ibis falcinelle
Platalea leucorodia — Spatule blanche |
Les Threskionithidés sont des échassiers de taille moyenne à
grande, bien présents en France et en Aquitaine, avec des adaptations
morphologiques distinctes entre ibis et spatules.
Taille et description Les Threskionithidés regroupent les ibis
et les spatules. Leur taille varie de 46 à 110 cm. Les ibis ont un bec
long, mince et recourbé vers le bas, tandis que les spatules possèdent
un bec large et aplati en forme de spatule. Le corps est élancé, les
pattes sont longues et adaptées à la marche dans les zones humides, et
le cou est également allongé. Le plumage varie selon les espèces : blanc
chez la spatule blanche, noir chez l’ibis falcinelle, ou encore rouge
chez l’ibis rouge. Le vol est puissant, avec le cou et les pattes
tendus. Ces oiseaux sont souvent silencieux mais peuvent émettre des
sons rauques ou nasillards en période de reproduction.
Présence en France et en Aquitaine En France, plusieurs espèces
sont présentes, notamment la spatule blanche (Platalea leucorodia)
et l’ibis falcinelle (Plegadis falcinellus). La spatule blanche
est nicheuse dans les zones humides du sud-ouest, notamment en Camargue
et dans le Marais poitevin. En Aquitaine, elle est bien représentée dans
les marais du bassin d’Arcachon, les étangs du Médoc et les zones
humides de la vallée de la Garonne. L’ibis falcinelle, autrefois rare,
est désormais en expansion et niche dans certaines colonies mixtes avec
les hérons. Ces espèces sont suivies dans les programmes de conservation
des zones humides.
Particularités Les Threskionithidés sont grégaires et nichent
souvent en colonies, parfois avec d’autres échassiers. Leur alimentation
est principalement composée d’invertébrés aquatiques, petits poissons et
amphibiens, qu’ils capturent en fouillant la vase avec leur bec
spécialisé. Les spatules balayent leur bec dans l’eau pour détecter les
proies, tandis que les ibis sondent les substrats. Leur reproduction
implique la construction de nids dans les arbres ou les roselières. Ils
jouent un rôle écologique important dans les zones humides et sont
indicateurs de leur bon état. Leur expansion récente en France est liée
à la protection des sites de nidification et à l’amélioration de la
qualité des milieux humides. |
Botaurinés
(2 espèces) |
Botaurus stellaris — Butor étoilé
Ixobrychus minutus — Blongios nain
|
Les Botaurinés sont des hérons discrets de taille moyenne,
spécialisés dans les milieux humides denses, présents en France et en
Aquitaine avec des adaptations cryptiques remarquables.
Taille et description Les Botaurinés incluent principalement le
butor étoilé (Botaurus stellaris) et le blongios nain (Ixobrychus
minutus). Le butor étoilé mesure entre 69 et 81 cm de long
pour une envergure allant jusqu’à 130 cm et un poids moyen
d’environ 1 kg. Il possède un plumage brun chamois strié de
noir, un cou épais, une gorge blanche, et une
bande sombre sur le crâne et la joue. Sa posture typique, le cou
dressé vers le ciel, lui permet de se camoufler parfaitement dans les
roselières. Le blongios nain est plus petit, avec une taille d’environ
27 à 38 cm, un plumage contrasté noir et beige, et un
comportement également furtif.
Présence en France et en Aquitaine Le butor étoilé est présent
dans les zones humides riches en roseaux : marais, étangs, lacs
et tourbières. En France, il est surtout observé en Camargue,
en Loire-Atlantique, dans le Nord et le Nord-Est.
En Aquitaine, il est signalé dans les marais du bassin d’Arcachon,
les zones humides du Médoc, et certains étangs de la vallée
de la Garonne. Le blongios nain est également présent dans la
région, mais plus difficile à détecter. Les populations de butor étoilé
sont en fort déclin, avec moins de 300 mâles chanteurs
recensés en France, ce qui en fait une espèce vulnérable.
Particularités Les Botaurinés sont extrêmement farouches
et cryptiques, leur présence étant souvent révélée uniquement
par leur cri territorial, semblable à une corne de brume.
Ils sont sédentaires en Europe de l’Ouest et du Sud, mais
peuvent migrer depuis les régions plus froides. Leur régime alimentaire
est carnivore, composé de grenouilles, insectes, larves,
têtards et petits poissons, capturés par un coup de bec rapide.
La reproduction a lieu en avril-mai, avec une ponte de 5 à
6 œufs sur une plateforme de roseaux. Les jeunes sont
nourris pendant environ 8 semaines. Leur camouflage et leur
comportement immobile en font des espèces très difficiles à observer,
mais essentielles pour l’équilibre des zones humides. |
Ciconia
(2
espèces) |
Ciconia ciconia — Cigogne blanche
Ciconia nigra — Cigogne noire
|
Les Ciconia sont de grands échassiers au long bec et au vol
majestueux, bien représentés en France et en Aquitaine, notamment par la
cigogne blanche.
Taille et description Les espèces du genre Ciconia,
principalement la cigogne blanche (Ciconia ciconia) et la
cigogne noire (Ciconia nigra), mesurent entre 100 et 115 cm
de long avec une envergure de 180 à 200 cm et un poids de
2,3 à 4,4 kg. Elles possèdent un long bec droit, des
pattes rouges, un cou allongé et un plumage blanc avec
des rémiges noires pour la cigogne blanche, entièrement noir à
reflets métalliques avec le ventre blanc pour la cigogne noire. Le vol
se fait cou tendu, contrairement aux hérons, avec des
battements lents et des phases de vol plané. Leur espérance de vie peut
atteindre 26 ans.
Présence en France et en Aquitaine La cigogne blanche
est nicheuse certaine en France, avec environ 4500 couples
reproducteurs recensés. Elle est bien présente en
Nouvelle-Aquitaine, notamment dans les zones humides de la
Dordogne, du Marais poitevin, du Médoc et du
bassin d’Arcachon. Elle niche sur des structures élevées
comme les pylônes, cheminées, clochers ou
plateformes artificielles. La cigogne noire, plus discrète
et forestière, est présente dans les massifs boisés du
sud-ouest mais reste rare et localisée. Les deux espèces sont
suivies par des programmes de baguage et de conservation.
Particularités Les Ciconia sont grégaires en migration
mais isolées ou en petits groupes pour la nidification. Elles
sont presque muettes, utilisant le claquement de bec
pour communiquer, notamment lors des parades nuptiales. Le nid
volumineux peut atteindre 2 m de diamètre et de hauteur,
réutilisé plusieurs années. La ponte comprend 3 à 5 œufs,
incubés pendant 33 à 34 jours, avec des jeunes qui s’envolent à
2 mois. Leur régime alimentaire est opportuniste,
composé de invertébrés, amphibiens, petits mammifères et reptiles.
Elles fréquentent aussi les décharges en période de migration.
Certaines populations tendent à se sédentariser en France,
notamment dans les zones où la nourriture est disponible toute l’année. |
Anatidés (nicheurs) en
France
|
Espèces en France |
Espèces
representatives |
Description |
Anatidés
(26 espèces)
|
Anas platyrhynchos — Canard colvert
Anas querquedula — Sarcelle d’été
Tadorna tadorna — Tadorne de Belon
Netta rufina — Nette rousse
Aythya ferina — Fuligule milouin
Anser anser — Oie cendrée
Cygnus olor — Cygne tuberculé
Branta leucopsis — Bernache nonnette |
Les Anatidés sont des oiseaux aquatiques de taille moyenne à
grande, bien représentés en France et en Aquitaine, avec des adaptations
remarquables à la vie semi-aquatique.
Taille et description Les Anatidés regroupent les canards, oies
et cygnes. Leur taille varie de 30 cm pour les petits canards comme le
sarcelle d’hiver à plus de 1,5 m d’envergure pour les grands cygnes
comme le cygne tuberculé. Ils possèdent un corps dense facilitant la
flottabilité et la plongée, un long cou tendu en vol, des ailes courtes
mais puissantes permettant un vol rapide et énergique, et des pattes
palmées adaptées à la nage. Leur plumage est souvent imperméable grâce à
une glande uropygienne qui sécrète une huile protectrice. Les femelles
reproductrices arrachent leur duvet ventral pour garnir le nid,
favorisant l’incubation et la conservation thermique des œufs.
Présence en France et en Aquitaine Les Anatidés sont largement
présents en France, notamment dans les zones humides, les lacs, les
marais et les estuaires. En Aquitaine, ils sont observables dans les
réserves naturelles comme le bassin d’Arcachon, les marais de Bruges,
les étangs de la Double ou les zones humides du Médoc. Certaines espèces
sont sédentaires, comme le colvert, tandis que d’autres sont
migratrices, comme la bernache cravant ou le canard siffleur. Des
comptages hivernaux ont permis de suivre leur abondance sur plusieurs
décennies.
Particularités Les Anatidés présentent une grande diversité
morphologique et comportementale. Ils sont majoritairement herbivores ou
omnivores, filtrant l’eau ou fouillant les fonds pour se nourrir. Leurs
cris et sifflements sont spécifiques à chaque espèce. Le dimorphisme
sexuel est souvent marqué chez les canards, avec des mâles aux couleurs
vives. Leur reproduction implique souvent des parades nuptiales
élaborées. Ils jouent un rôle écologique important dans la régulation
des milieux aquatiques et sont suivis dans des enquêtes nationales pour
évaluer leur statut de conservation. |
Phoenicopteriformes
(nicheurs) en
France
|
Espèces en France |
Espèces
representatives |
Description |
Phoénicoptéridés
(1 espèce)
|
Phoenicopterus roseus — Flamant rose |
|
Podicipédidés
(3 espèces) |
Podiceps cristatus — Grèbe huppé
Podiceps nigricollis — Grèbe à cou noir
Tachybaptus ruficollis — Grèbe castagneux
|
|
Charadriiformes
(nicheurs) en
France
|
Espèces en France |
Espèces
representatives |
Description |
Burhinidés
(1 espèce) |
Burhinus oedicnemus — Œdicnème criard |
|
Haematopodidés
(1 espèce) |
Haematopus ostralegus — Huîtrier pie |
|
Recurvirostridés
(2 espèces) |
Recurvirostra avosetta — Avocette élégante
Himantopus himantopus — Échasse blanche |
|
Charadriidés
(6 espèces) |
Charadrius alexandrinus — Gravelot à collier interrompu
Vanellus vanellus — Vanneau huppé
Charadrius dubius — Petit gravelot
Pluvialis apricaria — Pluvier doré |
|
Scolopacidés
(4 espèces) |
Gallinago gallinago — Bécassine des marais
Tringa totanus — Chevalier gambette
Numenius arquata — Courlis cendré
Scolopax rusticola — Bécasse des bois |
|
Laridés
(10 espèces) |
Larus argentatus — Goéland argenté
Chroicocephalus ridibundus — Mouette rieuse
Sterna hirundo — Sterne pierregarin
Thalasseus sandvicensis — Sterne caugek |
|
Glaréolidés
(1 espèce) |
Glareola pratincola — Glaréole à collier |
|
Gruiformes
(nicheurs) en
France
|
Espèces en France |
Espèces
representatives |
Description |
Gruidés
(1 espèce) |
Grus grus — Grue cendrée |
|
Rallidés
(7 espèces) |
Rallus aquaticus — Râle d’eau
Gallinula chloropus — Poule-d’eau
Porphyrio porphyrio — Talève sultane
Fulica atra — Foulque macroule |
|
Galliformes
(nicheurs et sauvages) présent en
France
|
Espèces en France |
Espèces
representatives |
Description |
Numididés
(1 espèce) |
Pintade commune (Numida meleagris)
|
Les Numididés sont des galliformes africains terrestres,
représentés en France par la pintade domestique, élevée pour sa chair.
En Aquitaine, leur présence est liée à l’élevage agricole.
Taille et description Les Numididés mesurent entre 40 et 72 cm.
Leur corps est trapu, la tête petite et souvent nue, avec une crête ou
un casque osseux chez certaines espèces comme la pintade de Numidie. Le
plumage est sombre, généralement gris ou noir, piqueté de taches
blanches en forme de perles. La queue est courte et tombante, les ailes
arrondies. Le bec est court et recourbé, les pattes robustes adaptées à
la course. Le dimorphisme sexuel est peu marqué.
Présence en France et en Aquitaine La seule espèce présente en
France est la pintade commune (Numida meleagris), sous forme domestique.
Elle est originaire d’Afrique subsaharienne mais a été introduite et
élevée en Europe depuis l’Antiquité. La France est le premier producteur
européen de pintades, avec une forte concentration d’élevages dans le
Sud-Ouest, notamment en Nouvelle-Aquitaine. En Gironde et dans les
Landes, la pintade est intégrée aux systèmes agricoles mixtes, souvent
en plein air ou en élevage fermier. Elle n’existe pas à l’état sauvage
mais peut former des populations férales dans certaines zones rurales.
Particularités Les Numididés sont les seuls galliformes à
présenter un casque osseux sur le crâne. Leur comportement est grégaire,
avec des cris stridents et une forte vigilance. La pintade domestique
est omnivore, se nourrissant de graines, insectes, baies et petits
vertébrés. Elle pond entre 12 et 15 œufs, incubés pendant 23 à 24 jours.
Les deux parents peuvent participer à l’élevage des jeunes. Leur chair
est appréciée pour sa finesse et son goût prononcé. L’élevage de
pintades est appelé méléagriculture. Certaines espèces sauvages comme la
pintade vulturine ou la pintade plumifère sont encore peu connues et
menacées par la déforestation en Afrique |
Phasianidés
(4
espèces) |
Phasianus colchicus — Faisan de Colchide
Alectoris rufa — Perdrix rouge
Perdix perdix — Perdrix grise
Coturnix coturnix — Caille des blés |
Taille et description Les Phasianidés sont des
galliformes de taille moyenne à grande, allant de 15 cm chez les cailles
à plus de 2 m en incluant la traîne chez le paon bleu. Leur corps est
trapu, les ailes courtes et arrondies, le bec robuste et légèrement
recourbé, les pattes puissantes souvent munies d’éperons chez les mâles.
Le plumage est très variable, souvent terne chez les femelles et
spectaculaire chez les mâles, avec un dimorphisme sexuel marqué.
Certaines espèces comme les faisans et les tragopans présentent des
ornements faciaux ou des caroncules colorées.
Présence en France et en Aquitaine En France, plusieurs espèces
de Phasianidés sont présentes, principalement sous forme domestique ou
introduite. La caille des blés (Coturnix coturnix) est une espèce
indigène migratrice. Le faisan commun (Phasianus colchicus), originaire
d’Asie, est largement introduit pour la chasse et s’est naturalisé dans
de nombreuses régions, y compris en Nouvelle-Aquitaine. Le paon bleu
(Pavo cristatus) est parfois élevé en captivité pour l’ornement. En
Aquitaine, les Phasianidés sont présents dans les milieux agricoles, les
zones boisées et les élevages de gibier. La caille est aussi élevée pour
la consommation, notamment dans les Landes et le Lot-et-Garonne.
Particularités Les Phasianidés se distinguent par leur
comportement terrestre, leur reproduction au sol et leur dimorphisme
sexuel. Leurs poussins sont nidifuges, capables de se déplacer et de se
nourrir seuls dès l’éclosion. Les mâles de certaines espèces adoptent
des parades nuptiales spectaculaires. Leur régime alimentaire est
omnivore, incluant graines, insectes et végétaux. Plusieurs espèces sont
domestiquées ou élevées pour la chasse, comme le faisan et la caille.
Leur vulnérabilité à la prédation est compensée par des stratégies de
camouflage et une forte fécondité. Certaines espèces exotiques sont
menacées par la perte d’habitat et la chasse excessive. |
Columbidés (nicheurs) en
France
|
Espèces en France |
Espèces
representatives |
Description |
Columba
(3 espèces) |
Columba palumbus — Pigeon ramier, ou palombe
Columba livia — Pigeon biset
Columba oenas — Pigeon colombin |
|
Streptopelia
(2
espèces |
Streptopelia turtur — Tourterelle des bois
Streptopelia decaocto — Tourterelle turque |
|
Ptérocliformes
(nicheurs) en
France
|
Espèces en France |
Espèces
representatives |
Description |
Ptéroclidés
(2
espèces) |
Pterocles alchata — Ganga cata
Pterocles orientalis — Ganga unibande
|
|
Apodiformes
(nicheurs) en
France
|
Espèces en France |
Espèces
representatives |
Description |
Apodididés
(4
espèces) |
Apus apus — Martinet noir
Apus pallidus — Martinet pâle
Apus melba — Martinet à ventre blanc
Tachymarptis europaeus — Martinet de montagne |
|
Caprimulgiformes
(nicheurs) en
France
|
Espèces en France |
Espèces
representatives |
Description |
Caprimulgidés
(1 espèce) |
Caprimulgus europaeus — Engoulevent d’Europe |
|
Cuculiformes
(nicheurs) en
France
|
Espèces en France |
Espèces
representatives |
Description |
Ccuculidés
(1 espèce) |
Cuculus canorus — Coucou gris |
|
Otidiformes
(nicheurs) en
France
|
Espèces en France |
Espèces
representatives |
Description |
Otididés
(1 espèce) |
Tetrax tetrax — Outarde canepetière |
|
Procellariiformes
(nicheurs) en
France
|
Espèces en France |
Espèces
representatives |
Description |
Procellariidés
(3 espèces) |
Puffinus yelkouan — Puffin yelkouan
Calonectris diomedea — Puffin cendré
Puffinus puffinus — Puffin des Anglais |
|
Hydrobatidés
(2 espèces) |
Hydrobates pelagicus — Océanite tempête
Hydrobates leucorhous — Océanite cul-blanc |
|
Suliformes
(nicheurs) en
France
|
Espèces en France |
Espèces
representatives |
Description |
Phalacrocoracidés
(2 espèces) |
Phalacrocorax carbo (Grand Cormoran)
Phalacrocorax aristotelis (Cormoran huppé) |
|
Rapaces (nicheurs) en
France
|
Espèces en France |
Espèces
representatives |
Description |
Falco
(5 espèces) |
Falco peregrinus (Faucon pèlerin)
(moins de 45 cm, enverg 91-115 cm, moins de 1,5 kg)
Falco tinnunculus (Faucon crécerelle)
(moins de 40 cm, enverg 65-82 cm, moins de 300 g)
Falco subbuteo (Faucon hobereau)
(moins de 35 cm, enverg 70-84 cm, moins de 250 g)
Falco naumanni (Faucon crécerellette)
(moins de 35 cm, enverg 63-72 cm, moins de 200 g)

 |
Taille et description Les espèces du genre Falco sont
des rapaces diurnes de taille moyenne, mesurant entre 27 et 50 cm selon
les espèces, avec une envergure allant de 63 à 115 cm. Leur corps est
élancé, leurs ailes longues et pointues, et leur vol rapide et nerveux.
Le bec est court, crochu, avec une encoche caractéristique appelée «
dent du tomial » qui aide à tuer les proies. Leurs serres sont
puissantes, adaptées à la capture d’oiseaux, de petits mammifères ou
d’insectes selon les espèces.
Présence en France et en Aquitaine Le genre Falco est bien
représenté en France avec plusieurs espèces nicheuses ou migratrices. Le
faucon crécerelle (Falco tinnunculus) est le plus commun, présent dans
tous les milieux ouverts, y compris en zone urbaine. Le faucon pèlerin
(Falco peregrinus), autrefois menacé, est désormais bien rétabli et
niche sur les falaises naturelles ou les bâtiments. Le faucon hobereau
(Falco subbuteo) est un migrateur estival, plus discret, présent dans
les zones boisées ouvertes. Le faucon crécerellette (Falco naumanni),
espèce rare et menacée, est observé dans le sud-ouest, notamment en
Nouvelle-Aquitaine, où des colonies sont suivies dans des bâtiments
agricoles et villages anciens.
Particularités Les faucons se distinguent des autres rapaces
par leur technique de chasse en vol, souvent spectaculaire. Le faucon
pèlerin est célèbre pour ses piqués fulgurants, le crécerelle pour son
vol stationnaire, et le hobereau pour ses poursuites acrobatiques
d’insectes. Leur vue est extrêmement développée, leur permettant de
repérer une proie à grande distance. Certaines espèces, comme le
pèlerin, ont su s’adapter à l’environnement urbain, utilisant les
structures humaines comme perchoirs et sites de nidification.
Dangerosité Les faucons ne représentent aucun danger pour
l’humain. Ils sont strictement carnivores et ne s’attaquent pas à des
proies trop grandes. Leur présence est bénéfique pour la régulation des
populations de pigeons, étourneaux, rongeurs ou insectes. Ils ne sont
pas vecteurs de maladies et évitent généralement le contact avec
l’homme. Leur protection est assurée par la législation française, et
toute perturbation de leur nidification est interdite. |
Pandion
(1 espèce) |
Pandion haliaetus (Balbuzard pêcheur)
(moins de 70 cm, enverg 127-174 cm, moins de 2 kg)
 |
Taille et description Le balbuzard pêcheur (Pandion
haliaetus) est un grand rapace diurne mesurant entre 50 et 66 cm, avec
une envergure de 127 à 174 cm. Son poids varie de 1,2 à 2 kg, la femelle
étant plus lourde que le mâle. Il possède un plumage contrasté avec le
dos brun foncé et le ventre blanc, une tête blanche barrée d’un masque
noir, des yeux jaunes et un bec crochu adapté à la capture de poissons.
Ses pattes sont munies de griffes puissantes et de coussinets rugueux
facilitant la préhension des proies aquatiques.
Présence en France et en Aquitaine Espèce autrefois rare, le
balbuzard pêcheur est désormais bien implanté en France, notamment dans
les zones humides riches en poissons. Il niche principalement dans le
centre et l’ouest du pays, avec des populations en augmentation. En
Nouvelle-Aquitaine, il est observé en migration et parfois en
reproduction dans des secteurs favorables comme les grands lacs landais,
les estuaires et les zones forestières proches de plans d’eau. Des
plateformes de nidification artificielles ont été installées pour
favoriser son retour
Particularités C’est un piscivore spécialisé, capturant ses
proies en plongeant en piqué depuis les airs. Il possède des adaptations
uniques parmi les rapaces, comme des narines fermables et des serres
réversibles. Il est le seul représentant de la famille des Pandionidae.
Son aire de nidification est souvent construite sur des supports élevés
comme des arbres morts, pylônes ou plateformes artificielles. Il migre
vers l’Afrique subsaharienne en hiver et revient au printemps pour se
reproduire.
Dangerosité Le balbuzard pêcheur est totalement inoffensif pour
l’humain. Il ne s’attaque qu’aux poissons et ne présente aucun risque
sanitaire ou comportement agressif. Son impact sur les populations
piscicoles est négligeable dans les milieux naturels. Il est protégé par
la législation française et son observation est encouragée dans le cadre
de programmes de conservation et de sensibilisation |
Gypaetinés
(1 espèce) |
Gypaetus barbatus (Gypaète barbu)
(moins de 150 cm, enverg 266-282 cm, moins de 10 kg)
 |
Taille et description Le gypaète barbu (Gypaetus
barbatus) est un grand vautour au corps élancé mesurant entre 100 et 115
cm, avec une envergure de 266 à 282 cm et un poids de 5 à 7 kg.
Il possède une silhouette unique avec des ailes étroites et
pointues, une longue queue cunéiforme et une tête emplumée ornée d’un
masque noir descendant sous le bec en forme de barbe. Son plumage adulte
est crème ou orangé contrastant avec les ailes gris ardoisé. Les jeunes
sont brun foncé avec une tête noire. Son vol est souple et adapté au
relief montagneux.
Présence en France et en Aquitaine Le gypaète barbu est l’un
des quatre vautours présents en France. Il subsiste dans les Pyrénées,
les Alpes (où il a été réintroduit), la Corse et le Massif central. En
Nouvelle-Aquitaine, sa présence est limitée aux Pyrénées occidentales,
notamment dans les Hautes-Pyrénées et les Pyrénées-Atlantiques. Il est
absent des zones de plaine comme la Gironde. La population pyrénéenne
est la plus ancienne et compte plus de 100 couples reproducteurs.
Particularités Ce vautour est spécialisé dans la consommation
d’os, qu’il casse en les laissant tomber de 50 à 100 mètres sur des
rochers pour en consommer les éclats et la moelle. Il peut avaler
certains os entiers et digère leur contenu grâce à un suc gastrique très
acide. Contrairement aux autres vautours, il transporte les morceaux
avec ses pattes et attend souvent que les autres charognards aient
terminé avant d’intervenir. Il est monogame et fidèle à son aire de
nidification, souvent située dans une grotte ou un renfoncement rocheux.
Dangerosité Le gypaète barbu est totalement inoffensif pour
l’humain. Il ne chasse pas d’animaux vivants et se nourrit exclusivement
de cadavres, principalement d’os. Les légendes anciennes le décrivant
comme prédateur d’agneaux ou responsable de la mort d’Eschyle sont
infondées. Il est protégé par la loi et fait l’objet de programmes de
conservation en France et en Europe. Sa rareté en fait un indicateur
précieux de la qualité écologique des milieux montagnards. |
Elaninés
(1 espèce) |
Elanus caeruleus (Élanion blanc)
(moins de 35 cm, enverg 78-95 cm, moins de 300 g)
 |
Taille et description L’élanion blanc (Elanus
caeruleus) est un petit rapace diurne mesurant entre 30 et 35 cm, avec
une envergure d’environ 78 à 95 cm et un poids variant de 240 à 280 g.
Il possède une tête large et blanche, des yeux rouges cerclés de noir,
un bec court et crochu, des ailes longues et pointues, et une queue
courte légèrement fourchue. Son plumage est majoritairement blanc avec
des épaules noires bien visibles en vol, ce qui lui vaut le nom anglais
de black-shouldered kite.
Présence en France et en Aquitaine Originaire d’Afrique
subsaharienne et d’Asie, l’élanion blanc a colonisé le sud-ouest de
l’Europe depuis les années 1980. En France, il est apparu dans les
années 1990 dans le sud-ouest, avec une progression lente mais
régulière. Depuis 2018, son expansion s’est accélérée et il est
désormais bien implanté dans toute la Nouvelle-Aquitaine, à l’exception
du Limousin. Il niche dans les zones ouvertes, les cultures, les vergers
et les lisières boisées, souvent près des routes et des villages.
Particularités Ce rapace chasse principalement les petits
rongeurs, notamment les campagnols, qu’il repère depuis un perchoir ou
en vol stationnaire. Son vol est souple et silencieux, avec des
battements lents et des phases de vol plané. Il peut rester immobile
dans les airs comme le faucon crécerelle. Il niche dans les arbres,
souvent à faible hauteur, et peut se reproduire plusieurs fois par an
selon les ressources disponibles. Son installation rapide dans de
nouveaux territoires est facilitée par sa plasticité écologique et son
comportement opportuniste.
Dangerosité L’élanion blanc est totalement inoffensif pour
l’humain. Il ne présente aucun comportement agressif et ne s’attaque
qu’à de petites proies. Son rôle écologique est bénéfique, notamment
dans la régulation des populations de rongeurs agricoles. Il n’est pas
vecteur de maladies et ne cause pas de nuisances. Sa présence croissante
en France est suivie par les naturalistes, mais ne suscite aucune
inquiétude sur le plan sanitaire ou environnemental |
Perninés
(1 espèce) |
Pernis apivorus (Bondrée apivore)
(moins de 60 cm, enverg 135-150 cm, moins de 1 kg)
 |
Talle et description La bondrée apivore (Pernis
apivorus) est un rapace diurne de taille moyenne mesurant entre 52 et 60
cm, avec une envergure de 135 à 150 cm et un poids de 600 à 1000 g. Elle
possède une silhouette proche de celle de la buse mais s’en distingue
par une tête plus fine, des narines étroites, un bec peu crochu et un
plumage très variable allant du brun clair au brun foncé. Sa queue est
longue et barrée, ses ailes larges et arrondies, et son vol est souple
avec de longs planés.
Présence en France et en Aquitaine Espèce migratrice, elle est
présente en France de mai à septembre. Elle niche dans les forêts
mixtes, les bocages et les zones boisées proches de prairies riches en
insectes. En Nouvelle-Aquitaine, elle est bien représentée dans les
départements boisés comme la Dordogne, la Charente, les Landes et la
Gironde, notamment dans les secteurs agricoles et forestiers. Elle migre
vers l’Afrique équatoriale en automne, traversant la Méditerranée et le
Sahara.
Particularités La bondrée est spécialisée dans la consommation
de larves d’hyménoptères, notamment les guêpes et les abeilles. Elle
creuse les nids souterrains pour en extraire les larves grâce à ses
pattes robustes et ses narines étroites qui limitent les piqûres. Son
plumage dense et ses écailles faciales la protègent des attaques. Elle
peut aussi consommer des insectes adultes, des vers et parfois des
petits vertébrés. Son régime alimentaire très ciblé la rend dépendante
de la disponibilité locale des nids de guêpes.
Dangerosité La bondrée apivore est totalement inoffensive pour
l’humain. Elle ne s’attaque qu’à des proies de petite taille et ne
présente aucun comportement agressif. Elle joue un rôle écologique
important dans la régulation des populations d’hyménoptères. Elle n’est
pas vectrice de maladies et ne cause pas de nuisances. Espèce protégée,
elle est sensible aux dérangements en période de nidification et à la
disparition des haies et des zones bocagères. |
Circaetinés
(1 espèce) |
Circaetus gallicus (Circaète Jean-le-Blanc)
 |
Taille et description Le circaète Jean-le-Blanc
(Circaetus gallicus) est un grand rapace diurne mesurant entre 62 et 70
cm, avec une envergure de 170 à 190 cm et un poids de 1,5 à 2,3 kg. Il
possède une tête large et arrondie, des yeux jaunes très expressifs, un
bec puissant et des ailes longues et larges. Son plumage est
majoritairement clair sur le dessous, avec des taches brunes variables,
et plus sombre sur le dessus. Son vol est lent et majestueux, souvent en
cercles au-dessus des zones ouvertes.
Présence en France et en Aquitaine Espèce migratrice, le
circaète est présent en France de mars à octobre. Il niche dans les
zones boisées proches de milieux ouverts, notamment les garrigues, les
landes, les prairies et les cultures. En Nouvelle-Aquitaine, il est bien
représenté dans les Landes, le Périgord, le Lot-et-Garonne et la
Gironde, où il fréquente les secteurs forestiers et agricoles riches en
reptiles. Il migre vers l’Afrique subsaharienne pour l’hiver.
Particularités Le circaète est spécialisé dans la chasse aux
reptiles, en particulier les serpents, qu’il capture au sol après un vol
de prospection. Il peut consommer aussi des lézards et parfois des
amphibiens. Il possède des écailles protectrices sur les pattes et une
grande précision dans l’attaque. Il niche dans les arbres, souvent en
lisière de forêt, et élève un seul jeune par saison. Son vol plané à
haute altitude et ses cris discrets le rendent parfois difficile à
repérer.
Dangerosité Le circaète Jean-le-Blanc est totalement inoffensif
pour l’humain. Il ne s’attaque qu’à des proies spécifiques et ne
présente aucun comportement agressif. Il joue un rôle écologique
important dans la régulation des populations de serpents. Il n’est pas
vecteur de maladies et ne cause pas de nuisances. Espèce protégée, elle
est sensible aux dérangements en période de nidification et à la
disparition des milieux ouverts et des zones de chasse. |
Aegypiinés
(1 espèce) |
Neophron percnopterus (Vautour percnoptère)
 |
Taille et description Le vautour percnoptère (Neophron
percnopterus) est le plus petit des vautours européens. Il mesure entre
58 et 70 cm, avec une envergure de 150 à 170 cm et un poids de 1,6 à 2,4
kg. Il possède un plumage blanc cassé avec des rémiges noires, une tête
nue jaune vif chez l’adulte, et un bec fin légèrement recourbé. Les
juvéniles sont brun foncé et mettent plusieurs années à acquérir le
plumage adulte. Son vol est agile, avec des battements rapides et des
planés élégants, souvent à basse altitude.
Présence en France et en Aquitaine Espèce migratrice, le
vautour percnoptère est présent en France de mars à septembre. Il niche
principalement dans le sud du pays, notamment dans les Pyrénées, les
Causses et les Alpes du Sud. En Nouvelle-Aquitaine, sa présence est
concentrée dans les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées, où il
fréquente les falaises, les gorges et les milieux ouverts. Il est absent
des zones de plaine comme la Gironde. Les populations françaises sont
suivies dans le cadre de programmes de conservation, car l’espèce est
menacée à l’échelle européenne.
Particularités Ce vautour est un charognard opportuniste, se
nourrissant de cadavres, d’excréments, d’œufs et parfois de petits
animaux morts. Il est l’un des rares oiseaux à utiliser des outils : il
casse les œufs à l’aide de pierres qu’il projette avec son bec. Il niche
dans des cavités rocheuses, souvent en falaise, et élève un seul jeune
par saison. Son comportement discret et son régime alimentaire varié lui
permettent de survivre dans des milieux semi-arides et pastoraux.
Dangerosité Le vautour percnoptère est totalement inoffensif
pour l’humain. Il ne chasse pas et ne s’attaque qu’à des proies mortes
ou faciles à consommer. Il joue un rôle écologique important dans le
nettoyage des carcasses et la limitation des risques sanitaires liés à
la décomposition. Il n’est pas vecteur de maladies et ne cause pas de
nuisances. Espèce protégée, elle est vulnérable aux empoisonnements
indirects, aux collisions et à la disparition des pratiques pastorales
traditionnelles. |
Aquilinés
(2
espèces) |
Aquila chrysaetos (Aigle royal)
Aquila pomarina (Aigle pomarin)
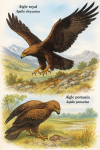 |
Taille et description Les Aquilinés regroupent les
grands rapaces du genre Aquila et apparentés, comme l’aigle
royal (Aquila chrysaetos), l’aigle de Bonelli (Aquila
fasciata) ou l’aigle impérial (Aquila heliaca). Leur
taille varie de 60 à 93 cm selon les espèces, avec une envergure de 180
à 240 cm et un poids allant de 2,5 à plus de 7 kg. Ils possèdent une
silhouette puissante, des ailes larges et longues, une tête massive, un
bec crochu et des serres robustes. Leur plumage est généralement brun,
parfois marqué de taches claires ou de motifs contrastés selon l’âge et
l’espèce.
Présence en France et en Aquitaine L’aigle royal est présent
dans les Alpes, les Pyrénées, le Massif central et la Corse, avec
quelques couples nicheurs dans les Pyrénées-Atlantiques. L’aigle de
Bonelli, plus rare, est cantonné au sud-est et au sud-ouest, notamment
en Provence et dans les contreforts pyrénéens. En Nouvelle-Aquitaine,
seule la frange pyrénéenne accueille des individus nicheurs ou en
dispersion. Les vastes zones forestières et les milieux ouverts de la
région peuvent être fréquentés par des jeunes en erratisme, mais la
reproduction reste localisée.
Particularités Les Aquilinés sont des prédateurs spécialisés
dans la chasse aux mammifères et oiseaux de taille moyenne, comme les
lièvres, marmottes, corvidés ou perdrix. Leur vue perçante leur permet
de repérer une proie à plusieurs kilomètres. Ils construisent des nids
massifs appelés aires, souvent réutilisés chaque année. Leur longévité
est élevée et leur maturité sexuelle tardive. L’aigle royal est
emblématique des milieux montagnards, tandis que l’aigle de Bonelli
préfère les zones rocheuses et semi-arides. Leur comportement
territorial est marqué, avec des parades aériennes spectaculaires.
Dangerosité Les Aquilinés sont totalement inoffensifs pour
l’humain. Ils ne s’attaquent qu’à des proies adaptées à leur taille et
ne présentent aucun comportement agressif envers l’homme. Leur rôle
écologique est essentiel dans la régulation des populations de proies
sauvages. Ils ne sont pas vecteurs de maladies et ne causent pas de
nuisances. Espèces protégées, elles sont sensibles aux dérangements, aux
collisions avec les lignes électriques et à la perte de leur habitat.
Leur conservation repose sur la préservation des milieux naturels et la
limitation des pressions humaines. |
Accipitrinés
(2
espèces) |
Accipiter nisus (Épervier d’Europe)
Accipiter gentilis (Autour des palombes) |
|
Buteoninés
(3
espèces) |
Buteo buteo (Buse variable)
Milvus milvus (Milan royal)
Milvus migrans (Milan noir) |
|
Strigidés
(11 espèces) |
Asio flammeus (Hibou des marais)
Bubo bubo (Grand-duc d’Europe)
Tyto alba (Effraie des clochers)
Aegolius funereus (Nyctale de Tengmalm) |
|
Psittacidés (nicheurs) en
France
|
Espèces en France |
Espèces
representatives |
Description |
Psittacula
(1 espèce) |
Perruche à collier (Psittacula krameri)
(moins de 45 cm, moins de 150 g)
 |
Taille et description La perruche à collier (Psittacula
krameri) mesure entre 38 et 42 cm, dont près de 15 cm pour la queue.
Elle pèse entre 100 et 140 g. Son plumage est vert vif, avec un collier
noir et rose chez le mâle adulte. Le bec est rouge, puissant et
légèrement recourbé. Elle possède une silhouette élancée, un vol rapide
et direct, et un cri strident facilement reconnaissable.
Présence en France et en Aquitaine Introduite par l’élevage et
les échappées de volières, Psittacula krameri s’est naturalisée dans
plusieurs grandes agglomérations françaises. Elle est bien établie en
Île-de-France, à Marseille, à Lyon et dans l’agglomération bordelaise.
En Nouvelle-Aquitaine, sa présence est confirmée dans les parcs urbains
de Bordeaux et ses environs, où elle forme des dortoirs bruyants en
hiver et niche dans les cavités d’arbres ou de bâtiments.
Particularités Espèce exotique capable de s’adapter aux climats
tempérés, elle se distingue par son comportement grégaire et sa capacité
à occuper des niches urbaines. Elle se nourrit de graines, fruits,
bourgeons et parfois de cultures agricoles. Elle niche tôt dans l’année,
ce qui lui permet d’éviter la concurrence directe avec certaines espèces
locales. Son cri perçant et ses rassemblements en dortoirs la rendent
très visible et audible.
Dangerosité Elle ne représente aucun danger direct pour
l’humain. Toutefois, sa prolifération peut entraîner une compétition
avec les espèces cavernicoles locales comme les étourneaux ou les
chouettes chevêches. Elle peut aussi occasionner des nuisances sonores
et des dégâts mineurs sur les cultures fruitières. À ce jour, elle n’est
pas considérée comme invasive à l’échelle nationale, mais sa
surveillance est recommandée dans les zones où les populations
augmentent rapidement. |
Piciformes (nicheurs) en
France
|
Espèces en France |
Espèces
representatives |
Description |
Picidés
(7 espèces) |
Picus viridis — Pic vert
(moins de 40 cm, moins de 250 g)
Dryocopus martius — Pic noir
(moins de 60 cm, moins de 400 g)
Dendrocopos major — Pic épeiche
(moins de 30 cm, moins de 100 g)
Jynx torquilla — Torcol fourmilier
(moins de 20 cm, moins de 50 g)

 |
Taille et description Les Picidés sont des oiseaux dont
la taille varie de 7,5 à 60 cm selon les espèces. Leur morphologie est
adaptée à la vie arboricole : bec droit et tranchant, pattes courtes
avec quatre doigts griffus (parfois trois), deux orientés vers l’avant
et deux vers l’arrière, facilitant l’adhérence aux troncs. Leur queue
rigide leur sert de point d’appui vertical. Leur langue est longue,
collante et munie de crochets, enroulée autour du crâne au repos, et
utilisée pour extraire les insectes du bois ou du sol.
Présence en France et en Aquitaine Neuf espèces de Picidés sont
recensées en France, dont le pic vert, le pic épeiche, le pic cendré et
le pic épeichette. Ces espèces sont bien représentées en
Nouvelle-Aquitaine, notamment dans les zones boisées de Gironde. Le pic
vert (Picus viridis) et le pic épeiche (Dendrocopos major) sont
fréquemment observés dans les forêts mixtes, les parcs et les jardins, y
compris en milieu périurbain
Particularités Les Picidés se distinguent par leur
tambourinage, une forme de communication non vocale où le bec frappe
rapidement une surface résonnante pour marquer le territoire ou attirer
un partenaire. Ce comportement est distinct du martèlement, utilisé pour
creuser le bois. Chaque espèce possède un rythme de tambourinage unique.
Leur capacité à creuser des cavités dans le bois leur permet aussi de
créer des loges de nidification, souvent réutilisées par d'autres
espèces.
Dangerosité Les Picidés ne présentent aucun danger direct pour
l’humain. Ils sont insectivores et jouent un rôle écologique important
dans la régulation des populations de larves xylophages. Leur impact sur
les infrastructures est limité, bien que certains individus puissent
tambouriner sur des surfaces métalliques ou artificielles, causant des
nuisances sonores ponctuelles. Ils ne sont ni agressifs ni vecteurs de
maladies connues pour l’homme |
Coraciiformes (nicheurs) en
France
|
Espèces en France |
Espèces
representatives |
Description |
Alcédinidés
(1 espèce) |
Martin-pêcheur d’Europe (Alcedo atthis)
(moins de 16 cm, moins de 100 g)
 |
Taille et description Les Alcédinidés sont des oiseaux
trapus de petite à moyenne taille, mesurant entre 10 et 45 cm selon les
espèces. Le Martin-pêcheur d’Europe (Alcedo atthis), seul représentant
régulier en France, atteint environ 16 cm. Leur morphologie se
caractérise par une grosse tête, un long bec droit et pointu, des ailes
courtes et arrondies, et une queue très courte. Leur plumage est souvent
éclatant, combinant des teintes métalliques de bleu, turquoise et
orange. Leur vol est rapide, direct et bas au-dessus de l’eau.
Présence en France et en Aquitaine Le Martin-pêcheur d’Europe
est largement répandu en France, bien que localisé selon la qualité des
milieux aquatiques. En Nouvelle-Aquitaine, il est bien présent dans les
zones humides, les rivières lentes, les canaux, les étangs et les
marais, notamment en Gironde, Dordogne et Landes. Il est sédentaire mais
peut effectuer des déplacements hivernaux selon les conditions
climatiques. Il niche dans des berges meubles où il creuse un tunnel
horizontal menant à une chambre de ponte.
Particularités écologiques Les Alcédinidés sont des
spécialistes de la pêche en eau douce. Ils chassent à l’affût depuis une
branche ou un perchoir, plongeant pour capturer des petits poissons,
crustacés ou insectes aquatiques. Leur vue est adaptée à la réfraction
de l’eau, leur permettant une grande précision. Leurs excréments forment
des pelotes de réjection contenant des arêtes et des écailles. Le chant
du Martin-pêcheur est un sifflement aigu, souvent émis en vol. Leur
nidification dépend fortement de la stabilité des berges et de la
qualité de l’eau.
Dangerosité Les Alcédinidés ne présentent aucun danger pour
l’homme. Ce sont des oiseaux discrets, farouches et non agressifs. Leur
bec est adapté à la capture de proies aquatiques de petite taille et ne
constitue aucun risque. Ils jouent un rôle écologique important dans le
contrôle des populations de petits poissons et d’invertébrés aquatiques.
Leur présence est un indicateur de bonne qualité des milieux humides. |
Méropidés
(1 espèce) |
Guêpier d’Europe (Merops apiaster)
(moins de 28 cm, moins de 100 g)
 |
Taille et description Les Méropidés sont des oiseaux
élancés de taille moyenne, mesurant entre 20 et 30 cm selon les espèces.
Leur silhouette est fine, avec un long bec légèrement incurvé vers le
bas, des ailes effilées et une queue souvent prolongée par deux
rectrices centrales allongées. Leur plumage est vivement coloré,
combinant des teintes de vert, bleu, jaune, roux et noir, avec un masque
facial sombre. Leur vol est rapide, souple et acrobatique, souvent
ponctué de glissades et de virages brusques.
Présence en France et en Aquitaine En France, le Guêpier
d’Europe (Merops apiaster) est l’unique représentant régulier de la
famille. Il est nicheur migrateur, présent de mai à septembre,
principalement dans le sud et l’ouest du pays. En Nouvelle-Aquitaine, il
est bien implanté, notamment en Gironde, Dordogne, Lot-et-Garonne et
Charente, où il fréquente les zones ouvertes avec talus sablonneux,
berges de rivières ou carrières pour y creuser ses terriers de
nidification. Les colonies peuvent compter plusieurs dizaines
d’individus.
Particularités écologiques Les Méropidés sont spécialisés dans
la capture d’insectes volants, en particulier les hyménoptères comme les
abeilles, guêpes et frelons, qu’ils saisissent en vol. Avant ingestion,
ils les frappent contre une branche pour retirer le dard. Ils nichent en
colonie dans des tunnels creusés dans des sols meubles, parfois sur
plusieurs mètres. Leur chant est doux, roulé et répétitif, souvent
audible en vol. Leur comportement social est marqué par des interactions
fréquentes entre individus.
Dangerosité Les Méropidés ne présentent aucun danger pour
l’homme. Leur régime alimentaire insectivore est bénéfique pour la
régulation des populations de guêpes et frelons. Ils ne sont ni
agressifs ni nuisibles, et leur bec n’est pas adapté à la prédation sur
des proies de grande taille. Leur présence est généralement bien
accueillie, bien qu’ils puissent être perçus comme concurrents par les
apiculteurs, ce qui reste marginal et non problématique à l’échelle
écologique. |
Coraciidés
(1 espèce) |
Rollier d’Europe (Coracias garrulus)
(moins de 32 cm, moins de 200 g)
 |
Taille et description Les Coraciidés sont des oiseaux
de taille moyenne, mesurant généralement entre 25 et 40 cm. Leur
morphologie se distingue par une grosse tête, des épaules larges, un bec
court à pointe crochue, des ailes moyennes et une queue parfois
prolongée par de longues rectrices médianes. Leur plumage est vivement
coloré, avec une prédominance de bleu, souvent rehaussé de teintes
lilas, turquoise ou vertes. Ils possèdent des pattes courtes et sont
adaptés à la chasse en vol ou depuis un perchoir.
Présence en France et en Aquitaine En France, seule une espèce
est régulièrement observée : le Rollier d'Europe (Coracias garrulus). Il
est nicheur rare mais localisé, principalement dans le sud du pays. En
Nouvelle-Aquitaine, sa présence est sporadique mais attestée, notamment
dans les zones ouvertes de la Gironde et du Lot-et-Garonne, où il
fréquente les milieux semi-ouverts comme les lisières boisées, les
vergers et les prairies avec vieux arbres. Il est migrateur, présent de
mai à septembre, puis repart vers l’Afrique subsaharienne pour
l’hivernage
Particularités écologiques Les Coraciidés sont des prédateurs
spécialisés dans la capture de gros insectes, comme les coléoptères, les
orthoptères et les libellules, mais ils consomment aussi de petits
reptiles, amphibiens et mammifères. Ils nichent dans des cavités
naturelles, souvent dans des arbres ou des talus, et pondent des œufs
blancs et sphériques. Leur vol est puissant et acrobatique, souvent
accompagné de cris rauques. Le Rollier d’Europe est connu pour ses
parades aériennes spectaculaires.
Dangerosité Les Coraciidés ne présentent aucun danger pour
l’homme. Ce sont des oiseaux paisibles, non agressifs, et leur bec
crochu est adapté à la prédation sur de petites proies, sans risque pour
les humains. Ils jouent un rôle écologique bénéfique en régulant les
populations d’insectes |
Bucérotiformes
(nicheurs) en
France
|
Espèces en France |
Espèces
representatives |
Description |
Upupa
(1 espèce) |
Huppe fasciée (Upupa epops)
(26-32 cm, enverg 42-45 cm, moins de 100 g)
 |
Taille La huppe fasciée (Upupa epops) mesure entre 26
et 32 cm de longueur dont 5 à 6 cm pour le bec. Son envergure varie de
42 à 46 cm et son poids de 47 à 89 g.
Description C’est un oiseau de taille moyenne au plumage
chamois orangé avec des ailes et une queue barrées de noir et de blanc.
Il possède une huppe érectile composée de plumes chamois à pointe noire.
Son bec est long, fin et recourbé vers le bas. Son vol est ondulant et
irrégulier, souvent comparé à celui d’un papillon géant .
Présence en France et en Aquitaine La huppe fasciée est
présente dans toute la France, principalement en période de reproduction
entre mars et septembre. Elle est bien représentée en
Nouvelle-Aquitaine, notamment dans les zones bocagères, les prairies,
les vergers, les jardins et les périphéries urbaines. Elle niche dans
des cavités naturelles ou artificielles comme les vieux murs, les
nichoirs ou les anfractuosités d’arbres. C'est
certainement le plus bel oiseau de France et d'Aquitaine. Dissimulée,
elle est quasi invisible dans la nature.
Particularités Son chant est une série de sons sourds
et répétés « houpoupoup » émis par le mâle au printemps. Elle est
capable de déterrer des insectes souterrains grâce à son bec. Elle
fouille aussi les bouses pour y trouver des proies. Elle est solitaire,
peu farouche mais reste distante. Sa huppe dressée est un signal
d’alerte ou d’excitation. Elle peut assommer ses proies sur une pierre
pour en retirer les parties dures.
Dangerosité La huppe fasciée n’est pas dangereuse pour
l’humain. Elle est inoffensive, discrète et ne présente aucun risque
sanitaire ou comportemental. Elle est protégée en France et classée en
préoccupation mineure par l’UICN mais reste vulnérable à la disparition
des habitats et à l’usage de pesticides |
|