|
| |
|
Les Gastéropodes
en France et en Aquitaine |
Les
gastéropodes sont très diversifiés en France et en Aquitaine, avec des
espèces marines, terrestres et d’eau douce, dont certaines sont
endémiques ou fossiles.
Définition et caractéristiques
Les gastéropodes sont des mollusques à coquille univalve torsadée ou
absente. Ils possèdent un pied ventral pour la reptation ou la nage, une
tête avec radula et parfois des yeux. Leur écologie couvre les milieux
marins, dulçaquicoles et terrestres.
Diversité en France La France abrite environ 700 espèces de
gastéropodes terrestres et d’eau douce. On y trouve des escargots comme
Helix aspersa (petit-gris), Cepaea nemoralis (escargot
des bois), des limaces comme Arion vulgaris, et des espèces
aquatiques comme Viviparus contectus. En milieu marin, on
recense des espèces comme Patella vulgata (patelle commune),
Nassarius reticulatus (nasarius réticulé), et Buccinum
undatum (buccin commun).
Spécificités en Aquitaine Le bassin aquitain est riche en
espèces fossiles, notamment du Stampien (Oligocène). Des espèces des
familles Tornidae, Columbellidae, Olividae et Naticidae ont été
identifiées dans les dépôts marins fossiles de cette région. En milieu
actuel, on retrouve des escargots de jardin (Cepaea hortensis),
des limaces forestières, et des espèces aquatiques dans les zones
humides et les rivières comme la Dordogne et la Garonne.
Espèces endémiques et menacées Près de 40 % des gastéropodes
terrestres français sont endémiques. Certains sont menacés par la
destruction des habitats, la pollution et les espèces invasives. Des
programmes de suivi existent via des plateformes comme.
Utilisation et intérêt scientifique Les gastéropodes sont
utilisés en gastronomie (escargots), en bioindication (qualité des
eaux), en paléontologie (fossiles du Stampien), et en éducation pour
illustrer la diversité morphologique et écologique des mollusques. |
|
Espèces présente en France |
Espèces
représentatives |
Description |
Caenogastropodes
(env 130 esp)
La première image présente deux escargots marins illustrés
avec précision : en haut, Littorina littorea, appelé « Ligurian
common », possède une coquille brun foncé, arrondie et lisse avec un
léger bandement ; en bas, Nassarius reticulatus ou « Nassa
reticulata », arbore une coquille plus allongée, claire et ornée d’un
motif réticulé, sur un sol sableux avec une végétation éparse suggérant
un habitat côtier. La seconde image montre deux autres gastéropodes
marins sur le fond océanique entourés de végétation sous-marine : à
gauche, Buccinum undatum ou « Buccin commun », à la coquille
robuste et spiralée ; à droite, Cerith vulgaris ou « Cérite
vulgaire », identifiable par sa coquille plus fine et pointue. Les deux
illustrations permettent une comparaison morphologique et taxonomique
utile à des fins pédagogiques en biologie marine.
|
Littorina littorea — Bigorneau commun
(Moins de 3 cm, moins de 5 g)
Nassarius reticulatus — Nasse réticulée
(Moins de 3 cm, moins de 5 g)
Buccinum undatum — Buccin commun
(Moins de 12 cm, moins de 10 g)
Cerithium vulgatum — Cérite vulgaire
(Moins de 5 cm, moins de 10 g)

 |
Les Caenogastropodes sont très présents en France, y compris en
Aquitaine, et regroupent une diversité d'espèces marines et
dulçaquicoles aux particularités marquées. Leur dangerosité est
généralement faible, mais certaines espèces peuvent présenter des
risques spécifiques.
Présence en France et en Aquitaine Les Caenogastropodes forment
le groupe le plus vaste de gastéropodes, avec une répartition étendue
sur le territoire français. On les retrouve dans les eaux marines de
l’Atlantique, de la Manche et de la Méditerranée, ainsi que dans les
eaux douces. En Aquitaine, leur présence est notable sur le littoral
girondin, dans les estuaires comme celui de la Gironde, et dans les
zones humides intérieures. Les espèces marines incluent des
représentants des super-familles Cerithioidea, Littorinimorpha et
Neogastropoda, tandis que les eaux douces abritent des Architaenioglossa
comme les ampullaires et les planorbes.
Particularités biologiques et écologiques Les Caenogastropodes
se distinguent par une coquille souvent spiralée, un opercule corné ou
calcifié, et une séparation des sexes. Leur morphologie et leur écologie
varient fortement selon les familles. Certains sont herbivores, d’autres
carnivores ou détritivores. Ils jouent un rôle important dans les
chaînes alimentaires et dans le recyclage de la matière organique. Leur
diversité morphologique est liée à des adaptations à des milieux très
variés, allant des abysses marins aux rivières peu profondes. Le groupe
est défini par plusieurs synapomorphies, notamment au niveau du système
nerveux et de la radula
Dangerosité potentielle La majorité des Caenogastropodes ne
présente aucun danger pour l’humain. Toutefois, certaines espèces
marines de Neogastropoda, comme les cônes (genre Conus), possèdent un
venin neurotoxique utilisé pour capturer leurs proies. Ce venin peut
être dangereux en cas de manipulation imprudente, bien que ces espèces
soient rares en France. D’autres espèces peuvent poser des risques
indirects en aquarium ou en milieu naturel, par exemple en favorisant la
prolifération d’algues ou en perturbant les équilibres écologiques si
elles sont introduites hors de leur aire naturelle. En milieu
aquariophile, une mauvaise gestion des paramètres physico-chimiques peut
rendre leur présence problématique |
Hétérobranches
(env. 300 esp)
La première image montre deux mollusques illustrés avec
précision : en haut, la « Grand limace léopard » (Limax maximus),
une limace terrestre au corps allongé et tacheté, rampant sur du bois ;
en bas, la « Limace de mer tachetée » (Aplysia punctata), une
limace marine aux parapodes étendus et aux taches rouges, nageant parmi
des plantes sous-marines. La seconde image présente deux escargots
terrestres sur un sol forestier : en haut, l’« Escargot de Bourgogne » (Helix
pomatia), à coquille claire et globuleuse ; en bas, le « Petit-gris
» (Cornu aspersum), identifiable par sa coquille brune à bandes
marquées. Ces illustrations permettent une comparaison morphologique
entre espèces terrestres et marines, soulignant leur diversité
taxonomique et écologique.
La toisième image montre deux gastéropodes marins sur un fond végétal
sous-marin : en haut, la « Cratène voyageuse » (Cratena peregrina),
un nudibranche aux cérates orange et violets sur un corps translucide ;
en bas, la « Limace rouge commune » (Arion vulgaris), une
limace de mer au corps lisse et rouge rampant sur des algues. La
quatrième image présente deux limaces terrestres sur un sol moussu
: à gauche, la « Limace grise réticulée » (Deroceras reticulatum),
de grande taille et brun foncé ; à droite, l’« Ambrette des marais » (Succinea
putris), plus petite et jaunâtre. Ces illustrations permettent une
comparaison morphologique et écologique entre espèces marines et
terrestres, soulignant leur diversité taxonomique. |
Aplysia punctata — Lièvre de mer tacheté
(Moins de 30 cm, moins de 300 g)
Limax maximus — Grand limace léopard
(Moins de 20 cm, moins de 50 g)
Helix pomatia — Escargot de Bourgogne
(Moins de 10 cm, moins de 50 g)
Cornu aspersum — Petit-gris
(Moins de 5 cm, moins de 50 g)
Cratena peregrina — Cratène voyageuse
(Moins de 5 cm, moins de 5 g)
Arion vulgaris — Limace rouge commune
(Moins de 15 cm, moins de 50 g)
Deroceras reticulatum — Limace grise réticulée
(Moins de 5 cm, moins de 10 g)
Succinea putris — Ambrette des marais
(Moins de 3 cm, moins de 1 g)



 |
Les Hétérobranches sont largement présents en France, y compris
en Aquitaine, avec une diversité remarquable d’espèces marines,
dulçaquicoles et terrestres. Leur dangerosité est faible, mais certaines
espèces peuvent provoquer des irritations ou des déséquilibres
écologiques.
Présence en France et en Aquitaine Les Hétérobranches forment
une sous-classe de gastéropodes très diversifiée, regroupant les anciens
opisthobranches et pulmonés. En France, on les retrouve dans les zones
littorales méditerranéennes et atlantiques, dans les eaux douces, et
dans les milieux terrestres humides. En Aquitaine, leur présence est
attestée sur le littoral girondin, dans les marais, les estuaires, les
rivières, les forêts et les jardins. Les nudibranches marins sont
visibles sur les fonds rocheux et sableux, tandis que les limaces
terrestres et les escargots pulmonés sont communs dans les zones boisées
et agricoles.
Particularités morphologiques et écologiques Les Hétérobranches
se caractérisent par une grande diversité anatomique. Les nudibranches
et autres opisthobranches marins ont souvent perdu leur coquille et
présentent des formes colorées avec des appendices sensoriels. Les
pulmonés, majoritaires en milieu terrestre, possèdent une cavité
palléale transformée en poumon et sont hermaphrodites. Le groupe est
marqué par une détorsion des organes internes et une symétrisation du
système nerveux. Leur régime alimentaire varie : certains sont
herbivores, d’autres carnivores, détritivores ou spécialisés dans la
consommation d’éponges, cnidaires ou algues. Ils jouent un rôle
important dans les écosystèmes comme recycleurs ou prédateurs
spécialisés.
Dangerosité potentielle La plupart des Hétérobranches sont
inoffensifs pour l’humain. Toutefois, certaines espèces marines comme
les nudibranches peuvent accumuler des toxines issues de leurs proies
(cnidaires, éponges) et provoquer des irritations cutanées en cas de
contact. En milieu terrestre, certaines limaces peuvent être vectrices
de parasites comme l’Angiostrongylus cantonensis, bien que ce risque
soit très limité en France. En aquariophilie ou en agriculture,
certaines espèces peuvent devenir envahissantes ou nuisibles, notamment
en cas de déséquilibre écologique. Leur impact est surtout indirect, lié
à la prolifération ou à la compétition avec des espèces locales. Aucun
Hétérobranche n’est considéré comme mortel ou agressif pour l’humain en
métropole |
Néritimorphes
(env. 2 esp)
|
Theodoxus fluviatilis — Nérée des rivières ou
Néritine fluviatile
(Moins de 1 cm, moins de 1 g)
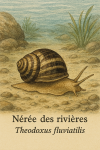 |
Les Néritimorphes sont présents en France dans les milieux
aquatiques, principalement en eau douce et en zone littorale, avec une
faible représentation en Aquitaine. Leur particularité réside dans leur
morphologie robuste et leur adaptation aux substrats durs. Leur
dangerosité est nulle pour l’humain.
Présence en France et en Aquitaine Les Néritimorphes sont un
groupe de gastéropodes aquatiques, majoritairement tropicaux, mais
quelques espèces sont présentes en France métropolitaine. On les
retrouve dans les rivières, les estuaires, les zones rocheuses
littorales et parfois en aquariophilie. En Aquitaine, leur présence
naturelle est marginale, limitée aux zones humides riches en substrats
calcaires ou siliceux. Certaines espèces exotiques sont introduites via
les aquariums ou les bassins d’ornement.
Particularités morphologiques et écologiques Les Néritimorphes
se caractérisent par une coquille épaisse souvent arrondie, un opercule
solide, et une radula adaptée au raclage des algues sur les surfaces
dures. Ils sont généralement herbivores ou détritivores. Leur pied est
puissant, leur coquille souvent décorée de motifs géométriques, et leur
système reproducteur est dioïque. Ils sont bien adaptés aux milieux à
courant ou aux substrats rocheux, avec une tolérance variable à la
salinité selon les espèces.
Dangerosité et interactions Les Néritimorphes sont totalement
inoffensifs pour l’humain. Ils ne produisent pas de toxines et ne sont
pas vecteurs de maladies. En aquariophilie, ils sont appréciés pour leur
efficacité dans le nettoyage des algues. Leur impact écologique est
neutre ou bénéfique dans leur milieu naturel. Les espèces exotiques
introduites peuvent toutefois poser des problèmes de déséquilibre si
elles sont relâchées dans la nature, mais ce risque reste limité en
France métropolitaine. |
Vestigastéropodes
(env. 15 esp)
|
Trochus histrio — Troque peint
Tectus dentatus — Troque dentée
Stomatella varia — Stomatelle variable
Angaria delphinus — Angarie dauphin

 |
Les Vestigastéropodes sont présents en France uniquement dans
les milieux marins rocheux, avec une représentation très limitée en
Aquitaine. Ce groupe primitif de gastéropodes se distingue par sa
morphologie archaïque et sa faible dangerosité.
Présence en France et en Aquitaine Les Vestigastéropodes sont
un groupe ancien de gastéropodes marins, principalement représentés par
les familles des Fissurellidae (patelles à trou) et des Haliotidae
(ormeaux). En France, on les trouve sur les côtes rocheuses de
l’Atlantique, de la Manche et de la Méditerranée. En Aquitaine, leur
présence est rare et localisée, notamment dans les zones rocheuses du
Pays Basque et du nord du golfe de Gascogne. Les substrats sableux et
vaseux de la Gironde ne leur sont pas favorables.
Particularités morphologiques et écologiques Les
Vestigastéropodes se caractérisent par une coquille souvent conique ou
en forme d’oreille, un système nerveux peu centralisé, et une radula
primitive. Ils possèdent des branchies bipectinées et un cœur à deux
oreillettes, témoins de leur position basale dans l’évolution des
gastéropodes. Leur mode de vie est benthique, fixé ou rampant sur les
rochers, où ils se nourrissent d’algues ou de biofilms. Les ormeaux sont
herbivores stricts, tandis que les fissurelles raclent les surfaces
dures.
Dangerosité et interactions Les Vestigastéropodes sont
totalement inoffensifs pour l’humain. Ils ne produisent pas de venin, ne
sont pas vecteurs de maladies, et ne présentent aucun risque sanitaire.
Les ormeaux sont même recherchés pour leur chair en gastronomie, bien
que leur récolte soit réglementée. Leur rôle écologique est modeste mais
positif, contribuant au contrôle des algues et à la structuration des
communautés benthiques. Leur sensibilité aux pollutions et à la surpêche
en fait des indicateurs de la qualité du milieu marin. |
Patellogastéropodes
(env 8 esp)
|
Patella vulgata — Patelle commune
Patella caerulea — Patelle bleue
Cellana radiata — Patelle rayée
Lottia limpets — Patelle digitale

 |
Les Patellogastéropodes sont présents sur les côtes françaises,
notamment en Bretagne, en Méditerranée et dans le Pays basque aquitain.
Ce groupe primitif de gastéropodes marins se distingue par sa coquille
en forme de cône aplati et son adaptation aux substrats rocheux battus
par les vagues. Leur dangerosité est nulle pour l’humain.
Présence en France et en Aquitaine Les Patellogastéropodes sont
exclusivement marins et vivent fixés sur les rochers du littoral. En
France, on les trouve sur les côtes atlantiques, méditerranéennes et
dans la Manche. En Aquitaine, leur présence est concentrée dans les
zones rocheuses du Pays basque, comme à Biarritz ou Hendaye, où les
conditions hydrodynamiques leur sont favorables. Ils sont absents des
plages sableuses et des estuaires vaseux comme ceux du Médoc ou du
bassin d’Arcachon.
Particularités morphologiques et écologiques Ce groupe regroupe
les patelles et leurs proches, comme Patella vulgata ou
Cellana radiata. Leur coquille est conique, épaisse, sans
enroulement spiralé, ce qui leur permet de résister à la force des
vagues. Leur pied est puissant et adhère fortement au substrat. Ils
possèdent une radula spécialisée pour racler les microalgues sur les
rochers. Leur système respiratoire est branchial, et leur cœur possède
deux oreillettes, témoins de leur position basale dans l’évolution des
gastéropodes. Ils sont dioïques et leur reproduction est externe,
souvent synchronisée avec les marées.
Dangerosité et interactions Les Patellogastéropodes sont
totalement inoffensifs pour l’humain. Ils ne produisent pas de toxines,
ne piquent pas, et ne sont pas vecteurs de maladies. Leur rôle
écologique est important : ils contrôlent la croissance des algues sur
les rochers, facilitent la colonisation par d’autres espèces, et servent
de nourriture à certains poissons et crustacés. Ils sont parfois
récoltés localement pour la consommation, mais leur intérêt économique
reste limité. Leur sensibilité à la pollution et à la surfréquentation
des zones littorales en fait de bons indicateurs de la qualité
écologique des habitats rocheux. |
|