Immense et presque vide
Le Canada est l’un
des plus vastes pays du monde, mais sa population est très clairsemée,
concentrée dans une petite portion du territoire. Le Canada s’étend sur près de
10 millions de kilomètres carrés, ce qui en fait le deuxième plus grand pays du
monde après la Russie. Pourtant, il compte environ 40 millions d’habitants, soit
une densité moyenne de moins de 4 personnes par kilomètre carré. Cette faible
densité s’explique par plusieurs facteurs géographiques et climatiques. La
majorité du territoire canadien est recouverte par le Bouclier canadien, une
immense formation rocheuse peu propice à l’agriculture et difficile à aménager.
De vastes régions du nord sont soumises à un climat arctique ou subarctique,
avec des hivers longs et rigoureux, ce qui rend l’habitat humain difficile. En
conséquence, la population se concentre dans le sud du pays, notamment le long
de la frontière avec les États-Unis, où le climat est plus tempéré et les
infrastructures plus développées. Le corridor Québec-Windsor, qui regroupe des
villes comme Montréal, Ottawa et Toronto, concentre une part importante de la
population et de l’activité économique. À l’inverse, les trois territoires du
Nord (Yukon, Territoires du Nord-Ouest, Nunavut) couvrent près de 40 % de la
masse terrestre du Canada mais sont très peu peuplés. Cette géographie
particulière influence fortement l’économie, les infrastructures et les
politiques d’aménagement du territoire. Le Canada doit gérer un immense espace
naturel, souvent difficile d’accès, tout en assurant des services à une
population dispersée. Cela renforce l’image d’un pays « immense et presque vide
», où la nature domine largement l’espace habité.
Les premiers colons
Les premiers colons européens
au Canada sont principalement des Français, arrivés au début du XVIIe siècle,
après plusieurs tentatives infructueuses au XVIe siècle. La colonisation
européenne du Canada commence véritablement avec la fondation de Québec par
Samuel de Champlain en 1608. Avant cela, Jacques Cartier avait exploré le fleuve
Saint-Laurent dès 1534, mais ses tentatives d’implantation furent abandonnées.
Champlain établit un poste permanent à Québec, marquant le début de la
Nouvelle-France. Les premiers colons français viennent surtout de Normandie, du
Poitou, de Bretagne et d’Île-de-France. Ils sont peu nombreux au départ : en
1627, on ne compte qu’une centaine d’habitants dans la colonie. Ces pionniers
doivent affronter un environnement rude, avec des hivers longs et des terres
difficiles à cultiver. Ils construisent des maisons en bois, vivent de chasse,
de pêche et de troc avec les Premières Nations. La vie est marquée par
l’isolement, la débrouillardise et la solidarité. Peu à peu, des villes comme
Trois-Rivières (1634) et Montréal (1642) sont fondées, élargissant le peuplement
le long du Saint-Laurent. Il est essentiel de rappeler que ces colons arrivent
sur des terres déjà occupées par les Premières Nations depuis des millénaires.
Ces peuples autochtones ont développé des cultures riches et diversifiées,
adaptées aux différents environnements du territoire canadien. Les contacts
entre colons et autochtones oscillent entre coopération (notamment pour la
traite des fourrures) et conflits, avec des conséquences durables sur les
sociétés autochtones.
La conquête
La Conquête désigne
la prise de la Nouvelle-France par la Grande-Bretagne entre 1759 et 1760, dans
le cadre de la guerre de Sept Ans. Elle marque un tournant majeur dans
l’histoire du Canada.
La Conquête s’inscrit dans le contexte plus large du conflit mondial entre la
France et la Grande-Bretagne, connu sous le nom de guerre de Sept Ans
(1756–1763). En Amérique du Nord, ce conflit est appelé guerre de la Conquête.
Les hostilités culminent avec deux événements décisifs : la bataille des Plaines
d’Abraham et la capitulation de Montréal. Le 13 septembre 1759, les troupes
britanniques dirigées par le général James Wolfe affrontent les forces
françaises du marquis de Montcalm sur les Plaines d’Abraham, près de Québec. La
victoire britannique entraîne la capitulation de Québec quelques jours plus
tard, le 18 septembre 1759. Le 8 septembre
1760, Montréal capitule à son tour, mettant fin à la résistance française en
Nouvelle-France. Un régime militaire britannique est instauré jusqu’à la
signature du traité de Paris en 1763. Ce
traité officialise le transfert de la Nouvelle-France à la Grande-Bretagne. Les
Canadiens francophones, environ 60 000 à l’époque, deviennent sujets
britanniques. La Proclamation royale de 1763 tente d’imposer des politiques
d’assimilation, mais celles-ci échouent. L’Acte de Québec de 1774 reconnaît
finalement certains droits aux Canadiens, notamment la liberté de religion et le
maintien du droit civil français.
Dix provinces
Le Canada compte dix provinces, chacune avec son propre gouvernement, ses
particularités géographiques, culturelles et économiques. Voici la liste sans
alinéa ni symbole : Alberta Colombie-Britannique Île-du-Prince-Édouard Manitoba
Nouveau-Brunswick Nouvelle-Écosse Ontario Québec Saskatchewan
Terre-Neuve-et-Labrador Ces provinces forment, avec les trois territoires
(Yukon, Territoires du Nord-Ouest, Nunavut), l’ensemble du pays. La majorité de
la population canadienne vit dans les provinces, surtout en Ontario et au
Québec.
A l'emblème de l'érable
L’emblème de
l’érable est associé au Canada depuis le XIXe siècle et incarne l’identité
nationale, la nature et la résilience. La feuille d’érable devient un symbole
militaire dès les années 1860, puis un emblème officiel avec le drapeau canadien
adopté en 1965. Ce drapeau rouge et blanc, orné d’une feuille d’érable stylisée
à onze pointes, représente l’unité du pays et sa diversité culturelle. L’érable
est aussi un arbre emblématique des forêts canadiennes, notamment dans l’Est du
pays, et sa sève donne le sirop d’érable, produit traditionnel et exporté dans
le monde entier. Ce symbole est utilisé dans les armoiries, les logos, les
uniformes et les pièces de monnaie, renforçant son rôle identitaire.
La "porte" du Canada
L’expression «
la porte du Canada » désigne généralement les points d’entrée majeurs du pays,
tant sur le plan géographique qu’historique ou économique. Elle peut évoquer
plusieurs réalités selon le contexte : Sur le plan historique, le fleuve
Saint-Laurent est souvent considéré comme la porte d’entrée du Canada. C’est par
ce fleuve que les premiers explorateurs et colons européens, notamment Jacques
Cartier et Samuel de Champlain, ont pénétré dans le territoire au XVIe et XVIIe
siècles. Québec et Montréal, situées sur ses rives, ont été les premiers foyers
de peuplement. Sur le plan géographique et économique, les grands ports comme
celui de Vancouver à l’ouest et celui de Halifax à l’est jouent un rôle de porte
maritime. Vancouver est la porte du Pacifique, tournée vers l’Asie, tandis
qu’Halifax est un point d’entrée stratégique depuis l’Atlantique. Sur le plan
aérien, l’aéroport international Pearson de Toronto est souvent qualifié de
porte principale du Canada, étant le plus fréquenté du pays et un hub majeur
pour les vols internationaux. Enfin, sur le plan symbolique, certaines régions
frontalières comme Windsor ou Niagara, proches des États-Unis, peuvent aussi
être vues comme des portes terrestres du Canada vers son voisin du sud.
Le pays du grand froid
Le Canada est
souvent surnommé « le pays du grand froid » en raison de son climat rigoureux,
surtout dans ses régions nordiques et continentales. Une grande partie du
territoire connaît des hivers longs et intenses, avec des températures pouvant
descendre bien en dessous de −30 °C. Le nord du pays, notamment le Yukon, les
Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut, est soumis à un climat arctique ou
subarctique, avec du pergélisol, des vents violents et une couverture neigeuse
persistante. Même dans les provinces plus peuplées comme le Québec ou l’Alberta,
les hivers sont marqués par des chutes de neige abondantes et des vagues de
froid. Ce climat a façonné les modes de vie, les habitations, les vêtements et
les infrastructures. Il est aussi à l’origine de traditions comme le carnaval de
Québec, les sports d’hiver et la culture du sirop d’érable. Le froid canadien
est à la fois une contrainte et un élément identitaire, souvent valorisé dans
l’imaginaire national comme symbole de force, de résilience et de proximité avec
la nature.
Du bois et du blé
« Du bois et du
blé » évoque deux des ressources naturelles emblématiques du Canada, qui ont
façonné son économie, son territoire et son identité. Le bois est lié à
l’immensité forestière du pays. Le Canada possède près de 347 millions
d’hectares de forêts, soit environ 9 % des forêts mondiales. Cette ressource a
été exploitée dès les débuts de la colonisation pour la construction, le
chauffage, la marine et l’exportation. Aujourd’hui, l’industrie forestière reste
un pilier économique, notamment en Colombie-Britannique, au Québec et en
Ontario, avec des produits comme le bois d’œuvre, la pâte à papier et les
granulés de bois. Le blé, quant à lui, est associé aux vastes plaines des
Prairies canadiennes : Alberta, Saskatchewan et Manitoba. Ces provinces forment
le cœur agricole du pays, avec des cultures céréalières à grande échelle. Le
Canada est l’un des principaux exportateurs mondiaux de blé, notamment de blé
dur utilisé pour les pâtes. L’agriculture mécanisée, les silos, les chemins de
fer et les coopératives ont structuré cette économie rurale depuis le XIXe
siècle. Ces deux ressources incarnent la dualité du territoire canadien : les
forêts du bouclier et les plaines céréalières, la nature sauvage et l’espace
cultivé. Elles symbolisent aussi le lien entre le sol, le climat et le travail
humain dans la construction du pays.
Trappeurs et pêcheurs
De l'or, de l'uranium et de l'eau
Les communications
Un grand pays industriel
L'encombrant voisin
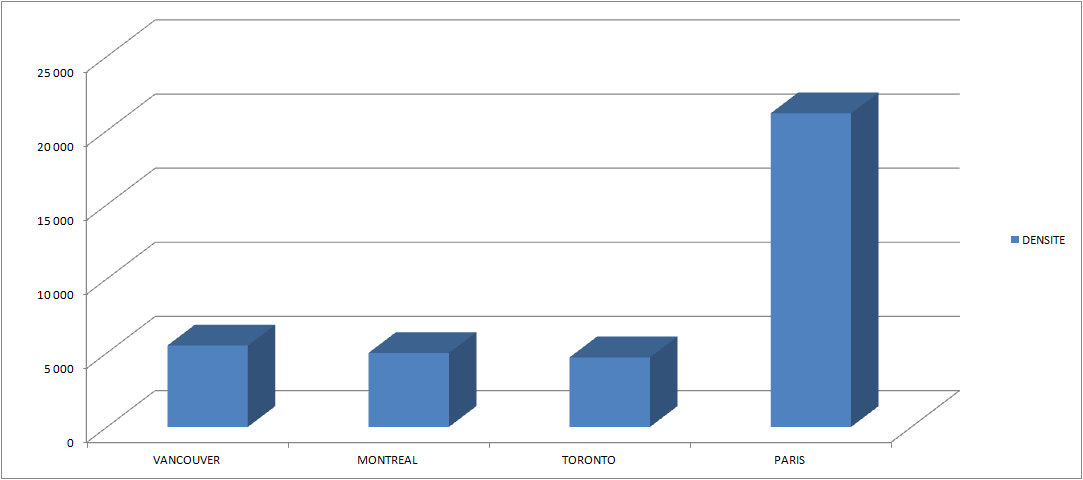








1. Découpage du Canada. 2. John Cabot (v 1450-98). 3. Jacques Cartier
(14491-1557). 4. Guerre de Sept-ans (1756-63), différentes batailles.
5. Nunavut (2.093.113 km²). 6. Colombie Britannique (944.735 km²). 7. Terre Neuve
et Labrador (405.212 km²) 8. Bouclier canadien.