|
| |
Oiseaux de
la ferme (France)
|
Famille |
Espèces
représentatives |
Description |
Phasianidés
L’image montre un groupe de quatre poules dans un poulailler
en bois. Un coq au plumage rouge et noir vif se tient en évidence,
entouré de quatre poules aux couleurs variées : une blanche, une brun
doré, une brun tacheté et une brun clair. Le poulailler possède des
parois en bois et une fenêtre laissant entrer la lumière naturelle, avec
un aperçu de verdure à l’extérieur. Le sol est recouvert de paille ou de
sciure. La scène est bien éclairée et détaillée, mettant en valeur la
texture des plumes et l’ambiance rustique de l’intérieur. En bas de
l’image figure le texte : « Poule domestique – Gallus gallus ». |
Coq, ou Poule domestique (Gallus gallus domesticus)
 |
La poule domestique est l’oiseau le plus répandu au monde,
élevée pour sa chair, ses œufs et ses rôles culturels depuis des
millénaires. Elle s’adapte à tous les types de fermes et milieux
tempérés.
Présence dans le monde Gallus gallus domesticus est l’espèce
aviaire la plus nombreuse sur Terre. Issue de la domestication du coq
doré sauvage (Gallus gallus), elle est présente sur tous les continents,
sauf dans les zones polaires où les conditions extrêmes empêchent sa
survie. Sa répartition mondiale est due à l’action humaine, qui l’a
introduite dans tous les milieux agricoles, urbains et ruraux.
Habitat à la ferme À la ferme, la poule domestique vit dans des
poulaillers ou en plein air selon les systèmes d’élevage. Elle s’adapte
facilement à des environnements variés, pourvu qu’elle dispose d’un
abri, d’un accès à l’eau, à la nourriture (grains, insectes, végétaux)
et à des zones de grattage. Elle est terrestre, nidifuge, peu volante,
et aime se percher pour dormir. Le coq joue un rôle de veille et de
signalement des ressources alimentaires.
Son histoire La domestication de la poule remonte à environ
8000 ans en Asie du Sud-Est. Elle s’est répandue en Inde, en Chine, au
Moyen-Orient, puis en Europe et en Afrique. Elle a été sélectionnée pour
ses aptitudes à pondre, sa chair, son chant et parfois pour des usages
rituels. De nombreuses races ont été créées par les paysans au fil des
siècles, certaines ayant disparu. Le coq est devenu un symbole culturel
fort, notamment en France et en Belgique, où il incarne des valeurs
nationales et religieuses.
Chair de la poule domestique La chair de la poule varie selon
l’âge et le type d’élevage. Le poulet est abattu jeune pour une viande
tendre. La poularde est une jeune poule engraissée, prisée pour sa
finesse. Le chapon, jeune coq châtré et engraissé, offre une chair
particulièrement moelleuse. La viande de poule adulte est plus ferme,
souvent utilisée en bouillon ou en cuisson longue. La sélection
génétique a permis d’optimiser les rendements en viande blanche,
notamment dans les races dites « à croissance rapide » |
Phasianidés
L’image montre deux dindons debout sur un sol en terre
devant une grange en bois, avec une zone clôturée et des arbres en
arrière-plan. À gauche se trouve un dindon sauvage, identifié comme «
Dindon sauvage » avec le nom scientifique « Meleagris gallopavo »,
arborant un plumage sombre, une queue en éventail et une caroncule
rouge. À droite se tient une dinde domestique, également nommée «
Meleagris gallopavo », avec un plumage blanc plus clair et une allure
plus discrète. La scène met en évidence les différences physiques entre
les formes sauvage et domestique, notamment dans la couleur du plumage
et la posture. |
Dinde sauvage, ou domestique (Meleagris gallopavo domesticus)
 |
La dinde domestique est présente dans toutes les régions
tempérées du monde, élevée principalement pour sa chair dans des fermes
industrielles et familiales. Elle est issue de la domestication du
dindon sauvage en Mésoamérique il y a plus de 2000 ans, puis importée en
Europe au XVIe siècle. Sa chair est prisée pour sa richesse en protéines
et sa faible teneur en matières grasses.
Présence mondiale La dinde domestique (Meleagris gallopavo
domesticus) est largement répandue dans les zones tempérées du globe.
Elle est élevée intensivement en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et
dans certaines régions d’Afrique et d’Amérique du Sud. Les États-Unis,
le Canada, la France, l’Allemagne et le Royaume-Uni comptent parmi les
principaux producteurs. Son élevage est favorisé par sa capacité à
produire une grande quantité de viande à faible coût.
Habitat à la ferme En milieu agricole, la dinde domestique est
élevée dans des bâtiments fermés ou semi-ouverts, souvent en groupes
séparés selon l’âge et le sexe. Les mâles (toms ou dindons) sont
généralement plus grands et destinés à la production de viande de
découpe, tandis que les femelles (dindes) sont souvent utilisées pour la
production de viande entière. Les poussins, appelés dindonneaux, sont
élevés sous chaleur artificielle avant d’être transférés dans des
bâtiments d’engraissement. Les conditions d’élevage varient selon les
normes locales, allant de l’élevage intensif à des systèmes plus
extensifs ou biologiques
Histoire de la domestication La domestication de la dinde
remonte à plus de deux millénaires en Mésoamérique, notamment dans le
centre du Mexique. Des recherches archéologiques indiquent une seconde
domestication possible dans le sud-ouest des États-Unis entre 200 av.
J.-C. et 500 ap. J.-C. Les dindes étaient utilisées par les
civilisations précolombiennes pour leur viande, leurs œufs, leurs plumes
et même leurs os comme outils ou instruments. Importée en Europe par les
Espagnols au XVIe siècle, la dinde s’est rapidement intégrée aux
élevages européens, notamment en France dès les années 1530.
Chair et caractéristiques nutritionnelles La chair de la dinde
domestique est réputée pour sa richesse en protéines et sa faible teneur
en lipides, ce qui en fait une viande maigre prisée dans les régimes
alimentaires équilibrés. Elle est particulièrement consommée lors de
fêtes traditionnelles comme Thanksgiving aux États-Unis ou Noël en
France. Les variétés à plumes blanches sont préférées pour l’abattage,
car elles laissent moins de traces visibles sur la carcasse. La viande
peut être préparée rôtie, farcie, en tranches ou en charcuterie |
Phasianidés
L’image représente deux faisans dans un décor rural. Au
premier plan, un mâle arbore un plumage éclatant avec une tête verte, un
visage rouge, un collier blanc autour du cou et des plumes corporelles
brunes et dorées. À l’arrière-plan, une femelle au plumage brun plus
discret présente des marques moins prononcées. Derrière les oiseaux, on
distingue une clôture en bois, un arbre et une structure de type grange,
suggérant un environnement campagnard. L’éclairage doux et le style
pictural de la scène évoquent la vie rurale et la faune locale. |
Faisan de Colchide, ou de chasse (Phasianus
colchicus)
 |
Le faisan de Colchide est présent dans une grande partie de
l’Eurasie et a été introduit dans de nombreux pays pour la chasse et
l’élevage. Il est élevé en captivité dans des fermes spécialisées,
principalement pour sa chair et la régulation cynégétique. Originaire du
Caucase, il est connu en Europe depuis le Moyen Âge. Sa chair est fine,
maigre et appréciée en gastronomie, notamment dans les plats de gibier.
Présence mondiale Le faisan de Colchide (Phasianus
colchicus) est originaire du Caucase et d’Asie occidentale. Il a
été introduit en Europe dès le Moyen Âge, puis en Amérique du Nord, en
Australie et en Nouvelle-Zélande pour la chasse et l’élevage.
Aujourd’hui, il est largement répandu dans les zones tempérées
d’Eurasie, notamment en France, en Allemagne, au Royaume-Uni, en Russie
et en Turquie. Il est également présent dans les zones agricoles et
forestières où il est relâché pour la chasse.
Habitat à la ferme En élevage, le faisan de Colchide est
maintenu dans des volières extérieures ou semi-ouvertes, souvent en
groupes séparés selon l’âge. Les installations comprennent des abris,
des perchoirs et des zones de végétation pour simuler un environnement
naturel. L’élevage vise à produire des individus destinés à la chasse ou
à la consommation. Les jeunes faisans sont élevés sous surveillance
jusqu’à maturité, puis relâchés ou abattus selon les objectifs de
l’exploitation.
Histoire de la domestication Le faisan de Colchide est connu
depuis l’Antiquité. Son nom provient du fleuve Phase en Colchide
(actuelle Géorgie). Il a été introduit en Europe au Moyen Âge, notamment
pour la chasse aristocratique. Bien qu’il ne soit pas totalement
domestiqué comme la poule, certaines variétés sont élevées en captivité.
Des croisements avec des gallinacés domestiques ont été tentés, mais les
hybrides sont stériles. Sa diffusion mondiale est liée à son attrait
cynégétique et gastronomique.
Chair et caractéristiques nutritionnelles La chair du faisan de
Colchide est fine, maigre et savoureuse. Elle est prisée dans la cuisine
de gibier, souvent rôtie, braisée ou en terrine. Elle contient peu de
graisse et offre une texture ferme. Le goût est plus prononcé que celui
du poulet ou de la dinde, ce qui en fait un mets recherché dans les
repas festifs ou gastronomiques. La viande est généralement issue de
mâles adultes, plus charnus, élevés en semi-liberté ou en volière. |
Numididés
L’image montre deux pintades communes debout sur un sol en
terre devant une structure en bois, probablement une grange ou un
poulailler. Elles présentent un plumage sombre parsemé de points blancs
et une tête aux couleurs vives, bleu et rouge. Le texte en bas de
l’image indique « PINTADE COMMUNE – Numida meleagris ». Cette
représentation met en valeur l’apparence singulière de l’espèce, souvent
élevée pour la lutte contre les parasites ou comme volaille. |
Pintade commune (Numida meleagris)
 |
La pintade commune (Numida meleagris) est présente dans de
nombreuses régions du monde, notamment en Afrique, en Europe, en
Amérique et en Asie, où elle est élevée pour sa chair maigre et
savoureuse. Originaire d’Afrique subsaharienne, elle a été domestiquée
dès l’Antiquité et intégrée aux élevages fermiers. Elle vit en groupe
dans des enclos ou des parcours extérieurs, et sa viande est prisée pour
sa finesse et sa faible teneur en graisse.
Présence mondiale La pintade commune est originaire d’Afrique
subsaharienne, où elle vit encore à l’état sauvage dans les savanes
ouvertes. Elle a été introduite en Europe dès l’Antiquité, notamment en
Grèce et à Rome, puis diffusée dans le monde entier. Aujourd’hui, elle
est élevée dans de nombreux pays, notamment en France, en Italie, en
Espagne, au Brésil, en Inde et aux États-Unis. Elle est également
présente dans les Antilles et en Australie, où elle s’est bien
acclimatée.
Habitat à la ferme En élevage, la pintade est maintenue dans
des bâtiments fermés ou en parcours extérieur, souvent en groupes
importants. Elle est sensible au stress et aux variations climatiques,
ce qui nécessite une gestion attentive. Les poussins (pintadeaux) sont
élevés sous chaleur artificielle avant d’être transférés dans des
enclos. Les fermes spécialisées en pintade privilégient des systèmes
semi-extensifs pour favoriser le développement musculaire et la qualité
de la viande. Elle est souvent élevée en complément de volailles comme
les poules ou les dindes
Histoire de la domestication La pintade commune est l’un des
premiers oiseaux à avoir été domestiqués en Afrique. Des représentations
de pintades figurent sur des fresques et bas-reliefs de l’Égypte
ancienne. Elle était connue des Grecs sous le nom de « Meleagris », en
référence à la légende de Méléagre. Les Romains l’appelaient « poule de
Numidie ». Elle a été réintroduite en Europe au XVe siècle et intégrée
aux élevages fermiers. Son nom espagnol « pintado » signifie « bien
fardée », en référence à son plumage tacheté.
Chair et caractéristiques nutritionnelles La chair de la
pintade est maigre, ferme et savoureuse, avec un goût plus prononcé que
celui du poulet. Elle est riche en protéines et pauvre en lipides, ce
qui en fait une viande prisée dans les régimes équilibrés. Elle est
souvent cuisinée rôtie, en cocotte ou en terrine, et accompagne les
repas festifs ou gastronomiques. Les œufs de pintade sont également
consommés, bien que moins courants que ceux de poule. Sa viande est
particulièrement appréciée en France, où elle est considérée comme un
produit de qualité |
Phasianidés
Deux cailles japonaises (Coturnix japonica) se tiennent
sur une litière de paille dans un enclos. Celle de gauche présente un
plumage brun clair moucheté, tandis que celle de droite arbore un
plumage brun-roux plus foncé avec des marques blanches distinctes sur le
visage et le cou. L’arrière-plan montre des parois en bois et un
grillage métallique, suggérant un environnement contrôlé, probablement
dédié à l’élevage ou à la recherche. Le texte visible indique « Caille
japonaise Coturnix japonica ». |
Caille japonaise (Coturnix japonica)
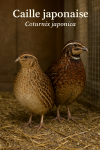 |
La caille japonaise (Coturnix japonica) est présente dans de
nombreux pays à travers le monde, notamment en Asie, en Europe, en
Amérique du Nord et en Afrique, où elle est élevée pour ses œufs et sa
chair. Elle est l’un des oiseaux de ferme les plus répandus en
aviculture légère.
Présence mondiale Originaire d’Asie de l’Est, la caille
japonaise est aujourd’hui élevée dans de nombreux pays, notamment au
Japon, en Chine, en Corée, en Inde, en France, en Italie, aux
États-Unis, au Brésil et en Égypte. Elle est particulièrement populaire
dans les élevages industriels pour la production d’œufs de petite
taille, très prisés en gastronomie et en restauration rapide.
Habitat à la ferme En élevage, la caille japonaise est
maintenue dans des cages ou des volières à densité contrôlée. Elle est
sensible au stress et nécessite un environnement calme, une température
stable et une alimentation équilibrée. Les élevages peuvent être
spécialisés en ponte (cailles pondeuses) ou en chair (cailles de
consommation), avec des cycles de production rapides. Les poussins sont
élevés sous chaleur artificielle et atteignent la maturité sexuelle en
quelques semaines.
Histoire de la domestication La domestication de la caille
japonaise remonte à plus de mille ans au Japon, où elle était élevée
pour ses chants et ses œufs. Elle a été sélectionnée au fil des siècles
pour sa productivité et sa docilité. Au XXe siècle, elle a été
introduite en Europe et en Amérique pour l’aviculture commerciale. Elle
est aujourd’hui distincte génétiquement de la caille des blés (Coturnix
coturnix), bien qu’un croisement soit possible.
Chair et caractéristiques nutritionnelles La chair de la caille
japonaise est fine, tendre et savoureuse. Elle est considérée comme un
mets délicat, souvent servie entière rôtie ou en terrine. Elle est riche
en protéines, pauvre en lipides et offre une texture agréable. Les œufs
de caille sont également très appréciés pour leur goût subtil et leur
présentation en cuisine. La viande est produite à partir de cailles
âgées de 5 à 6 semaines, avec un rendement rapide et une qualité
constante. |
Mammifères
de la ferme (France)
|
Famille |
Espèces
représentatives |
Description |
Bovidés
L’image montre deux bovins debout sur une prairie
verdoyante avec un paysage rural en arrière-plan, incluant des arbres et
une maison. À gauche se tient un taureau brun aux cornes proéminentes, à
droite une vache blanche et brune. Le texte en français identifie les
animaux comme « Taureau », « Vache » et deux fois « Bœuf sauvage »,
suggérant une classification ou une comparaison typologique entre les
individus représentés. |
Taureau, ou vache domestique (Bos taurus)

|
Présence mondiale Bos taurus est présente sur tous les
continents à l’exception de l’Antarctique. Elle constitue l’un des
animaux domestiques les plus répandus au monde avec des effectifs
dépassant le milliard d’individus. Sa répartition varie selon les usages
agricoles les climats et les traditions alimentaires. Les pays à forte
consommation de viande ou de produits laitiers comme les États-Unis le
Brésil l’Inde ou la France concentrent les plus grands cheptels.
Habitat à la ferme La vache domestique est élevée dans des
environnements agricoles adaptés à ses besoins physiologiques et
productifs. En élevage extensif elle pâture dans des prairies naturelles
ou semi-naturelles souvent en rotation. En élevage intensif elle est
maintenue en stabulation avec alimentation contrôlée. Les conditions
varient selon les systèmes agricoles mais incluent généralement abris
points d’eau et zones de repos.
Histoire de la domestication Bos taurus descend du bœuf sauvage
appelé aurochs (Bos primigenius) domestiqué il y a environ dix mille ans
au Proche-Orient et en Europe. Deux grandes lignées ont émergé : les
taurins en Europe et au Moyen-Orient et les zébus en Asie du Sud. La
domestication a été motivée par la force de traction la production de
lait et de viande et la valorisation des sous-produits comme le cuir ou
le fumier. Les croisements et sélections ont donné naissance à des
centaines de races adaptées aux climats et aux usages locaux.
Chair et valorisation alimentaire La viande de Bos taurus est
l’une des principales sources de protéines animales dans de nombreuses
cultures. Elle est consommée sous forme de muscle (steak rôti haché)
d’abats (foie cœur langue) et de préparations transformées (charcuterie
bouillon plats cuisinés). Sa qualité dépend de la race de l’alimentation
de l’âge et des conditions d’abattage. La chair peut être tendre
persillée ou maigre selon les critères recherchés. Elle est également
source de fer de zinc et de vitamines du groupe B. |
Bovidés
L’image montre deux caprinés debout sur un terrain herbeux avec
des arbres et des collines en arrière-plan. À gauche se tient un
bouc à pelage brun foncé et cornes recourbées, identifié comme
Capra aegagrus. À droite se trouve une chèvre domestique à
pelage blanc et cornes plus petites, nommée Capra aegagrus
hircus. L’illustration met en évidence les différences
morphologiques et taxonomiques entre le mâle sauvage et la forme
domestiquée.
|
Chèvre domestique (Capra aegagrus hircus)
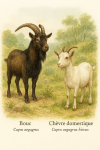 |
Présence mondiale Capra aegagrus hircus est présente
sur tous les continents sauf l’Antarctique. Elle est particulièrement
répandue en Asie en Afrique et dans les régions méditerranéennes où elle
joue un rôle essentiel dans les systèmes agricoles traditionnels. En
2015 la densité caprine mondiale atteignait des niveaux élevés dans les
zones arides et montagneuses grâce à sa capacité d’adaptation aux
milieux pauvres et variés.
Habitat à la ferme La chèvre domestique est élevée dans des
systèmes très divers allant de l’élevage pastoral extensif aux fermes
spécialisées en production laitière. Elle s’adapte aux terrains escarpés
aux zones semi-désertiques et aux milieux tropicaux. En élevage intensif
elle est maintenue en bâtiments avec alimentation contrôlée tandis qu’en
élevage traditionnel elle pâture librement et consomme une végétation
variée incluant broussailles et feuillages.
Histoire de la domestication La chèvre domestique descend de la
chèvre sauvage Capra aegagrus originaire du Moyen-Orient et du Caucase.
Sa domestication remonte à environ dix mille ans dans les régions
montagneuses de l’Iran et de l’Anatolie. Elle fut l’un des premiers
animaux domestiqués pour le lait la viande la peau et les poils. Sa
rusticité et sa capacité à valoriser des ressources végétales pauvres
ont favorisé sa diffusion rapide dans les sociétés agropastorales.
Lait et valorisation alimentaire Le lait de chèvre est consommé
frais fermenté ou transformé en fromages. Il est apprécié pour sa
digestibilité sa richesse en acides gras à chaîne courte et sa teneur en
calcium. Il est utilisé dans la fabrication de fromages traditionnels
comme le crottin le rocamadour ou le chèvre frais. Sa composition varie
selon la race l’alimentation et le mode d’élevage. Il est également
utilisé dans des produits cosmétiques et diététiques pour ses propriétés
nourrissantes et hypoallergéniques |
Bovidés
L’image représente deux moutons dans un décor pastoral
avec arbres et collines en arrière-plan. À gauche se tient un bélier
robuste aux grandes cornes recourbées, identifié comme « Mouton » et «
Ovis aries ». À droite se trouve une brebis à la silhouette plus fine,
dépourvue de cornes, nommée « Brebis ». L’illustration met en évidence
les différences morphologiques et terminologiques entre le mâle et la
femelle de l’espèce domestique Ovis aries. |
Mouton (Ovis aries)
 |
Présence mondiale Ovis aries est l’un des animaux
domestiques les plus répandus au monde avec une population estimée à
plus d’un milliard d’individus. Il est élevé sur tous les continents à
l’exception de l’Antarctique. L’élevage ovin est particulièrement
important en Australie en Nouvelle-Zélande en Chine en Inde en Afrique
du Nord et au Moyen-Orient. Il s’adapte à une grande diversité de
climats allant des zones tempérées humides aux régions arides et
montagneuses.
Habitat à la ferme Le mouton est un ruminant herbivore élevé
principalement en plein air dans des pâturages naturels ou
semi-naturels. En élevage extensif il parcourt de vastes espaces pour se
nourrir d’herbe de broussailles ou de plantes ligneuses. En élevage
intensif ou semi-intensif il peut être complémenté en fourrages et
céréales et parfois maintenu en bergerie selon les saisons. Il est
souvent associé à des systèmes agro-pastoraux ou transhumants dans les
zones montagneuses ou méditerranéennes.
Histoire de la domestication Le mouton domestique descend du
mouflon sauvage d’Asie (Ovis orientalis ou Ovis gmelini) domestiqué il y
a environ dix mille ans au Proche-Orient dans la région du Croissant
fertile. Il fut l’un des premiers animaux domestiqués par l’homme pour
sa laine sa viande et sa peau. La sélection a conduit à une grande
diversité de races adaptées aux climats aux terrains et aux usages
locaux. La domestication a profondément modifié sa morphologie notamment
la toison et la docilité.
Chair et valorisation alimentaire La viande de mouton est
consommée sous forme d’agneau (animal jeune) ou de mouton adulte.
L’agneau est apprécié pour sa tendreté et sa saveur douce tandis que la
viande de mouton adulte est plus forte en goût et utilisée dans des
plats mijotés ou épicés. Elle est une source importante de protéines de
fer et de vitamines B. La qualité de la chair dépend de la race de l’âge
de l’alimentation et du mode d’élevage. Elle est valorisée dans de
nombreuses cultures notamment dans les cuisines méditerranéenne
maghrébine indienne et anglo-saxonne |
Bovidés
|
Porc, ou Cochon domestique (Sus scrofa
domesticus)
 |
Le cochon domestique (Sus scrofa domesticus) est l’animal dont
la viande est la plus consommée au monde. Il est élevé sur tous les
continents sauf l’Antarctique, avec une forte concentration en Chine, en
Europe et en Amérique du Nord.
Présence mondiale Le cochon domestique est présent dans la
majorité des pays du monde, avec une répartition influencée par les
facteurs culturels et religieux. Il est peu élevé dans les pays à
majorité musulmane où sa consommation est interdite. La Chine concentre
près de la moitié du cheptel mondial, suivie par les États-Unis, le
Brésil, l’Allemagne et la France. En France, les élevages sont
particulièrement nombreux en Bretagne et dans le Grand Ouest.
Habitat à la ferme Le cochon est élevé dans des systèmes très
variés allant de l’élevage industriel intensif aux élevages familiaux ou
fermiers. En élevage intensif, il est maintenu en bâtiments fermés avec
alimentation contrôlée et suivi sanitaire rigoureux. En élevage extensif
ou semi-extensif, il peut évoluer en plein air sur des parcours herbeux
ou boisés. Il est omnivore et fouisseur, utilisant son groin pour
chercher sa nourriture dans le sol
Histoire de la domestication Le cochon domestique est une
sous-espèce du sanglier sauvage (Sus scrofa) domestiqué il y a plus de
onze mille ans au Proche-Orient et en Chine. Sa domestication a été
motivée par sa prolificité, sa croissance rapide et sa capacité à
valoriser des déchets alimentaires. Il existe aujourd’hui des centaines
de races locales ou sélectionnées pour la viande, la rusticité ou la
prolificité. En France, on distingue encore des races patrimoniales
comme le Gascon, le Basque ou le Blanc de l’Ouest.
Chair et valorisation alimentaire La viande de porc est la plus
consommée au monde. Elle est valorisée sous forme de muscle (côte,
filet, jambon), d’abats (foie, rognons) et de produits transformés
(charcuterie, saucisses, pâtés). Elle est riche en protéines, en
vitamines B et en zinc. Sa qualité dépend de la race, de l’alimentation,
de l’âge et du mode d’élevage. Elle est centrale dans de nombreuses
cuisines régionales, notamment en Europe, en Asie de l’Est et en
Amérique latine. |
|
Equidés |
Cheval (Equus ferus caballus)
 |
Le cheval domestique (Equus ferus caballus) est présent sur tous
les continents sauf l’Antarctique. Il est élevé pour le travail, le
sport, la compagnie et parfois la viande selon les cultures.
Présence mondiale Le cheval est largement répandu dans le monde
entier avec des densités élevées en Chine, aux États-Unis, au Mexique,
en Russie, au Kazakhstan et en Mongolie. En Europe, la France compte
parmi les pays ayant une tradition équestre forte. Le nombre de chevaux
par kilomètre carré varie selon les usages locaux, allant de l’élevage
utilitaire à l’élevage de loisir ou sportif.
Habitat à la ferme Le cheval est élevé dans des environnements
variés allant des pâturages ouverts aux écuries aménagées. Il préfère
les zones tempérées et les steppes mais s’adapte aussi aux savanes,
marais, forêts claires et zones semi-désertiques. En élevage moderne, il
bénéficie d’abris, d’alimentation contrôlée et de soins vétérinaires
réguliers. En élevage extensif ou traditionnel, il peut vivre en
troupeau sur de vastes parcours.
Histoire de la domestication Le cheval a été domestiqué vers
4000 avant notre ère dans les steppes eurasiatiques, probablement entre
l’Ukraine et le Kazakhstan. Il descend du Tarpan (Equus ferus ferus),
aujourd’hui disparu. Initialement utilisé pour la traction et le
transport, il a rapidement été intégré aux activités militaires,
agricoles et cérémonielles. La sélection a produit une grande diversité
de races adaptées aux climats, aux terrains et aux fonctions
spécifiques.
Chair et valorisation alimentaire La viande de cheval est
consommée dans certaines cultures notamment en France, en Belgique, en
Italie, au Japon et en Asie centrale. Elle est riche en fer, en
protéines et en vitamine B12. Elle est généralement plus maigre que
celle du bœuf et appréciée pour sa tendreté. Sa consommation reste
minoritaire et parfois taboue dans les pays anglo-saxons ou à forte
sensibilité équine. Elle est valorisée sous forme de steaks, saucisses,
charcuterie ou viande séchée. |
|
Equidés |
Âne (Equus africanus asinus)
 |
L’âne domestique (Equus africanus asinus) est présent sur tous
les continents sauf l’Antarctique. Il est élevé principalement pour le
transport, le travail et parfois la viande selon les cultures.
Présence mondiale L’âne est largement répandu dans les régions
arides et semi-arides d’Afrique du Nord, du Sahel, du Moyen-Orient,
d’Asie centrale et d’Amérique latine. Il est également présent en
Europe, notamment dans les zones rurales de France, d’Espagne et
d’Italie. Sa densité est élevée dans les pays où les moyens motorisés
sont rares ou coûteux. En 2022, la population mondiale d’ânes dépassait
les cinquante millions d’individus, avec une forte concentration en
Chine, en Éthiopie, au Mexique et au Pakistan.
Habitat à la ferme L’âne est élevé dans des environnements
rustiques, souvent en plein air, avec accès à des abris simples. Il
s’adapte aux terrains secs, rocailleux ou montagneux et valorise des
ressources végétales pauvres. En élevage traditionnel, il est utilisé
comme bête de somme pour le transport de charges, l’agriculture ou la
traction. En élevage moderne, il peut être intégré à des fermes
pédagogiques, des élevages patrimoniaux ou des systèmes de valorisation
laitière ou carnée.
Histoire de la domestication L’âne domestique descend de l’âne
sauvage d’Afrique (Equus africanus), domestiqué il y a environ sept
mille ans dans la vallée du Nil et les contreforts de la mer Rouge. Deux
sous-espèces ont contribué à sa domestication : l’âne de Nubie et l’âne
somalien. Il a joué un rôle fondamental dans les sociétés pastorales et
caravanières, facilitant le transport de biens et la mobilité des
populations. Des sépultures d’ânes ont été retrouvées dans des tombes
égyptiennes dès 3000 avant notre ère, témoignant de leur importance
sociale et économique.
Chair et valorisation alimentaire La viande d’âne est consommée
dans certaines cultures notamment en Chine, en Italie, en Afrique de
l’Ouest et en Amérique latine. Elle est plus foncée que celle du cheval,
avec une texture ferme et une saveur prononcée. Elle est riche en
protéines et en fer mais reste minoritaire dans les habitudes
alimentaires mondiales. Elle est souvent transformée en charcuterie,
saucisses ou viande séchée. En France, sa consommation est marginale et
parfois taboue, bien que réglementée. |
|
Camélidés |
Lama (Lama glama)
 |
Le lama (Lama glama) est un camélidé domestique originaire des
Andes, élevé pour sa laine, sa force de portage et parfois sa viande,
avec une présence croissante hors d’Amérique du Sud dans des élevages de
niche.
Présence mondiale Le lama est principalement élevé dans les
hauts plateaux andins, notamment en Bolivie, au Pérou, au Chili, en
Argentine et en Équateur. Il est également présent dans des élevages
spécialisés en Amérique du Nord, en Europe et en Australie, souvent à
des fins pédagogiques, touristiques ou textiles. Sa rusticité et sa
capacité à vivre en altitude en font un animal adapté aux milieux
pauvres et escarpés.
Habitat à la ferme Le lama vit dans des environnements ouverts,
secs et montagneux. En élevage traditionnel, il parcourt les steppes
andines à la recherche de végétation clairsemée. En élevage moderne, il
est maintenu dans des enclos ou des pâturages adaptés à sa morphologie
et à ses besoins alimentaires. Il supporte bien les variations de
température et peut vivre en groupe dans des systèmes extensifs ou
semi-extensifs.
Histoire de la domestication Le lama a été domestiqué il y a
plus de quatre mille ans à partir du guanaco sauvage (Lama guanicoe) par
les civilisations précolombiennes des Andes. Il a été sélectionné pour
sa capacité à transporter des charges, sa laine et sa viande. Avant
l’arrivée des Espagnols, il constituait l’un des piliers de l’économie
andine. Contrairement à l’alpaga, domestiqué pour sa fibre, le lama est
plus robuste et utilisé comme bête de somme.
Chair et valorisation alimentaire La viande de lama est
consommée localement dans les Andes, souvent sous forme séchée (charqui)
ou cuite dans des plats traditionnels. Elle est maigre, riche en
protéines et en fer, avec une texture proche de celle du bœuf. Sa
consommation reste marginale en dehors de l’Amérique du Sud, mais elle
est valorisée dans certains circuits de niche pour ses qualités
nutritionnelles et son faible impact environnemental. |
|
Camélidés |
Alpaga (Vicugna pacos)
 |
L’alpaga (Vicugna pacos) est un camélidé domestique originaire
des Andes, élevé principalement pour sa laine mais aussi pour sa viande
dans certaines régions d’Amérique du Sud.
Présence mondiale L’alpaga est majoritairement présent dans les
hauts plateaux andins du Pérou, de Bolivie, du Chili et de l’Équateur.
Le Pérou concentre plus de 80 % de la population mondiale. Il est
également élevé en Europe, en Amérique du Nord, en Australie et en
Nouvelle-Zélande dans des fermes spécialisées pour la laine ou à des
fins pédagogiques et touristiques.
Habitat à la ferme L’alpaga vit dans des zones montagneuses
entre 3500 et 5000 mètres d’altitude. Il s’adapte aux climats froids et
secs et pâture des végétations clairsemées. En élevage moderne, il est
maintenu en enclos ou en pâturages clôturés avec abris contre les
intempéries. Il vit en troupeau et nécessite peu de ressources
alimentaires, ce qui le rend compatible avec des systèmes extensifs.
Histoire de la domestication L’alpaga a été domestiqué il y a
environ deux mille ans par les civilisations précolombiennes des Andes,
notamment les Mochicas et les Incas. Il descend de la vigogne sauvage
(Vicugna vicugna) et a été sélectionné pour la finesse de sa toison.
Contrairement au lama, utilisé comme bête de somme, l’alpaga est plus
gracile et spécialisé dans la production textile. Il existe deux types :
le huacaya à toison dense et bouclée et le suri à fibre longue et
soyeuse.
Chair et valorisation alimentaire La viande d’alpaga est
consommée localement dans les Andes, souvent sous forme séchée (charqui)
ou cuite dans des plats traditionnels. Elle est maigre, riche en
protéines et en fer, avec une texture proche de celle du veau ou du
bœuf. Sa consommation reste marginale hors d’Amérique du Sud, mais elle
est valorisée dans des circuits de niche pour ses qualités
nutritionnelles et son faible impact environnemental |
|