|
| |
Classification (env. 160.000 espèces)
Métazoaires-Triploblastiques-Invertébrés-Protostomiens-Ecdysozoaires-Arthropodes-Mandibulates-Insectes-Néoptères-Ptérygotes-Holométaboles-Diptères
(17 fiches)
(Mouches, moucherons, taons, moustiques...)
|
Sous-ordre |
Espèces |
Description |
|
Nématocères |
env 38.000 esp |
Taille des Nématocères Les adultes mesurent
généralement entre 2 et 20 mm mais certaines tipules peuvent atteindre
30 mm. Les larves sont vermiformes et varient de quelques millimètres Ã
plus de 2 cm selon les familles.
Distribution des Nématocères Les nématocères sont cosmopolites
et présents sur tous les continents sauf l’Antarctique. Ils occupent une
grande diversité de milieux comme les zones humides, les sols
forestiers, les substrats fongiques, les cavités souterraines, les
composts et les milieux extrêmes tels que la toundra ou les déserts.
Description morphologique Les adultes possèdent des antennes
longues et filiformes composées de 6 à 40 articles. Le corps est
généralement gracile avec des ailes allongées et une nervation bien
développée. Les larves sont apodes, souvent cylindriques ou fusiformes,
et vivent dans l’eau, le sol ou la matière organique en décomposition.
Particularités écologiques Les nématocères présentent une
grande diversité de régimes alimentaires. Certains sont hématophages
comme les moustiques et les simulies. D’autres sont saprophages,
fongivores, phytophages ou galligènes. Ils jouent un rôle essentiel dans
les réseaux trophiques, la décomposition et la pollinisation.
Dangerosité potentielle Certains groupes sont vecteurs de
maladies humaines ou animales. Les culicidés peuvent transmettre le
paludisme, la dengue ou le virus du Nil occidental. Les simulies sont
vectrices de l’onchocercose. Les ceratopogonidés peuvent transmettre des
arbovirus chez les ruminants. D’autres familles comme les chironomidés
ou les tipulidés sont inoffensives et parfois indicatrices de la qualité
des milieux aquatiques. |
|
Brachycères
|
env 23.000 esp |
|
|
Cyclorrhaphes
|
env. 65.000 esp |
|
|
Infra-ordre |
Sous-ordre |
Espèces |
Espèces
representatives |
Description |
|
Axymyiomorpha
|
Nématocères |
env 7 esp |
Axymyia furcata → Axymye fourchue
Mesaxymyia stackelbergi → Axymye de Stackelberg
Protaxymyia japonica → Axymye du Japon
Plesioaxymyia vespertina → Axymye vespérale
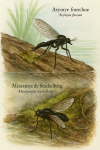
 |
Taille Les espèces de l’infra-ordre Axymyiomorpha,
représentées uniquement par la famille Axymyiidae, mesurent entre 5 et 8
millimètres. Les adultes sont élancés, avec des ailes transparentes et
nervurées, et un corps sombre parfois légèrement brillant.
Description et comportement Les Axymyiidae sont des diptères
nématocères primitifs. Les adultes sont rarement observés, probablement
crépusculaires ou discrets. Les larves se développent dans le bois en
décomposition, souvent dans des troncs humides ou partiellement
immergés. Leur cycle de vie est mal connu, mais semble lié à des
microhabitats forestiers très spécifiques. Le comportement reproducteur
et les interactions écologiques sont peu documentés.
Distribution Le groupe est extrêmement rare et peu étudié. Il
est connu en Amérique du Nord, en Asie et en Europe centrale. Le groupe
est parfois inclus dans Bibionomorpha dans les classifications
anciennes.
Particularité Axymyiomorpha est un infra-ordre monotypique,
créé en 1981 pour distinguer les Axymyiidae des autres nématocères. Il
représente une lignée très ancienne de diptères holométaboles. Les
espèces connues sont rares, avec seulement sept espèces vivantes et
quelques fossiles décrits. Leur
morphologie larvaire et adulte présente des traits archaïques, utiles
pour les études phylogénétiques.
Dangerosité Les Axymyiidae sont totalement inoffensifs. Ils ne
piquent pas, ne transmettent aucune maladie et ne sont pas nuisibles.
Leur rôle écologique est discret mais positif, contribuant à la
décomposition du bois mort. |
|
Bibionomorpha
|
Nématocères |
env 3.000 esp |
Bibio johannis — Bibion noir de Johannis
Dilophus nigrostigma — Bibion néo-zélandais Ã
taches sombres
Sciara militaris — Sciara militaire
Mycetophila cingulum — Mycétophile ceinturé |
|
|
Blephariceromorpha
|
Nématocères |
env 200 esp |
Blepharicera tenuipes Moucheron à ailes réticulées
nord-américain
Deuterophlebia shasta Moucheron glaciaire du mont Shasta
Blepharicera japonica Moucheron à ailes réticulées du
Japon
Nymphomyia dolichopeza Moucheron relique à longues pattes
 |
|
|
Culicomorpha
|
Nématocères |
env 5.000 esp |
Anopheles gambiae : Anophèle gambien
Culicoides sonorensis Cératopogon de Sonora
Corethrella appendiculata Coréthrelle appendiculée
Simulium yahense Simulie de Yahé |
|
|
Psychodomorpha
|
Nématocères |
env 1.000 esp |
|
|
|
Ptychopteromorpha
|
Nématocères |
env. 80 esp |
|
|
|
Tipulomorpha
|
Nématocères |
env 15.000 esp |
|
|
|
Stratiomyomorpha
|
Brachycères |
env 2.000 esp |
|
|
|
Tabanomorpha
|
Brachycères |
env. 4.000 esp |
|
|
|
Xylophagomorpha
|
Brachycères |
env 200 esp |
|
|
|
Asilomorpha
|
Brachycères |
env 30.000 esp |
|
|
|
Muscomorpha
|
Brachycères |
env 40.000 esp |
|
|
|