|
| |
|
Les Mammifères en
France et en Aquitaine |
La
France métropolitaine abrite environ 180 espèces de mammifères réparties
en 11 ordres et 40 familles, dont plusieurs sont présentes en Aquitaine.
Ordres représentés Les mammifères français incluent les
Carnivora (renard, blaireau, loup, lynx), Artiodactyla
(cerf, chevreuil, sanglier, chamois), Rodentia (mulot,
campagnol, écureuil, rat), Chiroptera (chauves-souris),
Lagomorpha (lapin, lièvre), Eulipotyphla (hérisson,
musaraigne, taupe), Cetacea (dauphins, rorquals),
Pinnipedia (phoque gris), Perissodactyla (cheval
domestique), Primates (humain), et Sirenia (rare, en
Méditerranée).
Espèces communes en Aquitaine La région Nouvelle-Aquitaine
accueille des espèces comme le chevreuil, le sanglier,
le blaireau, le renard roux, le lapin de garenne,
le lièvre d’Europe, le hérisson commun, le mulot
sylvestre, le campagnol terrestre, et plusieurs
chauves-souris (dont Pipistrellus pipistrellus). Le
cerf élaphe est présent dans les Landes et le Périgord. Le lynx
boréal est absent, mais le chat forestier est signalé dans
certains massifs boisés.
Espèces aquatiques et marines Le littoral aquitain permet
l’observation de dauphins communs, marsouins, et
parfois de rorquals. Le phoque gris est
occasionnellement observé sur la côte atlantique.
Espèces menacées et protégées Plusieurs espèces sont classées
comme vulnérables ou en danger selon la liste rouge
UICN France, notamment certaines chauves-souris, le desman des
Pyrénées, et le grand hamster d’Alsace (non présent en
Aquitaine). Des espèces introduites comme le rat surmulot ou le
ragondin sont bien acclimatées mais peuvent poser des problèmes
écologiques.
Absence d’endémisme actuel Il n’existe plus de mammifère
endémique strictement français. La musaraigne corse (Asoriculus
corsicanus) s’est éteinte au Moyen Âge.
Utilisation et intérêt scientifique Les mammifères sont étudiés
pour leur rôle écologique, leur comportement, leur génétique, et leur
interaction avec les milieux anthropisés. Ils sont aussi utilisés comme
bioindicateurs et dans les programmes de conservation. |
Rongeurs présents en
France (Etat sauvage)
|
Espèces en France |
Espèces
representatives |
Description |
Castoridés
(1 espèce)
Le dessin représente un castor d’Europe (Castor fiber)
installé au bord d’un plan d’eau, en train de ronger un tronc de
bouleau. L’animal possède un corps massif recouvert d’un pelage brun,
une large queue plate en forme de palette et de grandes incisives
visibles, adaptées à la coupe du bois. L’arrière-plan montre un
environnement naturel composé d’eau, d’herbes et d’arbres, suggérant son
habitat typique en zone humide. Cette scène met en valeur le rôle
écologique du castor comme ingénieur des milieux aquatiques.
|
Castor fiber — Castor d’Europe
(80-110 cm, moins de 30 kg)
 |
Taille et morphologie Le Castor d’Europe (Castor fiber)
mesure entre 110 et 140 cm queue comprise. La queue plate atteint
environ 30 cm. Le poids varie de 17 à 31 kg. Le pelage est brun dense,
imperméable, avec deux couches isolantes. Les pattes postérieures sont
palmées, adaptées à la nage. Le dimorphisme sexuel est peu marqué.
Présence en France L’espèce est protégée et en expansion. Elle
avait disparu de nombreuses régions au XIXe siècle mais a été
réintroduite avec succès. Elle est désormais présente dans les bassins
du Rhône, de la Loire, de la Seine, de la Moselle, de la Garonne et de
l’Adour. Sa progression est continue vers l’ouest et le nord.
Présence en Nouvelle-Aquitaine Le Castor est bien établi dans
le bassin de la Vienne et du Creuse. En Gironde, sa présence est
confirmée sur la Dordogne amont et moyenne, avec des indices sur l’Isle
et la Dronne. Il est absent des zones littorales et des marais côtiers.
Sa répartition reste lacunaire dans les Landes et le Pays basque.
Habitat Il fréquente les rivières lentes, les fleuves, les
canaux et les étangs bordés de ripisylve. Il construit des huttes ou des
terriers avec accès subaquatique. Il sélectionne les zones riches en
saules, peupliers et autres feuillus tendres. Il évite les cours d’eau
trop artificialisés ou à débit instable.
Dangerosité Le Castor d’Europe n’est pas dangereux pour
l’homme. Il est discret, crépusculaire et fuit le contact. Ses incisives
puissantes sont utilisées pour abattre des arbres mais ne sont pas
employées en attaque. Les cas de morsure sont rarissimes et liés à des
manipulations imprudentes. Il ne transmet pas de zoonose majeure en
France. Son impact écologique est bénéfique : il favorise la
biodiversité en créant des zones humides. |
Myocastoridés
(1 espèce)
Le dessin représente un ragondin (Myocastor coypus) dans
un environnement humide, au bord d’un plan d’eau bordé d’herbes et de
roseaux. L’animal possède un corps trapu recouvert d’un pelage brun, des
pattes courtes, une longue queue et un museau émoussé. Sa posture et son
emplacement illustrent son mode de vie semi-aquatique, typique des zones
marécageuses. Cette représentation met en évidence les caractéristiques
physiques et écologiques de cette espèce connue pour son impact sur les
milieux humides.
|
Myocastor coypus – Le ragondin (ou nutria)
(75-110 cm, moins de 9 kg)

|
Taille et morphologie Le ragondin (Myocastor coypus)
mesure de 40 à 60 cm, avec une queue cylindrique de 25 à 45 cm. Son
poids varie de 5 à 10 kg. Il possède un pelage brun foncé à brun roux,
plus clair sur le ventre. Ses incisives sont larges et orange vif. Les
pattes postérieures sont partiellement palmées. Il est plus massif que
le rat musqué, avec un museau carré et une queue non aplatie.
Présence en France Originaire d’Amérique du Sud, le ragondin a
été introduit en France au XIXe siècle pour l’exploitation de sa
fourrure. Il s’est largement naturalisé et colonise aujourd’hui la
quasi-totalité du territoire, notamment les zones humides du nord, du
sud-ouest, du centre et du bassin parisien. Il est inscrit depuis 2016
sur la liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour
l’Union européenne.
Présence en Nouvelle-Aquitaine L’espèce est très répandue en
Nouvelle-Aquitaine, notamment en Gironde, dans les marais, les canaux,
les rivières et les zones humides agricoles. Elle est bien implantée
dans le Médoc, le bassin de la Garonne, les marais de l’Isle et de la
Dordogne, ainsi que dans les zones humides du littoral. Sa densité est
parfois très élevée, entraînant des campagnes de régulation.
Habitat Le ragondin fréquente les milieux aquatiques calmes :
rivièrese lentes, canaux, étangs, fossés et marais. Il creuse des
terriers dans les berges ou construit des nids flottants. Il est
crépusculaire mais peut être actif en journée. Il se nourrit de végétaux
aquatiques, de céréales et de racines. Il évite les zones à fofrte
salinité ou à gel prolongé.
Dangerosité Le ragondin n’est pas agressif envers l’homme mais
présente plusieurs risques indirects. Il peut transmettre la
leptospirose, une maladie bactérienne grave, par ses urines dans l’eau.
Il provoque des dégâts importants aux berges, aux cultures et aux
infrastructures hydrauliques. Il entre en compétition avec les espèces
locales et modifie les habitats. Sa prolifération nécessite des mesures
de régulation dans plusieurs départements |
Murinés
(env 11 espèces)
L’image comparant la souris domestique (Mus musculus
domesticus) et le rat brun (Rattus norvegicus) montre la
souris au corps fin, aux grandes oreilles et au museau pointu près d’un
terrier, tandis que le rat brun, plus massif, avec des oreilles plus
petites et un museau émoussé, évolue dans une zone herbeuse. L’image du
rat noir (Rattus rattus) et du mulot sylvestre (Apodemus
sylvaticus) présente le rat perché sur une branche, sombre et à
longue queue, et le mulot au sol parmi les feuilles, plus clair et plus
fin. L’illustration du mulot à collier (Apodemus flavicollis)
et du mulot rayé (Apodemus agrarius) montre le premier sur un
rocher avec un collier jaune distinctif, et le second au sol avec des
rayures dorsales sombres. Enfin, l’image du rat des moissons (Micromys
minutus) et de la souris algérienne (Mus spretus)
représente le rat grimpant sur un épi de blé avec une queue enroulée et
un pelage roux, tandis que la souris est au sol avec un pelage gris-brun
et une queue plus courte. Chaque illustration met en évidence les
différences morphologiques et écologiques entre les espèces. |
Mus musculus domesticus — la souris domestique
(12-20 cm, moins de 100 g)
Rattus norvegicus — le rat brun ou surmulot
(25-45 cm, moins de 500 g)
Rattus rattus — le rat noir
(35-45 cm, moins de 300 g)
Apodemus sylvaticus — le mulot sylvestre
(15-22 cm, moins de 100 g)
Apodemus flavicollis — le mulot à collier
(16-24 cm, moins de 100 g)
Apodemus agrarius — le mulot rayé
(15-22 cm, moins de 100 g)
Micromys minutus — le rat des moissons
(10-12 cm, moins de 10 g)
Mus spretus — la souris algérienne
(10-18 cm, moins de 100 g)
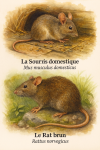


 |
Taille des Murinae Les Murinae sont des rongeurs de
petite à moyenne taille leur longueur corporelle varie de 6 à 25 cm
selon les espèces avec une queue souvent aussi longue que le corps le
poids va de 15 à 300 grammes les espèces les plus communes comme Mus
musculus et Rattus rattus mesurent entre 7 et 20 cm pour
un poids de 20 à 250 grammes
Présence en France et en Aquitaine Les Murinae sont largement
représentés en France et en Nouvelle-Aquitaine on y trouve notamment le
rat noir Rattus rattus le rat brun Rattus norvegicus
la souris domestique Mus musculus et plusieurs espèces de
Apodemus comme le mulot sylvestre Apodemus sylvaticus ces
espèces sont présentes dans les milieux urbains agricoles forestiers et
parfois littoraux certaines comme Mus spretus sont plus
localisées et typiques du sud-ouest
Habitat Les Murinae occupent une grande diversité de milieux
naturels et anthropisés ils colonisent les habitations les greniers les
égouts les champs les haies les forêts et les zones humides certaines
espèces comme Apodemus flavicollis préfèrent les boisements
denses tandis que Rattus norvegicus s’adapte aux milieux
urbains et portuaires
Dangerosité Les Murinae peuvent présenter des risques indirects
pour l’humain notamment par la transmission de pathogènes comme la
leptospirose la salmonellose ou le hantavirus ils ne sont pas agressifs
mais peuvent mordre en cas de capture ou de stress leur présence en
milieu domestique peut poser des problèmes sanitaires et matériels mais
ils ne représentent pas une menace directe dans les milieux naturels. |
Arvicolinés
(env 16 espèces) |
Arvicola amphibius — le campagnol fouisseur
(18-25 cm, moins de 300 g)
Arvicola sapidus — le campagnol amphibie
(16-22 cm, moins de 300 g)
Microtus arvalis — le campagnol des champs
(10-15 cm, moins de 100 g)
Microtus agrestis — le campagnol agreste
(10-16 cm, moins de 100 g)
Microtus duodecimcostatus — le campagnol provençal
(9-13 cm, moins de 100 g)
Microtus subterraneus — le campagnol souterrain
(8-12 cm, moins de 100 g)
Microtus multiplex — le campagnol de Fatio
(9-14 cm, moins de 100 g)
Clethrionomys glareolus — le campagnol roussâtre
(10-15 cm, moins de 100 g)



 |
Taille des Arvicolinés Les Arvicolinés sont des
rongeurs de petite taille leur longueur corporelle varie de 8 à 20 cm
avec une queue souvent plus courte que le corps le poids est compris
entre 20 et 180 grammes selon les espèces le campagnol terrestre peut
atteindre 20 cm et 180 g tandis que le campagnol agreste reste autour de
10 cm et 30 g
Présence en France et en Aquitaine Les Arvicolinés sont
largement répandus en France et bien représentés en Nouvelle-Aquitaine
on y trouve notamment le campagnol terrestre Arvicola scherman
le campagnol agreste Microtus agrestis le campagnol des champs
Microtus arvalis et le campagnol amphibie Arvicola sapidus
ce dernier est localisé et d’intérêt patrimonial en Aquitaine les
lemmings sont absents du territoire français
Habitat Les Arvicolinés occupent une grande diversité de
milieux prairies humides champs cultivés berges de rivières marais et
forêts claires certaines espèces comme Microtus arvalis
colonisent les terres agricoles tandis que Arvicola sapidus est
inféodé aux milieux aquatiques les galeries souterraines sont fréquentes
chez les espèces fouisseuses
Dangerosité Les Arvicolinés ne sont pas dangereux pour l’humain
ils sont strictement herbivores ou granivores et ne présentent aucun
comportement agressif les risques sont indirects notamment par la
transmission de leptospirose ou d’autres zoonoses en cas de contact avec
les excréments ou l’eau souillée leur impact est surtout agricole avec
des dégâts sur les cultures en cas de pullulation |
Carnivores présents en
France
|
Espèces en France |
Espèces
representatives |
Description |
Félidés
(3 espèces) |
Felis catus — Chat domestique
(varie selon la race)
Felis silvestris — Chat sauvage européen
(55-90 cm, moins de 10 kg)
Lynx lynx — Lynx boréal
(80-130 cm, mois de 35 kg)

 |
Taille des Félidés Les félidés varient de 1 kg (chat à
pieds noirs) à 350 kg (tigre de Sibérie). Leur hauteur au garrot va de
20 cm à 1,20 m et leur longueur de 35 cm à 2,90 m. Leur vitesse maximale
s’étend de 30 km/h (chat domestique) à 120 km/h (guépard).
Présence en France et en Aquitaine En France, les espèces
sauvages présentes sont le chat forestier (Felis silvestris), le lynx
boréal (Lynx lynx) et le lynx pardelle (Lynx pardinus, rare et
localisé). Le chat forestier est largement réparti, y compris en
Nouvelle-Aquitaine. Le lynx boréal est surtout présent dans le Jura et
les Vosges. Le lynx pardelle est en réintroduction dans les Pyrénées
occidentales. En Aquitaine, seule la présence du chat forestier est bien
établie, notamment dans les zones boisées de Dordogne, Landes et
Pyrénées-Atlantiques.
Habitat Les félidés occupent des milieux variés selon les
espèces. Le chat forestier privilégie les forêts mixtes et feuillues,
loin des perturbations humaines. Le lynx boréal fréquente les forêts
denses avec relief. Le lynx pardelle est inféodé aux zones
méditerranéennes ouvertes avec forte densité de proies (lapins). Le chat
domestique, bien que non sauvage, est ubiquiste et peut interagir avec
les espèces sauvages.
Dangerosité Les félidés sauvages présents en France ne sont pas
considérés comme dangereux pour l’homme. Le lynx boréal est discret et
évite les contacts. Le chat forestier est farouche et non agressif. Le
lynx pardelle est extrêmement rare et non menaçant. Le danger potentiel
réside dans les interactions indirectes avec le chat domestique,
notamment par hybridation ou transmission de maladies. Aucun cas
d’agression grave par félidé sauvage n’est documenté en France
métropolitaine |
Canidés
(4 espèces)
|
Canis lupus — Loup gris
(120-160 cm, moins de 50 kg)
Canis familiaris — Chien domestique
(varie selon la race)
Vulpes vulpes — Renard roux
(90-120 cm, moins de 10 kg)
Nyctereutes procyonoides — Chien viverrin
(80-105 cm, moins de 10 kg)
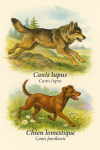
 |
Taille des Canidés Les canidés varient de 24 cm pour le
fennec à plus de 160 cm pour le loup gris. Leur poids va de 0,6 kg à
plus de 70 kg. Le chacal doré mesure entre 65 et 105 cm de long, avec
une hauteur au garrot de 45 à 50 cm et un poids de 7 à 17 kg.
Présence en France et en Aquitaine Les espèces présentes en
France sont le renard roux (Vulpes vulpes), le chien viverrin
(Nyctereutes procyonoides, localisé), le loup gris (Canis lupus) et
depuis peu le chacal doré (Canis aureus) en expansion depuis l’Europe de
l’Est. Le renard roux est largement
répandu en Aquitaine, y compris en Gironde. Le loup est présent dans les
Pyrénées-Atlantiques mais reste rare. Le chacal doré a été détecté dans
plusieurs départements du sud-ouest, avec une colonisation en cours
Habitat Les canidés occupent une grande variété de milieux. Le
renard roux est ubiquiste, présent en forêt, campagne, zones
périurbaines. Le loup préfère les zones montagneuses boisées avec faible
densité humaine. Le chacal doré s’installe dans les mosaïques de terres
agricoles, zones arbustives et plaines humides, mais évite les hautes
montagnes et les zones fortement urbanisées.
Dangerosité Les canidés sauvages présents en France ne sont pas
considérés comme dangereux pour l’homme. Le renard peut transmettre la
rage ou l’échinococcose mais les cas sont rares. Le loup évite l’homme
et les attaques sont exceptionnelles. Le chacal doré est discret et non
agressif. Le chien viverrin peut être porteur de parasites. Le danger
potentiel est surtout indirect, lié aux zoonoses ou aux conflits avec
l’élevage. |
Ursidés
(1 espèce) |
Ursus arctos — Ours brun
(moins de 280 cm, moins de 350 kg)
 |
Taille des Ursidés L’ours brun (Ursus arctos) mesure
entre 1,70 et 2 mètres debout et entre 0,90 et 1,20 mètre au garrot. Son
poids varie de 70 à 230 kg selon le sexe, l’âge et la saison. Les autres
espèces d’Ursidés ne sont pas présentes à l’état sauvage en France.
Présence en France et en Aquitaine L’ours brun est la seule
espèce d’Ursidé présente en France métropolitaine. Sa population est
concentrée dans les Pyrénées, principalement dans les Pyrénées centrales
et occidentales. En Nouvelle-Aquitaine, sa présence est limitée aux
Pyrénées-Atlantiques, avec des individus observés dans les vallées
d’Aspe et d’Ossau. La population française est estimée à une soixantaine
d’individus, issus de réintroductions menées depuis les années 1990.
Habitat L’ours brun occupe une variété de milieux montagnards
selon la saison. Il fréquente les hêtraies-sapinières, les forêts
mixtes, les alpages et les fonds de vallées entre 600 et 2000 mètres
d’altitude. Il utilise des tanières pour l’hivernation et se déplace sur
de vastes territoires à la recherche de nourriture.
Dangerosité L’ours brun est un animal discret et solitaire. Il
évite les humains et les rencontres sont rares. Les attaques sont
exceptionnelles et généralement liées à des situations de surprise ou de
défense. Le danger principal est indirect, lié aux conflits avec
l’élevage ou aux réactions humaines. En France, aucune attaque mortelle
n’a été recensée dans les Pyrénées depuis la réintroduction. |
Mustélidés
(9 espèces)
|
Mustela erminea — l’hermine
(20-30 cm, moins de 300 g)
Mustela nivalis — la belette
(15-25 cm, moins de 200 g)
Meles meles — le blaireau européen
(60-90 cm, moins de 20 kg)
Martes foina — la fouine
(40-55 cm, moins de 5 kg)
Lutra lutra
— Loutre d'Europe
(90-130 cm, moins de 20 kg)
Mustela putorius— Putois
d'Europe
(30-45 cm, moins de 5 kg)
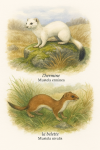

 |
Taille des Mustélidés Les Mustélidés présentent une
grande variabilité morphologique. La belette est le plus petit carnivore
d’Europe avec une longueur de 20 cm et un poids de 60 à 100 g. L’hermine
atteint 30 cm pour 150 à 300 g. Le putois mesure jusqu’à 40 cm pour 1,5
kg. Le blaireau peut dépasser 80 cm et peser jusqu’à 15 kg. La loutre
d’Europe atteint 1,20 mètre avec un poids de 7 à 12 kg.
Présence en France et en Aquitaine Au moins sept espèces sont
présentes en France métropolitaine. La belette (Mustela nivalis),
l’hermine (Mustela erminea), le putois (Mustela putorius), le blaireau
(Meles meles) et la loutre (Lutra lutra) sont bien établis. Le vison
d’Europe (Mustela lutreola) est en danger critique et très rare. Le
vison d’Amérique (Neovison vison), espèce introduite, est localement
présent. En Nouvelle-Aquitaine, toutes ces espèces sont signalées sauf
le vison d’Europe, dont la présence est incertaine. La loutre recolonise
activement les cours d’eau de la région. Le blaireau est commun dans les
zones boisées et agricoles. La belette et le putois sont largement
répartis. L’hermine est plus localisée, surtout en altitude.
Habitat Les Mustélidés occupent des milieux variés. La belette
et l’hermine préfèrent les prairies, bocages et zones de montagne. Le
putois fréquente les zones humides, les haies et les bois. Le blaireau
creuse des terriers dans les forêts et les talus. La loutre est inféodée
aux rivières, étangs et zones humides avec bonne qualité d’eau. Le vison
d’Amérique colonise les berges et les marais. Tous sont discrets et
souvent nocturnes.
Dangerosité Les Mustélidés ne sont pas dangereux pour l’homme.
Ils sont farouches et évitent les contacts. Le blaireau peut se défendre
s’il est acculé mais n’attaque pas. Le putois et le vison d’Amérique
peuvent mordre en cas de capture. La loutre est paisible et non
agressive. Le danger est indirect, lié à la transmission de maladies
(rage, leptospirose) ou à des conflits avec l’élevage avicole. Aucun
Mustélidé français n’est considéré comme une menace sérieuse pour la
sécurité humaine. |
Procyonidés
(1 espèce) |
Procyon lotor — Raton laveur
(60-100 cm, moins de 10 kg)
 |
Taille des Procyonidés Les Procyonidés sont de taille
moyenne. Le raton laveur (Procyon lotor) mesure entre 40 et 70 cm de
long avec une queue de 20 à 40 cm et un poids de 5 à 12 kg. Les coatis
(Nasua spp.) atteignent 1 mètre queue comprise pour un poids de 4 à 7
kg. Le kinkajou (Potos flavus) mesure environ 40 à 60 cm avec une queue
préhensile aussi longue que le corps.
Présence en France et en Aquitaine Le seul Procyonidé présent
en France est le raton laveur, espèce introduite et naturalisée. Il est
établi dans plusieurs régions, notamment dans le nord-est, le centre et
le sud-ouest. En Nouvelle-Aquitaine, sa présence est confirmée dans les
départements de Dordogne, Lot-et-Garonne, Landes et
Pyrénées-Atlantiques. Il est en expansion, avec des observations
régulières en Gironde. Les autres Procyonidés ne sont pas présents à
l’état sauvage.
Habitat Le raton laveur est très adaptable. Il fréquente les
forêts riveraines, les zones humides, les bocages, les parcs urbains et
les bâtiments abandonnés. Il utilise les cavités d’arbres, les terriers
et les structures humaines pour se cacher et se reproduire. Son régime
omnivore lui permet de coloniser des milieux variés, y compris
anthropisés.
Habitat Le raton laveur est très adaptable. Il fréquente les
forêts riveraines, les zones humides, les bocages, les parcs urbains et
les bâtiments abandonnés. Il utilise les cavités d’arbres, les terriers
et les structures humaines pour se cacher et se reproduire. Son régime
omnivore lui permet de coloniser des milieux variés, y compris
anthropisés.
Dangerosité Le raton laveur n’est pas agressif mais peut mordre
s’il est acculé. Il est porteur potentiel de maladies zoonotiques comme
la rage, la leptospirose et le parasite Baylisascaris procyonis. Il peut
aussi provoquer des dégâts dans les poulaillers et les cultures. Sa
dangerosité est donc indirecte, liée à la santé publique et aux
nuisances agricoles. Il est classé espèce exotique envahissante en
France. |
Viverridés
(1 espèce) |
Genetta genetta — Genette d'Europe
(70-105 cm, moins de 3 kg)
 |
Taille des Viverridés Les Viverridés mesurent entre 30
et 100 cm sans la queue, qui peut ajouter 30 à 50 cm supplémentaires.
Leur poids varie de 1 à 14 kg selon les espèces. Leur corps est allongé,
leurs pattes courtes et leur tête fine avec un museau pointu. La genette
commune (Genetta genetta), seul représentant en France, mesure environ
45 cm avec une queue annelée de même longueur et pèse entre 1 et 2 kg.
Présence en France et en Aquitaine La genette commune est la
seule espèce de Viverridé présente à l’état sauvage en France. Elle est
bien établie dans le sud-ouest, notamment en Nouvelle-Aquitaine. Sa
présence est confirmée en Dordogne, Landes, Lot-et-Garonne,
Pyrénées-Atlantiques et Gironde. Elle est absente du nord et du nord-est
de la France. Les autres Viverridés (civettes, binturongs) sont absents
à l’état naturel et uniquement présents en captivité ou dans des
collections zoologiques.
Habitat La genette fréquente les milieux boisés, les zones
rocheuses, les ripisylves et les bocages. Elle utilise les cavités
naturelles, les arbres creux et parfois les bâtiments abandonnés pour se
cacher. Elle est nocturne, arboricole et très discrète. Elle chasse de
petits vertébrés, des insectes et consomme aussi des fruits. Elle
s’adapte bien aux milieux semi-naturels et aux zones peu perturbées.
Dangerosité La genette n’est pas dangereuse pour l’homme. Elle
est farouche, évite les contacts et ne présente aucun comportement
agressif. Elle peut mordre si capturée mais cela reste exceptionnel.
Elle ne transmet pas de maladies graves connues à l’homme. Sa
dangerosité est donc nulle en contexte naturel. Elle est protégée en
France et considérée comme indicatrice de milieux préservés. |
Phocidés
(2 espèces)
|
Phoca vitulina — Phoque commun
(140-190 cm, moins de 130 kg)
Halichoerus grypus — Phoque gris
(200-250 cm, moins de 300 kg)
 |
Taille des Phocidés Les Phocidés varient de 1,17 mètre
pour le phoque annelé (Pusa hispida) à 4,9 mètres pour l’éléphant de mer
austral (Mirounga leonina). Leur poids va de 45 kg à plus de 3 600 kg
selon l’espèce et le sexe. Le phoque commun (Phoca vitulina), espèce la
plus fréquente en France, mesure entre 1,50 et 1,80 mètre pour un poids
de 80 à 130 kg.
Présence en France et en Aquitaine Deux espèces sont présentes
sur les côtes françaises : le phoque gris (Halichoerus grypus) et le
phoque commun (Phoca vitulina). Ils sont bien établis en Manche et mer
du Nord, notamment en baie de Somme. Sur la façade atlantique, leur
présence est plus sporadique mais en augmentation. En
Nouvelle-Aquitaine, plusieurs individus ont été observés dans le bassin
d’Arcachon, sur les plages des Landes et en Gironde, avec des cas
d’interactions régulières depuis 2015.
Habitat Les Phocidés fréquentent les côtes marines, les
estuaires, les bancs sableux et les zones rocheuses. Ils utilisent les
plages et les îlots pour se reposer et muer. Leur habitat marin est
côtier mais ils peuvent plonger à grande profondeur pour chasser
poissons, céphalopodes et crustacés. Ils sont souvent observés dans les
zones de marée et les embouchures de fleuves.
Dangerosité Les Phocidés ne sont pas agressifs mais peuvent
représenter un danger indirect. Des cas de morsures ont été signalés en
Gironde, notamment sur des surfeurs ou baigneurs trop proches. Les
phoques peuvent transmettre des germes comme les mycoplasmes,
responsables de gangrène, ou la brucellose chez les jeunes individus. Il
est recommandé de garder une distance de 50 mètres et d’éviter tout
contact physique. |
Cetartiodactyles présents en
France
|
Espèces en France |
Espèces
representatives |
Description |
Suidés
(1 espèce) |
Sanglier (Sus scrofa)
(120-180 cm, moins de 150 kg)
 |
Taille des Suidés Le sanglier (Sus scrofa)
mesure entre 90 et 180 cm de long, avec une hauteur au garrot de 55 à
110 cm et un poids variant de 50 à 150 kg, parfois jusqu’à 200 kg chez
les mâles adultes. Le porc domestique (Sus scrofa domesticus),
issu de la même espèce, présente une taille très variable selon les
races, souvent plus massive. Les hybrides sanglochon ou cochonglier
peuvent atteindre des gabarits intermédiaires.
Présence en France et en Aquitaine Le sanglier est présent dans
toute la France métropolitaine, sauf en Corse où il est remplacé par une
forme insulaire. En Nouvelle-Aquitaine, il est abondant dans tous les
départements, y compris en Gironde, avec des densités élevées dans les
zones forestières, agricoles et périurbaines. Le porc domestique est
uniquement présent en élevage, mais des individus échappés ou retournés
à l’état sauvage peuvent s’hybrider avec des sangliers.
Habitat Le sanglier fréquente les forêts feuillues, les
bocages, les zones humides, les friches agricoles, les vignobles et
parfois les milieux urbains. Il utilise les haies et les bois pour se
déplacer discrètement et creuse des bauges pour se reposer. Le porc
domestique vit en milieu agricole, en stabulation ou en plein air selon
les pratiques d’élevage. Les individus retournés à l’état sauvage
adoptent les mêmes habitats que les sangliers.
Dangerosité Le sanglier est généralement discret et fuyant,
mais peut se montrer dangereux s’il est surpris, blessé ou acculé,
notamment les mâles en rut. Il représente un risque pour les cultures,
les infrastructures routières (collisions), et parfois pour les
riverains en zone périurbaine. Il peut être vecteur de la peste porcine
africaine, bien que la France soit indemne à ce jour. Le porc domestique
ne présente aucun danger en élevage contrôlé, mais peut poser des
risques sanitaires en cas de mauvaise gestion. |
Delphinidés
(env 10 espèces) |
Tursiops truncatus — Grand dauphin
(250-400 cm, moins de 600 kg)
Stenella coeruleoalba — Dauphin bleu et blanc
(180-240 cm, moins de 200 kg)
Delphinus delphis — Dauphin commun
(180-260 cm, moins de 250 kg)
Grampus griseus — Dauphin de Risso
(250-400 cm, moins de 600 kg)

 |
Taille des Delphinidés Les Delphinidés présentent une
grande variabilité morphologique. Les plus petits, comme Delphinus
delphis (dauphin commun), mesurent environ 1,8 à 2,5 m pour 80 à
150 kg. Le grand dauphin (Tursiops truncatus) atteint 3 à 4 m
pour 150 à 650 kg. Les plus grands, comme l’orque (Orcinus orca),
peuvent dépasser 9 m et peser jusqu’à 9 tonnes.
Présence sur les côtes françaises et en eau douce Les
Delphinidés sont présents sur l’ensemble du littoral français : Manche,
Atlantique, Méditerranée. Le grand dauphin est fréquent sur les côtes de
Nouvelle-Aquitaine, notamment dans le golfe de Gascogne et autour du
bassin d’Arcachon. En Méditerranée, plusieurs espèces coexistent, dont
Stenella coeruleoalba (stenelle rayée) et Globicephala
melas (globicéphale noir). En eau douce, aucun Delphinidé n’est
naturellement présent en France. Les rares dauphins d’eau douce (comme
Sotalia fluviatilis ou Inia geoffrensis) appartiennent
à d’autres familles (Platanistidés, Iniidés) et sont strictement
néotropicaux.
Habitat Les Delphinidés fréquentent les eaux côtières, les
estuaires, les plateaux continentaux et parfois le large. Le grand
dauphin montre une préférence pour les zones littorales riches en
poissons benthiques, mais peut aussi se déplacer en pleine mer. Les
orques et pseudorques fréquentent les eaux plus profondes. Les espèces
côtières peuvent interagir avec les activités humaines : pêche,
navigation, tourisme.
Dangerosité Les Delphinidés ne sont pas dangereux pour l’humain
dans leur comportement naturel. Ils sont généralement curieux et
pacifiques. Toutefois, des accidents peuvent survenir en captivité ou
lors d’interactions forcées. L’orque, bien que social et intelligent,
reste un prédateur apical capable d’attaques ciblées sur d’autres
mammifères marins. En milieu naturel, les risques pour l’humain sont
négligeables. Les Delphinidés sont protégés par des conventions
internationales (CMS, ACCOBAMS) et leur perturbation volontaire est
interdite. |
Balaenoptéridés
(env 4 espèces) |
Rorqual commun (Balaenoptera physalus)
(18-25 m, moins de 80 t)
Rorqual de Minke (Balaenoptera acutorostrata)
(7-10 m, moins de 10 t)
 |
Taille des Balaenoptéridés Le rorqual bleu peut
atteindre 30 mètres c’est le plus grand animal vivant le rorqual commun
mesure entre 18 et 24 mètres
le rorqual boréal entre 12 et 16 mètres et le petit rorqual entre 7 et
10 mètres
Présence près des côtes françaises Le rorqual commun est
régulièrement observé dans le golfe de Gascogne et parfois en Manche le
petit rorqual est plus côtier et peut être vu près des rivages notamment
en Bretagne et en Méditerranée le rorqual bleu reste très rare et
généralement au large le rorqual boréal
est occasionnel et peu fréquent
Habitat Les Balaenoptéridés fréquentent les eaux tempérées à
froides pour le rorqual commun et boréal les eaux plus chaudes pour le
petit rorqual et parfois le rorqual bleu ils privilégient les zones
riches en krill et petits poissons souvent en pleine mer mais certains
comme le petit rorqual s’approchent des côtes en période de nourrissage
Dangerosité Ces cétacés ne sont pas dangereux pour l’humain ils
sont paisibles et évitent les interactions directes les risques sont
liés aux collisions avec les navires ou aux perturbations acoustiques
ils ne présentent aucune agressivité naturelle et ne sont pas considérés
comme une menace |
Phocoenidés
(1 espèce) |
Marsouin commun (Phocoena phocoena)
(130-190 cm, moins de 100 kg)
 |
Taille des Phocoenidés Les Phocoenidés sont de petits
cétacés odontocètes mesurant entre 1,4 et 2,5 mètres selon les espèces
le marsouin commun atteint généralement 1,5 à 1,9 mètre pour un poids de
45 à 65 kg
Présence près des côtes françaises Le marsouin commun est la
seule espèce régulièrement observée en France il fréquente les côtes de
la Manche de l’Atlantique et parfois la Méditerranée notamment dans les
zones peu profondes et les estuaires sa discrétion et son absence de
sauts le rendent difficile à repérer malgré une présence réelle
Habitat Les Phocoenidés privilégient les plateaux continentaux
les baies les estuaires et les criques ils évoluent en petits groupes
souvent de 2 à 6 individus et se nourrissent de poissons céphalopodes et
crustacés leur répartition évite les zones tropicales et polaires
Dangerosité
Dangerosité Ils ne présentent aucun danger pour l’humain ce
sont des animaux timides et non agressifs les principales menaces sont
pour eux notamment les captures accidentelles dans les filets de pêche
et la pollution sonore ils ne provoquent aucun comportement dangereux
envers les humains |
Kogiidés
(2 espèces) |
Kogia breviceps — Cachalot pygmée
(270-330 cm, moins de 500 kg)
Kogia sima — Cachalot nain
(200-270 cm, moins de 300 kg)
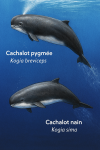 |
Taille des Kogiidés Les Kogiidés comprennent deux
espèces : Kogia breviceps (cachalot pygmée) et Kogia sima
(cachalot nain) le cachalot pygmée mesure entre 2,7 et 3,5 mètres pour
un poids de 350 à 450 kg le cachalot nain est plus petit avec une taille
de 2 à 2,7 mètres et un poids de 150 à 270 kg
Présence près des côtes françaises Ces espèces sont rares et
discrètes dans les eaux françaises elles sont principalement observées
en Méditerranée et parfois dans le golfe de Gascogne les signalements
sont souvent liés à des échouages plutôt qu’à des observations en mer
leur comportement cryptique et leur préférence pour les eaux profondes
rendent leur détection difficile
Habitat Les Kogiidés fréquentent les eaux tropicales et
tempérées profondes ils évoluent généralement entre 300 et 1000 mètres
de profondeur et remontent à la surface pour respirer ou se nourrir ils
se nourrissent de céphalopodes principalement calmars et parfois de
poissons profonds
Dangerosité Ils ne présentent aucun danger pour l’humain ce
sont des cétacés timides et solitaires qui évitent les interactions leur
dentition et leur comportement ne permettent aucune agression envers
l’humain les risques sont uniquement liés à leur vulnérabilité face aux
activités humaines comme les sonars militaires ou les pollutions |
Physeteridés
(1 espèce) |
Physeter macrocephalus — Cachalot
(15-18 m, moins de 50 t)
 |
Taille des Physeteridés Le grand cachalot (Physeter
macrocephalus) atteint jusqu’à 20 mètres de long pour un poids de 50
tonnes. Les espèces plus petites comme le cachalot pygmée (Kogia
breviceps) et le cachalot nain (Kogia sima) mesurent entre 2,5 et 4
mètres pour un poids de 300 à 500 kg.
Présence près des côtes de France et en Aquitaine Le grand
cachalot est présent dans les eaux profondes de l’Atlantique, notamment
au large du golfe de Gascogne. Il est observé de manière occasionnelle
près des côtes françaises, surtout dans les zones de canyon sous-marin
comme Capbreton. Les espèces du genre Kogia sont plus discrètes mais
également signalées dans les eaux françaises, avec des échouages
sporadiques sur les plages d’Aquitaine et du sud-ouest.
Habitat Les Physeteridés fréquentent les eaux océaniques
profondes, souvent au-delà du plateau continental. Le grand cachalot
plonge jusqu’à 2000 mètres pour chasser les calmars. Les Kogia préfèrent
les eaux tempérées à tropicales, parfois plus proches des côtes mais
toujours dans des zones de grande profondeur.
Dangerosité Les Physeteridés ne sont pas dangereux pour
l’homme. Ce sont des cétacés odontocètes (à dents) mais non agressifs.
Le grand cachalot peut être impressionnant par sa taille mais n’a jamais
été impliqué dans des attaques. Les risques sont liés aux collisions en
mer ou aux échouages, mais pas à un comportement hostile |
Ziphiidés
(env 6 espèces) |
Ziphius cavirostris — Baleine de Cuvier
(5-7 m, moins de 5 t)
Mesoplodon europaeus — Mésoplodon d’Europe
(4-5 m, moins de 2 t)
Mesoplodon bidens — Mésoplodon de Sowerby
(4-5,5 m, moins de 2 t)
Hyperoodon ampullatus — Hyperoodon boréal
(6-8 m, moins de 10 t)

 |
Taille des Ziphiidés Les Ziphiidés mesurent entre 4 et
12,8 mètres selon les espèces. Le plus grand est la bérardie de Baird
avec un poids pouvant atteindre 10 tonnes. Les espèces du genre
Mesoplodon sont plus petites, autour de 4 à 6 mètres pour 1 à 2 tonnes.
Présence près des côtes de France et en Aquitaine Les Ziphiidés
sont présents dans les eaux françaises mais rarement observés. Ils
fréquentent le golfe de Gascogne et les zones profondes au large des
côtes atlantiques. Des échouages ont été signalés en Aquitaine,
notamment de Mesoplodon et Ziphius cavirostris. Leur présence est
discrète et souvent révélée par des échouages plutôt que par des
observations en mer.
Habitat Ils vivent en haute mer, dans des zones de grande
profondeur, souvent au-delà du plateau continental. Ils privilégient les
canyons sous-marins et les zones riches en calmars. Ils sont solitaires
ou en petits groupes et passent la majorité de leur temps en plongée
profonde.
Dangerosité Les Ziphiidés ne présentent aucun danger pour
l’homme. Ce sont des cétacés odontocètes très discrets, non agressifs et
rarement en interaction avec les activités humaines. Les risques sont
indirects, liés aux échouages ou aux perturbations acoustiques (sonars
militaires) qui peuvent provoquer des désorientations. |
Bovidés
(env 6 espèces) |
Taureau (Bos taurus)
(Garrot 130-150 cm, moins de 1 t)
Chamois (Rupicapra rupicapra)
(Garrot 70-85 cm, moins de 50 kg)
Bouquetin des Alpes (Capra ibex)
(Garrot 75-100 cm, moins de 120 kg)
Mouflon de Corse (Ovis gmelini musimon)
(Garrot 65-75 cm, moins de 60 kg)
Bison d’Europe (Bison bonasus)
(Garrot 160-190 cm, moins de 1 t)


 |
Taille des Bovidés Les Bovidés présentent une grande
variabilité morphologique. Les plus petits comme les chèvres naines
mesurent 40 cm au garrot pour 20 kg. Les bovins domestiques atteignent
1,40 mètre au garrot pour 600 à 900 kg. Les bisons d’Europe réintroduits
peuvent dépasser 2 mètres de long pour plus de 1000 kg. Les cornes sont
présentes chez les deux sexes dans certaines espèces et varient en forme
et en taille.
Présence en France et en Aquitaine Les espèces sauvages sont
rares. Le bison d’Europe (Bison bonasus) est réintroduit dans quelques
réserves du Massif Central et des Ardennes mais absent en
Nouvelle-Aquitaine. Les bovins, moutons et chèvres domestiques sont
omniprésents. Le mouflon méditerranéen (Ovis aries musimon), issu
d’introductions cynégétiques, est présent dans le sud-est mais absent en
Aquitaine. Les populations marronnes ou semi-sauvages de bovins existent
dans certaines zones forestières mais sont sous contrôle. Aucun bovidé
sauvage autochtone n’est présent en Gironde ou dans les Landes.
Habitat Les Bovidés domestiques occupent les prairies, les
pâturages, les zones agricoles et les estives. Les espèces réintroduites
comme le bison d’Europe vivent dans des forêts mixtes, des clairières et
des zones de moyenne montagne. Le mouflon fréquente les garrigues, les
zones rocheuses et les forêts méditerranéennes. Les habitats sont liés à
la disponibilité de fourrage et à la pression humaine.
Dangerosité Les Bovidés ne sont pas dangereux en contexte
naturel. Les bovins domestiques peuvent être agressifs en cas de stress
ou de protection du troupeau. Les bisons sont puissants et peuvent
charger s’ils sont surpris ou menacés. Les moutons et chèvres ne
présentent aucun risque. Le danger est surtout lié à des accidents
agricoles ou à des comportements défensifs en captivité. Aucun cas
d’agression grave par bovidé sauvage n’est recensé en France
métropolitaine. |
Cervidés
(env 3 espèces) |
Cerf élaphe (Cervus elaphus)
(Garrot 120-150 cm, moins de 250 kg)
Chevreuil européen (Capreolus capreolus)
(Garrot 65-80 cm, moins de 30 kg)
Daim européen (Dama dama)
(Garrot 90-110 cm, moins de 100 kg)

 |
Taille des Cervidés Les cervidés français varient de 90
cm pour le chevreuil (Capreolus capreolus) à plus de 2,60 mètres pour le
cerf élaphe (Cervus elaphus) en position allongée. Le chevreuil mesure
environ 70 cm au garrot pour un poids de 20 à 30 kg. Le cerf élaphe
atteint 1,30 mètre au garrot pour un poids de 150 à 250 kg chez les
mâles. Le daim (Dama dama), espèce introduite, mesure 90 à 100 cm au
garrot pour 60 à 100 kg. Le sika (Cervus nippon), également introduit,
est plus petit avec 70 à 90 cm au garrot pour 40 à 70 kg.
Présence en France et en Aquitaine Le chevreuil est présent
dans toute la France, y compris en Gironde et dans les Landes, avec des
densités élevées dans les zones boisées et agricoles. Le cerf élaphe est
bien établi dans les Pyrénées-Atlantiques, le sud de la Dordogne et
certaines forêts du Médoc. Le daim et le sika sont présents localement
dans des domaines privés ou des parcs forestiers, parfois en
semi-liberté. En Nouvelle-Aquitaine, les populations de cervidés sont
suivies activement par les fédérations de chasse et les réseaux de
gestion cynégétique.
Habitat Les cervidés occupent des milieux forestiers, bocagers
et agricoles. Le chevreuil préfère les mosaïques de bois et de cultures
avec zones de refuge. Le cerf élaphe fréquente les grandes forêts, les
vallées encaissées et les zones de montagne. Le daim et le sika
s’adaptent aux milieux semi-ouverts, souvent en présence humaine. Tous
utilisent les lisières, les clairières et les zones de transition pour
se nourrir et se déplacer.
Dangerosité Les cervidés ne sont pas dangereux pour l’homme en
contexte naturel. Les mâles peuvent être agressifs en période de rut,
surtout le cerf élaphe, mais les incidents sont rares. Les collisions
routières représentent le principal risque, notamment avec le chevreuil
et le cerf. Les cervidés peuvent aussi provoquer des dégâts agricoles et
forestiers en cas de surpopulation. Aucun comportement prédateur ou
agressif ciblé n’est documenté en France métropolitaine. |
Soricomorphes présents en
France
|
Espèces en France |
Espèces
representatives |
Description |
Soricidés
(11
espèces) |
Sorex araneus — Musaraigne carrelet
(9-14 cm, moins de 100 g)
Crocidura russula — Musaraigne musette
(9-13 cm, moins de 100 g)
Sorex minutus — Musaraigne pygmée
(7-10 cm, moins de 10 g)
Neomys fodiens — Musaraigne aquatique
(10-15 cm, moins de 100 g)


|
Taille des Soricidés Les Soricidés sont de très petits
mammifères insectivores. La musaraigne commune (Crocidura russula)
mesure entre 6 et 9 cm de corps, avec une queue de 3 à 5 cm, pour un
poids de 8 à 14 g. La musaraigne carrelet (Sorex araneus) atteint 5 à 7
cm pour un poids de 5 à 12 g. Leur museau est allongé, leurs oreilles
discrètes, et leur corps finement velu.
Présence en France et en Aquitaine Les Soricidés sont largement
répandus en France, avec plusieurs espèces bien établies. En
Nouvelle-Aquitaine, on trouve notamment Crocidura russula, Sorex
araneus, Sorex minutus et Neomys fodiens. La musaraigne aquatique
(Neomys fodiens) est présente dans les zones humides de Gironde et des
Pyrénées-Atlantiques. La musaraigne commune est très fréquente dans les
jardins, les haies et les prairies bocagères.
Habitat Les Soricidés occupent une grande diversité de milieux
: forêts, prairies, haies, zones humides, berges, jardins et bâtiments.
Certaines espèces comme Neomys fodiens sont semi-aquatiques et
fréquentent les ruisseaux et fossés. D’autres, comme Crocidura russula,
s’adaptent bien aux milieux anthropisés. Elles creusent des galeries peu
profondes ou utilisent des abris naturels. Leur activité est
principalement nocturne ou crépusculaire.
Dangerosité Les Soricidés ne sont pas dangereux pour l’humain.
Certaines espèces comme Neomys fodiens et Blarina brevicauda (non
présente en France) possèdent une salive légèrement toxique pour leurs
proies, mais sans effet sur l’homme. Elles ne sont pas vectrices de
zoonoses majeures en France. Leur rôle écologique est bénéfique : elles
consomment de nombreux invertébrés, régulent les populations de limaces,
vers et insectes. Leur discrétion et leur faible densité rendent leur
présence rarement problématique. |
Talpidés
(4 espèces) |
Talpa europaea — Taupe d’Europe
(11-16 cm, moins de 200 g)
Talpa aquitania — Taupe d’Aquitaine
(11-15 cm, moins de 200 g)
Galemys pyrenaicus — Desman des Pyrénées
(10-14 cm, moins de 200 g)
Talpa caeca — Taupe aveugle
(11-18 cm, moins de 100 g)
 |
Taille des Talpidés Les Talpidés français sont de
petits mammifères fouisseurs. La taupe d’Europe (Talpa europaea)
mesure entre 11 et 16 cm de corps, avec une queue de 2 à 4 cm, pour un
poids de 70 à 130 g. La taupe d’Aquitaine (Talpa aquitania),
décrite en 2017, est légèrement plus grande : 14 à 15,6 cm de corps,
poids de 72 à 106 g. Elle possède des paupières fusionnées et des yeux
recouverts d’une membrane, ce qui la distingue morphologiquement.
Présence en France et en Aquitaine La taupe d’Europe est
largement répandue dans toute la France, sauf en Corse. La taupe
d’Aquitaine est présente dans le sud-ouest du pays, notamment en
Nouvelle-Aquitaine, où elle est dominante. Elle remplace localement
Talpa europaea dans les zones situées au sud et à l’ouest de la
Loire. Les autres Talpidés comme le Desman des Pyrénées (Galemys
pyrenaicus) sont très localisés dans les zones montagneuses du sud,
et absents de Gironde.
Habitat Les taupes vivent dans les prairies, les forêts, les
jardins, les vergers et les zones agricoles. Elles creusent des réseaux
de galeries souterraines pour se nourrir et se déplacer. Elles évitent
les sols trop secs ou trop caillouteux. Le Desman des Pyrénées,
semi-aquatique, fréquente les ruisseaux de montagne à courant vif, mais
ne se rencontre pas en plaine aquitaine.
Dangerosité Les Talpidés ne sont pas dangereux pour
l’humain. Ils ne sont pas vecteurs de zoonoses connues en France. Leur
activité souterraine peut causer des dégâts mineurs aux pelouses ou aux
cultures, mais ils jouent un rôle écologique important en aérant le sol
et en régulant les populations d’invertébrés. Ils sont souvent mal
perçus pour des raisons esthétiques ou agricoles, mais leur impact réel
est limité. Certaines espèces comme le Desman sont protégées et très
sensibles aux perturbations. |
Chiroptères présents en
France
|
Famille |
Espèces en France |
Espèces
representatives |
Description |
|
Molossidés |
1 espèce |
Molosse de Cestoni - Tadarida teniotis
(8-10 cm, enverg 40-45 cm, moins de 100 g)
 |
Taille des Molossidés Le seul représentant naturel en
France est le Molosse de Cestoni (Tadarida teniotis). Il mesure entre
8,1 et 9,2 cm de longueur tête-corps, avec une envergure de 40 à 45 cm.
Son poids varie de 22 à 54 g. C’est l’une des plus grandes
chauves-souris d’Europe, reconnaissable à ses ailes longues et étroites,
sa queue dépassant nettement du patagium, et son museau massif évoquant
une tête de dogue.
Présence en France et en Aquitaine Le Molosse de Cestoni est
principalement présent dans les régions méridionales : Provence, Alpes
du Sud, Corse, et ponctuellement en Nouvelle-Aquitaine. En Gironde, sa
présence est rare mais possible dans les zones urbaines anciennes ou les
falaises bien exposées. Il reste mal connu et peu suivi dans le
nord-ouest du pays. Sa répartition est fragmentée et dépend fortement de
la disponibilité de gîtes adaptés.
Habitat Il fréquente les falaises, les corniches de bâtiments,
les ponts bien exposés au sud, et chasse en plein ciel entre 10 et 300
mètres d’altitude. Il ne pénètre pas dans les forêts denses ni les
milieux fermés. Il se nourrit de gros insectes nocturnes capturés en
vol, notamment des coléoptères et des papillons de nuit. Il ne pratique
pas une véritable hibernation mais entre en léthargie temporaire en
hiver.
Dangerosité Le Molosse de Cestoni n’est pas dangereux pour
l’humain. Il n’est pas vecteur de zoonoses connues en France. Sa
dangerosité est nulle en milieu naturel. Les menaces qui le concernent
sont anthropiques : éoliennes, travaux sur les bâtiments, aménagements
de voies d’escalade, et pollution. Il est protégé par la Directive
Habitats et les conventions de Berne et Bonn. Toute perturbation de ses
gîtes est interdite. |
|
Rhinolophidés |
4 espèces |
Rhinolophus hipposideros Petit rhinolophe
(3-5 cm, enverg 20-25 cm, moins de 10 g)Rhinolophus ferrumequinum Grand rhinolophe
(5-7 cm, enverg 30-40 cm, moins de 100 g)

|
Taille des Rhinolophidés Les espèces françaises
mesurent entre 4 et 7 cm de longueur tête-corps. Le Petit rhinolophe (Rhinolophus
hipposideros) atteint 35 à 45 mm pour une envergure de 190 à 250 mm et
un poids de 5 à 9 g. Le Grand rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum)
mesure 54 à 71 mm, avec une envergure de 330 à 400 mm et un poids de 15
à 34 g. Le Rhinolophe euryale, plus
rare, se situe entre les deux.
Présence en France et en Aquitaine Trois espèces sont présentes
en France : le Petit rhinolophe, le Grand rhinolophe et le Rhinolophe
euryale. Toutes trois sont confirmées en Nouvelle-Aquitaine, notamment
dans les départements du sud-ouest. Le Grand rhinolophe est bien
représenté avec près de 28 000 individus recensés en hivernage dans plus
de 600 sites souterrains, et environ 14 500 individus en été répartis
dans une centaine de colonies. Le Petit
rhinolophe est également bien implanté, mais en déclin dans les zones
urbanisées. Le Rhinolophe euryale est plus localisé, présent surtout
dans les zones karstiques et boisées du sud.
Habitat Les Rhinolophidés utilisent des cavités souterraines,
des combles, des grottes, des caves et des bâtiments anciens pour
l’hibernation et la reproduction. Ils chassent dans les prairies
bocagères, les ripisylves, les lisières forestières et les zones
agricoles peu intensives. Le Grand rhinolophe privilégie les pâtures
entourées de haies hautes et les forêts de feuillus.
Ces espèces sont très sensibles au dérangement, à la
fragmentation des paysages et à l’usage de pesticides.
Dangerosité Les Rhinolophidés ne présentent aucun danger pour
l’humain. Ils ne sont pas vecteurs de maladies transmissibles en France.
Leur rôle écologique est bénéfique, notamment par la régulation des
populations d’insectes nocturnes. Leur vulnérabilité écologique impose
des mesures de protection strictes. Toute perturbation de leurs gîtes ou
de leurs habitats est interdite. Ils sont protégés par la Directive
Habitats, la Convention de Berne et la Convention de Bonn |
|
Vespertilionidés |
28 espèces |
Myotis myotis — Grand murin
(6-8 cm, enverg 35-45 cm, moins de 100 g)
Myotis daubentonii — Murin de Daubenton
(4-6 cm, enverg 24-27 cm, moins de 100 g)
Pipistrellus pipistrellus — Pipistrelle commune
(3-5 cm, enverg 18-24 cm, moins de 10 g)
Plecotus auritus — Oreillard roux
(4-6 cm, enverg 25-30 cm, moins de 100 g)

 |
Taille des Vespertilionidés Les vespertilionidés
français mesurent généralement entre 3 et 7 cm de longueur tête-corps.
Leur envergure varie de 18 à 40 cm selon les espèces. Le poids oscille
entre 4 et 30 g. Le Grand murin (Myotis myotis) atteint 7 cm pour 30 g,
tandis que la Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) ne dépasse
pas 5 cm pour 5 g. Le Murin de Bechstein (Myotis bechsteinii), espèce
forestière, mesure 4,5 à 5,5 cm pour 7 à 12 g.
Présence en France et en Aquitaine Les vespertilionidés sont la
famille de chauves-souris la plus diversifiée en France, avec plus de 20
espèces recensées. En Nouvelle-Aquitaine, la majorité des espèces sont
bien représentées, notamment en Gironde. On y trouve le Grand murin, le
Murin de Natterer, le Murin de Daubenton, la Pipistrelle commune, la
Pipistrelle pygmée, l’Oreillard roux et l’Oreillard gris. Le Murin de
Bechstein est plus localisé, présent dans les grands massifs forestiers
du nord-est de la région. La répartition dépend fortement de la qualité
des habitats, de la connectivité écologique et de la disponibilité des
gîtes.
Habitat Les vespertilionidés occupent une grande variété de
milieux : forêts feuillues, bocages, zones humides, rivières, prairies,
bâtiments anciens, combles, fissures, cavités arboricoles et
souterraines. Le Murin de Daubenton chasse au ras de l’eau, le Murin de
Bechstein dans les sous-bois denses, la Pipistrelle commune dans les
milieux urbains. Les gîtes d’été sont souvent arboricoles ou bâtis,
tandis que les sites d’hibernation incluent grottes, caves et tunnels.
Certaines espèces sont très fidèles à leurs territoires et sensibles à
la fragmentation.
Dangerosité Les vespertilionidés ne présentent aucun danger
direct pour l’humain. Ils ne sont pas vecteurs de zoonoses actives en
France. Leur rôle écologique est essentiel dans la régulation des
insectes nocturnes. Les risques sanitaires sont négligeables en milieu
naturel. Les menaces concernent surtout les chauves-souris elles-mêmes :
destruction des gîtes, usage de pesticides, éclairage nocturne,
éoliennes et dérangement. Toutes les espèces sont strictement protégées
par la loi française et les conventions internationales. Toute
manipulation ou perturbation est interdite sans autorisation
scientifique. |
|
Minioptéridés |
1 espèce |
Miniopterus schreibersii — Minioptère de
Schreibers.
(4-6 cm, enverg 26-32 cm, moins de 100 g)
 |
Taille du Minioptère de Schreibers Miniopterus
schreibersii mesure entre 5 et 6,2 cm de longueur tête-corps, avec une
envergure de 30,5 à 34,2 cm. Son poids varie de 9 à 18 g. Il se
distingue par ses ailes longues et étroites, son front bombé et ses
oreilles courtes et triangulaires.
Présence en France et en Aquitaine L’espèce est présente dans
le sud de la France, notamment dans les régions karstiques et
méditerranéennes. Elle est confirmée en Nouvelle-Aquitaine, surtout dans
les zones calcaires du Lot, de la Dordogne et du Pays basque. Elle forme
parfois des colonies mixtes avec le Grand murin, le Grand rhinolophe ou
le Rhinolophe euryale. Sa répartition est fragmentée et dépend fortement
de la disponibilité de gîtes souterrains stables.
Habitat Le Minioptère de Schreibers est une espèce cavernicole.
Il utilise les grottes naturelles, les mines, les tunnels, les carrières
et parfois les caves ou greniers lors des migrations. Il chasse dans les
lisières forestières, les mosaïques bocagères et les zones éclairées
artificiellement. Il consomme principalement de petits papillons
nocturnes, complétés par des diptères et des coléoptères. Il migre entre
ses gîtes d’été et d’hiver sur plusieurs dizaines à centaines de
kilomètres.
Dangerosité L’espèce n’est pas dangereuse pour l’humain. Elle
ne transmet pas de maladies connues en France et ne présente aucun
risque sanitaire. En revanche, elle est très sensible au dérangement, à
la fermeture des cavités, aux aménagements touristiques et à la
banalisation des paysages. Elle est protégée par la Directive Habitats,
la Convention de Berne et la Convention de Bonn. Toute perturbation de
ses gîtes est interdite |
Autres Mammifères
présent en France
| Ordre |
Espèces en France |
Espèces
representatives |
Description |
|
Lagomorphes |
2 espèces |
Lepus europaeus — Lièvre d'Europeµ
(48-70 cm, moins de 10 kg)
Oryctolagus cuniculus — Lapin de garenne
(35-50 cm, moins de 5 kg)
 |
Taille des lagomorphes Le lapin de garenne mesure entre
35 et 45 cm pour un poids de 1 à 2,5 kg. Le lièvre d’Europe atteint 50 à
70 cm avec un poids de 3 à 6 kg. Les pikas, plus petits et trapus, sont
absents de France.
Présence en France et en Aquitaine Le lapin de garenne est très
répandu en France, notamment dans les milieux ouverts, les friches et
les zones agricoles. En Aquitaine, il est commun dans les Landes, le
Médoc et les zones sablonneuses. Le lièvre d’Europe est également bien
présent sur l’ensemble du territoire, y compris en Gironde, dans les
zones agricoles, les prairies et les bois clairs. Aucun lagomorphe
sauvage autre que ces deux espèces n’est naturellement présent en
France.
Habitat Le lapin de garenne creuse des terriers dans les sols
meubles, souvent en colonies. Il privilégie les milieux ouverts, les
talus, les dunes et les zones cultivées. Le lièvre d’Europe ne creuse
pas de terrier mais s’abrite dans des formes, dépressions du sol. Il
fréquente les plaines agricoles, les steppes, les prairies et les
lisières forestières.
Dangerosité Les lagomorphes ne sont pas dangereux pour
l’humain. Ils peuvent cependant être vecteurs de maladies comme la
myxomatose ou la maladie virale hémorragique, transmissibles entre
individus mais non zoonotiques. En revanche, leur surpopulation peut
poser des problèmes agricoles et écologiques, notamment par le
surpâturage ou la compétition avec d’autres espèces. Le lièvre peut
occasionnellement provoquer des accidents de la route en zone rurale. |
|
Erinaceomorphes |
1 espèce |
Hérisson d’Europe —
Erinaceus europaeus
(20-30 cm, moins de 2 kg)
 |
Taille des Erinaceomorphes Le seul représentant en
France est le hérisson d’Europe (Erinaceus europaeus). Il mesure entre
20 et 30 cm de long pour un poids variant de 600 g à 1,2 kg selon la
saison et l’état corporel. Son dos est couvert de 5 000 à 7 000 piquants
rigides, non venimeux.
Présence en France et en Aquitaine Le hérisson d’Europe est
largement répandu sur l’ensemble du territoire français, y compris en
Nouvelle-Aquitaine. Il est bien présent en Gironde, notamment dans les
zones périurbaines, les jardins, les haies bocagères et les lisières
forestières. Il est cependant en déclin dans certaines zones à cause de
la fragmentation des habitats, des collisions routières et de l’usage de
pesticides.
Habitat Le hérisson fréquente les milieux semi-ouverts, les
prairies, les haies, les jardins, les bois clairs et les zones agricoles
diversifiées. Il évite les zones trop humides ou intensivement
cultivées. Il construit des nids de feuilles pour l’hibernation, qui
dure environ cinq mois. Il est principalement nocturne et insectivore,
consommant vers, limaces, insectes, œufs et parfois petits vertébrés.
Dangerosité Le hérisson n’est pas dangereux pour l’humain. Il
n’est pas vecteur direct de zoonoses majeures en France. Il peut
cependant héberger des parasites comme les tiques ou les puces, et être
porteur de salmonelles ou de leptospires dans de rares cas. Il est
surtout victime de dangers anthropiques : collisions, intoxications,
piégeage involontaire. Il bénéficie d’un statut de protection national
et ne doit pas être déplacé ou capturé sans autorisation. |
|
Périssodactyles |
2 sous-espèces |
Equus ferus caballus — Cheval domestique
(Garrot 130-180, moins de 1 t)
Equus ferus przewalskii — Cheval de
Przewalskii
(Garrot 120-145 cm, moins de 500 kg)
 |
Taille des périssodactyles Les équidés sauvages
présents en France sont de taille moyenne à grande. Le cheval de
Przewalski mesure environ 1,20 à 1,50 m au garrot pour un poids de 250 à
350 kg. Le cheval Camargue, bien que domestique, vit en semi-liberté et
atteint 1,30 à 1,45 m au garrot pour un poids de 300 à 400 kg. Les
autres périssodactyles comme les tapirs et les rhinocéros sont absents à
l’état sauvage en France.
Présence en France et en Aquitaine Les seuls périssodactyles
présents à l’état semi-sauvage sont des équidés. Le cheval de Przewalski
est réintroduit dans des réserves spécifiques comme celle des Coussouls
de Crau en Provence. Le cheval Camargue vit en liberté contrôlée dans le
delta du Rhône. En Aquitaine, aucun périssodactyle sauvage n’est présent
naturellement. Les équidés domestiques peuvent être observés en liberté
partielle dans certaines zones rurales, mais ne constituent pas une
population sauvage.
Habitat Les chevaux de Przewalski évoluent dans des steppes
ouvertes, des prairies sèches et des milieux semi-arides. En France,
leur habitat est strictement contrôlé dans des réserves. Les chevaux
Camargue vivent dans les marais, les sansouïres et les prairies humides
du delta du Rhône. Ces habitats sont riches en végétation herbacée et
adaptés à leur régime herbivore.
Dangerosité Les périssodactyles présents en France ne sont pas
dangereux pour l’humain. Ils sont généralement paisibles et évitent le
contact. Toutefois, comme tout grand mammifère, un cheval peut se
montrer défensif s’il est surpris ou acculé. Les risques sont surtout
liés à des comportements humains inadaptés. Aucun périssodactyle sauvage
en France ne présente de danger sanitaire ou épidémiologique notable. |
|